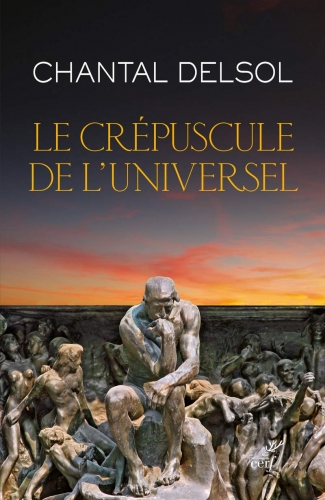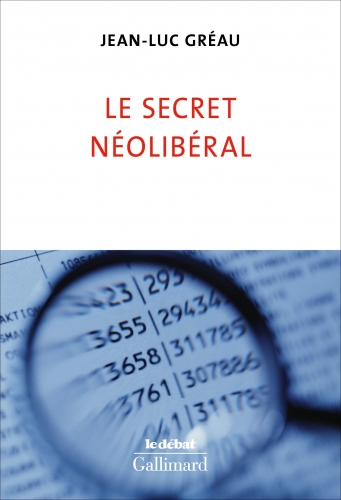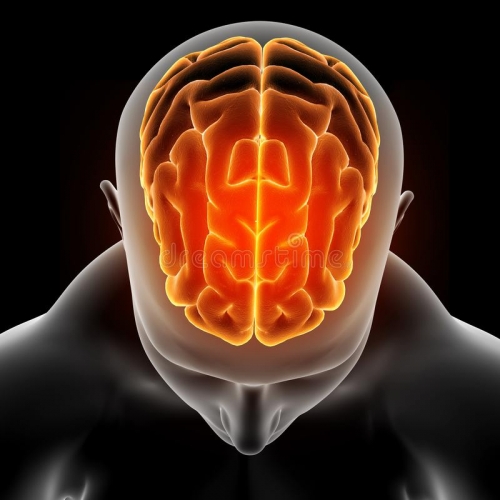Alain de Benoist : «Le libéralisme consacre le règne du non-commun»
Le terme « libéral » apparaît totalement galvaudé dans le débat public actuel. Pourriez-vous définir ce qu’est le projet libéral ?
Alain de Benoist : Comme pour tous les mots qui ont beaucoup servi (démocratie, progrès, etc.), il est difficile de donner une définition du libéralisme qui fasse l’unanimité. La difficulté se renforce du fait que, contrairement au marxisme, le libéralisme a eu de nombreux « pères fondateurs », et du fait aussi que ce qui relie le libéralisme économique au libéralisme politique, au libéralisme philosophique et au libéralisme « sociétal », n’est pas évident pour tout le monde. Le projet libéral, pour reprendre votre expression, est à mon sens un projet qui privilégie l’individu par rapport à tout ce qui l’excède en s’appuyant sur une anthropologie faisant de l’homme un être essentiellement mû par le désir de maximiser son intérêt personnel et son profit privé.
En quoi le libéralisme empêche-t-il de constituer une société qui ne serait pas qu’une somme d’intérêts particuliers ?
Il l’empêche pour la simple raison que toute société n’est à ses yeux qu’une somme d’intérêts particuliers. Du point de vue de l’idéologie libérale, ce n’est plus la société, mais l’individu qui vient en premier. Les sociétés, les peuples, les nations, les cultures, etc. n’ont pas d’existence en tant que tels : ils ne sont que des agrégats d’individus. Ces individus sont appréhendés comme fondamentalement autosuffisants, propriétaires d’eux-mêmes, capables à ce titre de se construire eux-mêmes à partir de rien – hors de tout déjà-là – sans que leurs choix puissent devoir quoi que ce soit à des appartenances qui leur préexistent. C’est en ce sens que Margaret Thatcher pouvait prétendre que « la société n’existe pas » (there is no society). Cette conception des choses, qui contredit à angle droit l’idée, remontant pour le moins à Aristote, selon laquelle l’homme est un animal politique social, est évidemment antagoniste de toute idée de bien commun. Du point de vue libéral, l’intérêt général se définit comme une somme d’intérêts particuliers dont on postule arbitrairement qu’ils peuvent s’harmoniser spontanément ou sous le seul effet des rapports juridiques et des mécanismes du marché. Le libéralisme consacre le règne du non-commun.
Selon le discours dominant aujourd’hui, la liberté libérale est la seule forme possible de la liberté. Or il existe dans l’histoire des idées d’autres façons de concevoir la liberté. Pourriez-vous en citer des exemples?
L’idéologie libérale ne veut pas connaître d’autre liberté que la liberté individuelle. Tout ce qui excède la liberté individuelle est posé comme une menace potentielle contre les droits des individus, le premier de ces droits étant en quelque sorte le droit d’avoir des droits. Cela transparaît clairement dans la façon dont le libéralisme s’oppose au politique, dont il veut toujours limiter l’autorité, en particulier vis-à-vis de l’économie. Historiquement parlant, le règne de l’idéologie libérale est indissociable de la montée de la classe et des valeurs bourgeoises, qui prétendaient lever tous les obstacles susceptibles de freiner les échanges commerciaux et la production de marchandises. Cette conception de la liberté est propre au libéralisme. Il en est heureusement (bien) d’autres. J’en donnerai deux exemples. Le premier est l’opposition bien connue, développée en son temps par le très libéral Benjamin Constant, entre la « liberté des Anciens » et la « liberté des Modernes ». La première se définissait comme ce qui permettait à tous les citoyens de participer aux affaires publiques, tandis que la seconde est au contraire ce qui permet aux individus de ne pas y participer et de se soustraire aux obligations civiques pour rechercher leur épanouissement dans le domaine du privé. Le second exemple est celui de la « liberté républicaine » telle qu’elle a été conçue par un courant de pensée allant de Tite-Live à Harrington en passant par Machiavel. Sa caractéristique principale est de lier liberté individuelle et liberté collective : je ne peux me considérer comme libre si le pays auquel j’appartiens ne l’est pas. La liberté est donc appelée à s’articuler avec le commun, ce que le libéralisme ignore entièrement.
Dans La Grande Transformation, Karl Polanyi explique que l’émergence de l’État-nation a permis le triomphe de la logique du marché et la destruction des structures et des solidarités organiques. Pourtant, l’État-nation semble aujourd’hui être la seule échelle à laquelle quelque chose du politique subsiste et l’un des derniers cadres de résistance au capitalisme financier. Nous pensons à « Critique de la raison européenne » qu’il doit donc être défendu. Comment vous situez-vous sur ce débat ?
Vous n’avez pas tort de penser que, dans les circonstances présentes, l’Etat-nation doit être défendu, mais j’ajouterai qu’il doit l’être comme un pis-aller. Il ne faut en effet pas se faire d’illusions. La souveraineté des Etats nationaux ne tient plus aujourd’hui que par la peinture ! Des pans entiers de souveraineté leur ont été enlevés dans le cadre de la construction européenne, sans que ces parts de souveraineté se trouvent reportés à un plus haut niveau (l’Europe ne s’est pas construite comme une puissance, mais comme un marché). D’autre part, l’évolution récente des Etats-nations atteste que ceux qui les dirigent – ou plutôt qui les administrent ou qui les gèrent – sont eux-mêmes largement gagnés à l’idéologie libérale. C’est ce qui explique que les libéraux, après avoir férocement combattus l’influence de l’Etat, en viennent aujourd’hui bien souvent à en attendre qu’il contribue lui-même à créer les circonstances les plus favorables au libre développement des marchés, à la mise en œuvre de l’idéologie des droits, etc. L’autorité publique se ramène alors à la « bonne gouvernance », qui calque le gouvernement des hommes sur l’administration des choses, en prétendant que les problèmes politiques ne sont en dernière instance que des problèmes « techniques », pour lesquels il n’y a qu’une seule solution rationnelle optimale (« there is no alternative »).
Existe-t-il un lien entre le libéralisme et « l’idéologie du même » que vous pourfendez ? Le libéralisme contribue-t-il à la disparition de l’altérité et à l’avènement de ce que le philosophe tchèque Jan Patočka nomme « l’âme fermée » ?
Je pense que le libéralisme contribue en effet à la disparition de l’altérité, d’abord parce qu’il ne reconnaît que les différences individuelles, et non les différences collectives, ensuite parce ses fondements individualistes vont inévitablement de pair avec un universalisme de fait, au regard duquel les hommes sont fondamentalement les mêmes. Le seul fait de dessaisir l’homme de ses appartenances au profit d’un homme abstrait, de partout et de nulle part, montre qu’aux yeux des théoriciens libéraux les différences collectives, entre les peuples, les nations ou les cultures, ne peuvent qu’être secondaires, superficielles ou transitoires. Nous apparaissons certes différents, mais au fond nous sommes les mêmes ! C’est pour cela que le libéralisme estime qu’une bonne Constitution est bonne pour tous les peuples, comme le disait Condorcet, que le monde entier peut être transformé en un vaste marché planétaire régi par les seules lois du marché, que les droits de l’homme sont valables en tous temps et en tous lieux, etc.
Les démocraties libérales traversent aujourd’hui une crise profonde. L’émergence et l’arrivée au pouvoir de mouvements dits populistes, mais également la mobilisation des gilets jaunes ou l’apparition de voix dissonantes dans les médias, le milieu associatif et l’université, le montrent bien. Êtes-vous d’accord pour dire que le libéralisme est une idéologie en déclin ?
Je ne dirais pas encore que le libéralisme est en déclin, mais qu’il est en crise, et que cette crise a de bonnes chances d’annoncer son déclin. La crise en question touche à la fois les institutions politiques et le système économique capitaliste. La démocratie libérale, fondée sur l’« Etat de droit », que beaucoup considéraient comme indépassable, est en train de s’effondrer du fait de la défiance généralisée des sociétaires. Elle était à la fois représentative et parlementaire. Or, les gens constatent que les représentants ne représentent plus grand-chose et que la souveraineté parlementaire s’est substituée à la souveraineté populaire. Du même coup, les mots de « démocratie » et de « libéralisme » ne sont plus synonymes ; on redécouvre au contraire qu’ils correspondent à des choses complètement différentes. La démocratie place la légitimité dans la souveraineté populaire, alors que le libéralisme place l’exercice du jeu démocratique sous conditions en plaçant les « droits » au-dessus du peuple. Les gens ne font plus confiance aux partis, et il est significatif que le mouvement des gilets jaunes soit apparu en marge des partis comme des syndicats. La crise de la démocratie libérale a d’abord nourri l’abstention, après quoi elle a favorisé la montée des mouvements dits « populistes », montée qui se fait au détriment des anciens partis traditionnels, dits « de gouvernement », qui s’effondrent aujourd’hui comme des châteaux de cartes. Ces partis ayant été les vecteurs essentiels du clivage horizontal gauche-droite, un nouveau clivage apparaît, de nature verticale, qui oppose les classes populaires et les classes moyennes en voie de déclassement au bloc bourgeois des élites transnationales mondialisées (voir les travaux de Christophe Guilluy et Jérôme Sainte-Marie, pour ne citer qu’eux).
Mais le système capitaliste est lui-même menacé par ses contradictions internes. La recherche de gains de productivité exigée par la concurrence aboutit à ce que l’on produit toujours plus de biens et de services avec toujours moins d’hommes. L’omnipotence de l’argent, qui a d’abord favorisé le système du crédit, a abouti à un endettement généralisé qui atteint désormais des sommets jamais vus. Le capitalisme a perdu ses anciens ancrages nationaux pour devenir purement spéculatif et totalement déterritorialisé. S’ajoutent encore à cela les problèmes écologiques (il n’est plus possible de croire que les réserves naturelles sont inépuisables et gratuites). Nombreux sont les observateurs qui s’attendent aujourd’hui à une nouvelle crise financière mondiale beaucoup plus grave que celle de 2008. Je ne peux ici qu’effleurer le sujet, mais la concordance de ces deux crises majeures, l’une politique, l’autre économique, laisse évidemment prévoir des basculements décisifs dans les années qui viennent.
Nous estimons dans notre association que le pouvoir se gagne par les idées. Sur quelles grandes figures intellectuelles recommanderiez-vous de s’appuyer afin de mener la bataille culturelle contre le libéralisme ?
J’aimerais bien que le pouvoir se gagne par les idées ! Le problème est que la façon dont les idées exercent une influence et finissent par s’imposer est tout sauf simple. Les hommes politiques n’aiment pas beaucoup les idées, car ils veulent rassembler alors que les idées divisent. C’est la raison pour laquelle ils ne s’intéressent aux idées que lorsqu’ils peuvent les instrumentaliser à leur profit. Et c’est aussi la raison pour laquelle, après avoir parfois tenté d’avoir la stratégie de leurs idées, ils finissent si souvent par n’avoir plus que les idées de leurs stratégies. Cela dit, je n’en pense pas moins, comme vous, que rien ne remplace le combat des idées. Quant à vous recommander telle ou telle grande figure intellectuelle, je préfère y renoncer : il y en a trop ! Reportez-vous éventuellement aux auteurs dont je présente les œuvres dans mon livre Ce que penser veut dire, paru récemment aux éditions du Rocher. Il y a de toute façon bien des valeurs sûres, que vous connaissez déjà sûrement : Jean-Claude Michéa, Christopher Lasch, Jean Baudrillard, Louis Dumont, Julien Freund, Carl Schmitt, Heidegger et tant d’autres.
Pour l’instant, aucune alternative n’émerge au-delà de l’échelle locale. La décroissance que vous appelez de vos vœux n’est-elle pas invendable (auprès de populations qui restent globalement attachées à la société de consommation) et utopique au regard des forces économiques en présence ?
Vous n’avez pas tort : la décroissance est tout à fait « invendable » auprès de beaucoup de gens, et plus encore auprès des hommes politiques qui font tous assaut de prétentions pour « ranimer la croissance » ! Cela peut paraître désespérant, mais la justesse d’une idée ne dépend pas de l’accueil qu’elle est susceptible de recevoir à tel ou tel moment. Si la théorie de la décroissance est juste, si elle est fondée, elle finira par s’imposer au moment où il deviendra impossible de ne pas envisager cette option. Il est vraisemblable qu’on déplorera alors de ne pas l’avoir envisagée plus tôt, ce qui aurait évité des tournants catastrophiques. La théorie de la décroissance dit que le système actuel n’est plus réformable, qu’il va dans le mur. Si le mur est bien là, il n’est pas du tout utopique de dire qu’il existe effectivement !
Selon Régis Debray, ceux qui ont appuyé le projet de construction européenne depuis la Seconde Guerre mondiale considèrent que « le propre de l’Europe est de ne pas avoir de propre ». Alors que l’Europe s’abandonne au nihilisme et à l’oubli de soi, pourriez-vous revenir sur ce qui fonde le sentiment européen et l’identité de l’Europe ?
L’opinion de Régis Debray est, je crois, partagée par beaucoup d’autres. Le fait est que tout se passe comme si l’Europe voulait en quelque sorte se délester d’elle-même. Les polémiques suscitées récemment par la nomination, à la Commission européenne, d’un commissaire chargé de la « protection du mode de vie européen » sont révélatrices. Un mode de vie européen, qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ! Tout aussi significativement, les polémiques ne se sont apaisées que lorsqu’on a laborieusement expliqué que le « mode de vie européen » consiste en fait à accepter tous les autres modes de vie (il suffisait d’y penser) ! L’Europe ne veut rien avoir en propre qui puisse servir de modèle parce qu’elle se veut porteuse de « valeurs universelles » qui, comme par hasard, sont aussi des valeurs libérales. Etant « universelles », elles sont elles aussi de partout et de nulle part. En se présentant comme « ouverte à l’ouverture », c’est-à-dire ouverte à tout, l’Union européenne fait l’aveu de son impuissance et de sa soumission à l’idéologie dominante. Il n’en est que plus nécessaire, en effet, de réaffirmer un sentiment européen susceptible de s’inscrire dans une continuité historique reliant le passé à l’avenir. L’Europe est une histoire associée à un espace territorial. Son identité trouve son fondement dans la communauté d’appartenance et d’origine de la plupart des pays qui la composent. Mais cette identité ne doit pas être essentialisée : c’est une substance, pas une identité. L’identité n’est pas ce qui ne change jamais, mais ce qui nous permet de changer tout le temps tout en restant nous-mêmes. Nietzsche disait qu’on « ne ramène pas les Grecs » ; on peut en revanche prendre exemple sur eux pour être aussi novateurs qu’ils le furent en leur temps. L’identité en fin de compte, n’est pas tant ce que l’on est que ce que l’on fait de ce que l’on est.
Pour finir sur une note d’actualité, la marche contre l’islamophobie d’il y a deux semaines a mis en lumière une fois de plus l’ampleur des fractures françaises et la sécession culturelle croissante d’une partie des Français de confession musulmane. Sur quoi pouvons-nous encore nous appuyer pour résister à la montée de l’islamisme, au-delà des incantations creuses sur les « valeurs de la République » ?
La force de l’islamisme n’est que le reflet de nos faiblesses. Il ne sert à rien de déplorer l’évidente « sécession culturelle croissante d’une partie des français de confession musulmane » si nous sommes nous-mêmes incapables de réanimer un lien social porteur de valeurs partagées. C’est précisément là que l’on retrouve le libéralisme, qui est l’un des principaux responsables de la destruction des anciennes structures organiques. La société des individus est une société fracturée, effritée, atomisée, où les gens vivent à la fois dans une solitude croissante et dans une « guerre de tous contre tous ». C’est une société de manque, une société où le principe de plaisir a pris le pas sur le principe de réalité. Faire face aux dangers qui menacent implique d’en finir avec cette société et de nous reconstruire nous-mêmes.
Alain de Benoist (Critique de la raison européenne, 26 novembre 2019)