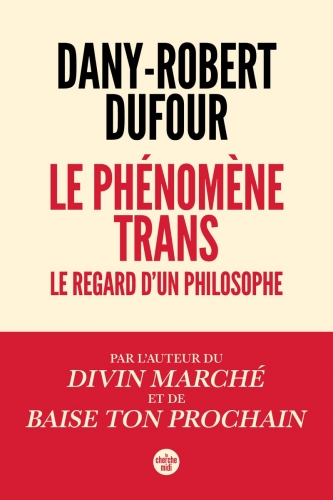Libéralisme contre libéralisme
Libéralisme et capitalisme ont eu partie liée. Ce n’est plus le cas. En Europe comme ailleurs, un capitalisme totalitaire devient la première menace qui pèse sur nos démocraties et restreint nos libertés.
Un vieux clivage
Pour deux siècles, Benjamin Constant avait fixé le cadre du débat ; « la liberté politique est la liberté des Anciens, la liberté de l’individu est la liberté des Modernes ». Entre anciens et modernes, entre souverainistes et mondialistes, entre tenants de l’autonomie des Nations à faire leurs lois et à respecter leurs mœurs, et apôtres de l’universalisme du droit et des droits, s’est résumé le débat politique qui nous a si longtemps tenus éveillés. Mais voilà qu’une autre ligne de fracture vient transformer en profondeur le débat. Au vieil affrontement entre le libéralisme politique, celui de la liberté des peuples, exprimé par le principe majoritaire et le suffrage universel accordé à tous les citoyens, et le libéralisme de l’individu, celui des libertés individuelles, exprimé par l’État de droit et les droits de l’Homme, oublieux du citoyen, succède l’affrontement entre le libéralisme et le capitalisme. Un capitalisme sorti des mœurs et des lois, des frontières et des Nations est devenu la plus grande menace qui pèse sur nos libertés publiques comme privées.
Le capitalisme est sorti de son lit. C’est ce que l’incroyable accumulation de richesse par les géants du numérique américain dit aussi bien que l’ascension, puis la chute, des magnats du numérique et des réseaux en Chine. C’est ce que signifie le privilège insolent du capital, désormais immune du politique, à l’abri du vote comme des décisions gouvernementales, au titre des accords internationaux de libre-échange signés par l’Union européenne qui protègent le capital et son rendement au point de faire porter sur le contribuable le coût de toute décision, par exemple sociale ou environnementale, qui porterait atteinte au rendement attendu d’un investissement. Et c’est ce que nous disent à la fois le grand désordre qui s’étend aux États-Unis, et le grand retour au patriotisme économique qui secoue la Chine et fait rendre gorge à ceux qui ont cru édifier leur fortune sans le peuple, ou contre lui. Qui a dit que l’égalité devait fixer des limites à la liberté économique ?
Le communisme en a rêvé, les GAFAM l’ont fait
Que s’est-il passé ? Ni révolution dans la rue, ni coup d’État à sensation, mais un changement de nature de ce que nous appelons encore démocratie sans mesurer à quel point le mot s’est vidé de son sens. C’est le numérique qui a donné au capitalisme ce caractère totalitaire que les limites des Nations, des ressources et des organisations lui interdisaient de prendre. Deux révolutions sont passées sous silence :
D’abord, le fait que les techniques de traitement de masse de données pratiquement infinies rendent possible la planification intégrale ; ce que les régimes communistes avaient échoué à faire, faute de moyens techniques adéquats, Amazon ou Google peuvent le faire, mais alors que les régimes socialistes affirmaient le faire au bénéfice du peuple Amazon ou Google le font au bénéfice de leurs seuls actionnaires.
Ensuite, le fait que la maîtrise de l’information acquise du fait de l’Intelligence artificielle et des algorithmes permet de fabriquer l’opinion, de susciter des états de conscience, bref, de modifier la perception du Bien et du Mal dans un sens unique et facile à identifier — à condition de s’en tenir à distance. Le numérique permet au capital de fabriquer la vérité — d’imposer sa vérité. Résumons en quelques mots ; tout ce qui vient de l’État est mal, tout ce qui vient du privé est Bien.
Les milliardaires du Net font le Bien de l’humanité ; leurs fondations et les ONG qu’ils financent, généralement avec l’argent accumulé dans des paradis fiscaux ou acquis en ruinant les classes moyennes de leur pays d’origine, ne peuvent être mises en cause. La justice n’a rien à voir avec le capital et les revenus ; les pauvres doivent tout à la charité des riches. D’ailleurs qui n’est pas ému par la bonté d’âme des Soros, Gates et cie ? Les exemples criants de manipulations d’opinion sont partout. Citons seulement les coûts écologiques de ces voyages dans l’espace dont les Branson, Musk et cie semblent faire leur nouveau jouet — et dont personne ne dénonce les impacts désastreux. Citons encore la volonté, affichée par Gates, Bezos et quelques autres, de lancer l’exploitation du Groenland et des terres australes, piétinant un consensus que l’on croyait acquis sur la préservation de ces terres vierges et surtout, fragiles.
Et citons encore l’extraordinaire impunité dont bénéficient des opérateurs modernes d’une censure dont l’arbitraire n’a d’égale que la partialité, mais dont aucun gouvernement, en dehors de la Chine, n’est parvenu à leur imposer les sanctions qui sauveraient cette condition de la démocratie ; la liberté d’opinion. Pour conclure ; nous vivons un nouveau temps des « robber barrons », ces Vanderbilt, Pierpont Morgan et autres bâtisseurs d’empires par le crime et la fraude, mais pardonnés parce qu’ils construisaient des bibliothèques ! Mais à quand la loi sur l’enrichissement sans cause, qui brisera leurs empires ?
L’économie emportée par un capitalisme intégral est devenue totalitaire. Elle a plus à voir avec la croyance qu’avec l’économie, la société et bien sûr, la politique. Et c’est bien en cela que cette économie du capitalisme est totalitaire ; elle avale tout ce qui n’est pas elle. L’extension du domaine du marché à tout ce qui vit, de la reproduction humaine à la lutte contre les pandémies, comme l’illustre l’indécente fortune accumulée par les big pharma sous prétexte du Covid, est spectaculaire ; comme est spectaculaire la constitution de monopoles privés qui remplacent les monopoles d’État.
Pour sortir de cette situation qui menace plus encore que les libertés, la vie elle-même, la première solution est de rendre aux populations leurs biens communs, des autoroutes à La Poste et des chemins de fer aux hôpitaux ; à eux d’en devenir associés propriétaires, à eux de décider de leurs conditions d’exploitation et du rendement qu’ils en attendent. La seconde est d’affirmer la priorité de l’indépendance stratégique, et de la décliner dans tous les secteurs où l’intérêt de la Nation est en jeu. La dernière appelle une tout autre dimension. Celle du sacré. Et comment ne pas paraphraser Heidegger ; face à l’être de la technique déchaîné par la cupidité privée, pouvons-nous faire autre chose que créer les conditions pour qu’à nouveau, le sentiment du sacré nous emplisse de respect, de crainte et de retenue ?
Hervé Juvin (Site officiel d'Hervé Juvin, 15 septembre 2021)