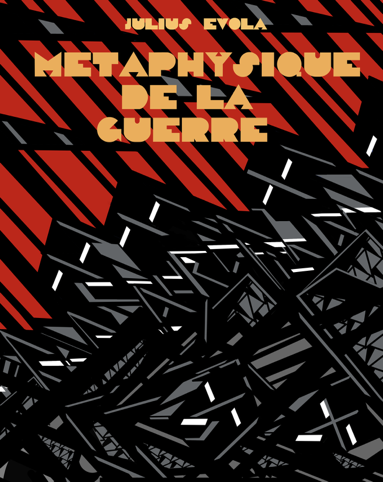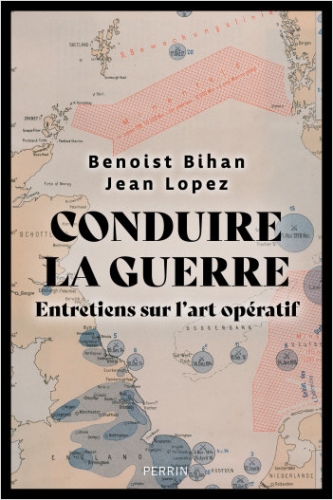La Guerre Sainte des démocraties, face au choc des réalités
A propos de la guerre d’Ukraine, la question d’un grand affrontement entre démocraties et régimes autoritaires a été soulevée. Beaucoup en sont convaincus dans ce qu’on appelle un peu rapidement l’Occident. La réalité est autrement plus nuancée.
On le voit déjà au niveau planétaire : si une majorité nette de pays a condamné l’invasion russe de l’Ukraine, seuls les Occidentaux ont décidé des sanctions. Entre les deux lectures possibles ‘occidentales’ du conflit ukrainien (agression contre un Etat, ou lutte du bien et du mal), la première se révèle bien plus féconde internationalement. La grande majorité des pays hors ‘Occident’, démocraties comprises, ne se sent pas impliquée par une idée de grande croisade contre des forces antidémocratiques. D’autant qu’ils ne se sentent pas menacés par la Russie. La situation est sur ce point nettement différente de celle de l’URSS, qui avait un programme idéologique et pouvait s’appuyer sur des forces locales plus ou moins classées comme révolutionnaires, de sorte qu’à côté de la menace militaire éventuelle, limitée à certaines zones, on craignait une menace idéologique bien plus large.
Ce qui veut dire concrètement que la prétention des Occidentaux à représenter un camp qui serait celui de la démocratie est de fait contestée. Bien des pays considèrent d’ailleurs à tort ou à raison que la menace d’une intervention occidentale, notamment américaine, idéologique ou à prétexte idéologique, est pour eux plus sérieuse que la menace des autres, et en tout cas plus étayée par l’expérience. On peut ajouter que la définition même du camp des démocraties n’est pas vraiment évidente. Comme chacun sait, dans le camp dit occidental de nombreux régimes non-démocratiques ont trouvé et trouvent tranquillement place.
Du côté des Etats classés autoritaires (Chine, Russie, Iran et autres) la situation est loin d’être simple ou uniforme. Partout il y a une ligne officielle, plus ou moins idéologique, et à forte composante nationaliste. Mais c’est à usage interne, et de façon très différenciée. Si la Chine présente à l’évidence une situation spécifique, en cela que l’idéologie marxiste y est supposée rester une référence interne majeure, et qu’un parti communiste y est parti unique, ce n’est pas un produit d’exportation, au moins actuellement et à vue humaine. De même a fortiori pour la Corée du Nord. Quant à la Russie actuelle, le régime, de fait de plus en plus autoritaire, ne met pas en avant de modèle politique original pouvant servir d’exemple, en dehors du simple fait de ce caractère autoritaire. Corrélativement, ce pays ne se signale pas par une grande originalité idéologique. Certes il se présente comme divergeant du monde occidental sur plusieurs sujets, comme les questions de société et de mœurs, mais cela ne constitue pas une alternative politique. On ne se rapproche d’une forme d’idéologie prosélyte qu’avec l’Iran, mais ce n’est qu’un cas parmi d’autres dans le monde musulman ; et la dimension iranienne d’un côté, chiite de l’autre, apparaît très largement prépondérante dans son action extérieure.
Il apparaît donc en définitive que du point de vue des idées et du régime le rapprochement entre Russie, Chine et Iran est passablement circonstanciel, et largement dû à l’existence d’un adversaire commun, occidental. On ne saurait discerner de véritable impérialisme idéologique de leur côté.
Cela ne les classe évidemment pas comme des petits saints. Il y a chez les uns ou les autres une propension évidente au débordement de puissance, de sorte que dans leur opposition commune aux Occidentaux (en fait, aux Américains) le discernement entre cause et effet soit sujet à débat. Mais ne n’est pas l’effet d’un antagonisme idéologique irréductible, du moins vu de leur côté et de celui des tiers. La volonté de puissance est une chose, l’idéologie une autre. Inversement bien sûr, de trop grands succès de leur côté favoriseraient sans doute un modèle autoritaire de régime ici ou là, mais cela pourrait prendre des formes très variables, faute de modèle.
Il est par ailleurs patent que la propension occidentale, ou plutôt américaine, à la recherche régulière de l’instauration de la démocratie par la force, est à la fois remarquable par son inefficacité et, à nouveau, une cause majeure de la crainte que cette manie instille non moins régulièrement un peu partout. Le monde arabe a été comme chacun sait le lieu le plus caricatural de la démonstration, le cas du malheureux Iraq étant ici emblématique. Cette démocratisation avait pourtant eu l’air d’opérer après 1945 en Allemagne et au Japon, mais c’était après une guerre à mort radicale, et dans une mesure importante dans les deux pays on renouait avec des situations antérieures à leur dérive agressive. Et en tout cas cet interventionnisme ne fonctionne pas ailleurs. D’autant moins que, comme on l’a dit, dans la perception générale hors Occident la volonté de puissance du supposé libérateur l’emporte sur les motivations démocratisantes affichées. En bref, l’affichage démocratique est ruiné par son identification de fait avec ce qui est perçu à tort ou à raison comme un impérialisme. C’est manifeste notamment en Afrique ou au Moyen Orient, ou sous une forme plus modérée en Amérique latine. Et même là où la dimension stratégique peut favoriser l’identification au camp occidental, voire à la démocratie, celle-ci n’est pas vécue comme une copie impliquant la solidarité – ainsi en Asie du Sud et du Sud-Est.
Est-ce à dire qu’il n’y ait pas en la matière de soft power ? Ou que les thèmes idéologiques soit sans effet ? Evidemment non. Il est évident que le thème de la démocratie ou plus encore celui de la liberté ont une audience et une résonance, éventuellement fortes. Mais sur ce plan le facteur essentiel reste les évolutions politiques internes, qui peuvent bien sûr être facilitées par une action de rayonnement si elle est appropriée. A condition de ne pas insister sur des facteurs répulsifs comme l’idéologie woke, et cette manie de vouloir imposer une vision des mœurs qui répugne à la plupart des cultures.
On peut noter par ailleurs qu’en matière économique, notamment de commerce international, une attitude apparemment inverse a prévalu côté occidental. Mais elle était en réalité tout aussi idéologique, et non moins contestable. Toujours par idéologie, on a en effet poussé activement à une ouverture maximale des frontières douanières et autres, et à l’entrée de la Chine puis de la Russie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), sans aucune réflexion sur la dimension pourtant évidemment stratégique d’un tel commerce, et sur le besoin de se protéger de ces partenaires qu’on vilipendait par ailleurs. Car on croyait avec une naïveté confondante que le « doux commerce » allait déboucher sur la paix, et surtout, dans les pays concernés, sur la démocratie. Le résultat de cette illusion a été de donner à la Chine le moyen d’un formidable bond en avant qui en a fait l’usine de la planète et un compétiteur stratégique de premier plan.
La mythologie de la supposée croisade des démocraties contre les forces du mal, et le mélange des genres entre relations de puissance et idéologie, sont donc en résumé contre-productives de façon générale, et cela du point de vue même de ses promoteurs. Certes, au niveau international, la dimension idéologique n’a pas disparu, mais à l’époque actuelle ce qui domine est le polycentrisme des puissances, le développement de chacun dans sa logique propre. Face à cette réalité, on ne peut qu’être frappé par le contraste avec le rôle subsistant de l’idéologie dans la vie politique dans ce qu’on appelle Occident. Y compris d’ailleurs au niveau interne, que ce soit par son utilisation croissante par la construction européenne au détriment des réalités nationales, ou par son rôle ravageur dans le déchirement interne américain. Mais en tout cas, sous sa forme conquérante et agressive ce n’est pas un très bon article d’exportation.
Conséquemment, dans le cas de la guerre d’Ukraine le déterminant principal pour l’attitude à tenir n’est pas la nature des régimes (ce qui n’empêche pas d’avoir une opinion critique sur eux et leurs comportement, et de l’exprimer), mais la dimension internationale, qu’il s’agisse de considérations de droit, d’évaluation des rapports de forces réels ou espérés, ou de la paix possible.
Pierre de Lauzun (Geopragma, 16 mars 2023)