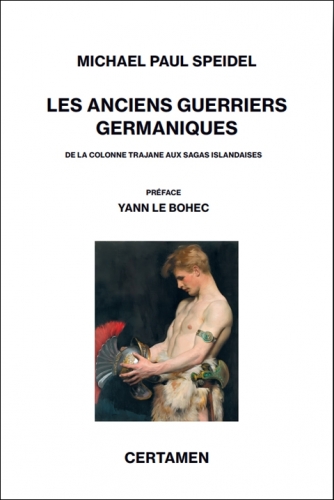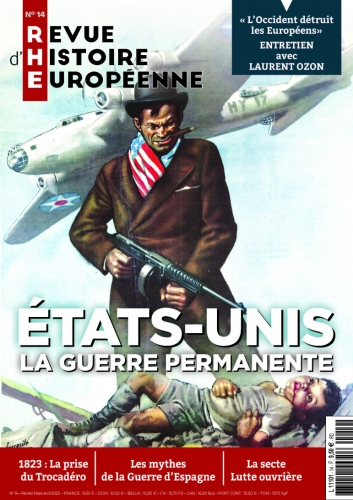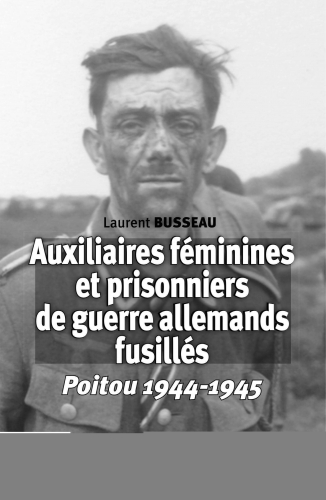Il y a un débat public, pas toujours clair et généralement étouffé par la propagande de guerre, à propos du conflit en Russie et Ukraine, conflit qui remonte maintenant à près de 10 ans, les troupes russes ayant envahi la Crimée au mois de février 2014. Les accords de Minsk, signés en 2015 entre la Russie et l’Ukraine, avec l’intervention de Hollande et Merkel n’ont fait que reculer la guerre ouverte.
Je ne veux pas m’engager dans la confrontation des récits de ces 10 dernières années, récits contradictoires : pour les uns, il s’agit d’une guerre défensive menée par la Russie menacée par l’Occident et, pour les autres, il s’agit d’une agression russe contre l’Ukraine, pour assouvir le dessein chauvin grand-russe d’un Poutine qui veut reconstituer la grande Russie, autant que possible dans les frontières de l’ex-Union soviétique. Les premiers font valoir les livres de Brzeziński, qui constitueraient le programme suivi par les États-Unis et permettraient ainsi d’éclairer le conflit, les seconds pourraient voir en Poutine celui qui accomplit le programme de Soljenitsyne de restauration de la « grande Russie », mais ils ne le font tant ils ont par le passé encensé le grand écrivain. On a vu ressurgir à cette occasion la vieille idéologie rance du « panslavisme » défendu par Alexandre Douguine, un philosophe dont la fille fut assassinée dans des conditions mystérieuses – le crime fut évidemment attribué aux services ukrainiens, mais il pourrait s’agir de règlement de comptes au sein de la caste dirigeante, le panslavisme n’étant pas, et de loin, l’idéologie dominante chez les oligarques.
Je préfère ici m’en tenir aux quelques faits indiscutables – en évitant les récits et les spéculations des politiciens et des stratèges internationaux qui ont tendance à présenter leurs propres spéculations et leurs propres interprétations comme des vérités indiscutables. Et des faits admis, je voudrais me contenter que rappeler quelques grands principes de droit.
On le sait bien, la discussion sur les responsabilités d’une guerre est toujours une affaire fort polémique. Hannah Arendt rapporte une boutade de Clemenceau : « Durant les années vingt, Clemenceau, peu avant sa mort, se trouvait engagé dans une conversation amicale avec un représentant de la république de Weimar au sujet des responsabilités quant au déclenchement de la Première Guerre Mondiale. On demanda à Clemenceau : “À votre avis, qu’est-ce que les historiens du futur penseront de ce problème embarrassant et controversé ?” Il répondit : “Ça, je n’en sais rien, mais ce dont je suis sûr, c’est qu’ils ne diront pas que la Belgique a envahi l’Allemagne.” » L’histoire du mensonge au XXe siècle a montré que Clemenceau était exagérément optimiste. Si on revient au cas ukrainien, le fait est que le 25 février 2014, la Russie a envahi la Crimée et organisé un référendum qui a abouti au rattachement de la Crimée à la Russie. C’est le point de départ des événements qui vont se dérouler dans le Donbass et aboutiront en 2015 aux accords de Minsk. Il y a un autre fait non moins incontestable, c’est que c’est la Russie a envahi le quart du territorie ukrainien le 24 février 2022. Savoir si la Russie avait de bonnes ou de mauvaises raisons de le faire, savoir si les États-Unis avaient ou non entrepris de déstabiliser ce pays gigantesque qui n’a plus rien à voir avec l’URSS de jadis, c’est une autre affaire.
Du point de vue du droit international tel qu’il a été inventé en 1648 par les traités de Westphalie qui ont mis fin à la guerre de Trente ans, la Russie a juridiquement tort. On pourra difficilement déclarer Poutine irresponsable. On peut lui chercher des circonstances atténuantes ou resituer tout cela dans le récit historique ou philosophico-historique, cela ne change rien aux faits, et, comme le disait Lénine, « les faits sont têtus ».
Il y a une autre question de principe, la question du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, revers de la médaille de la souveraineté nationale. Nous ne pouvons pas défendre la souveraineté nationale de la France et dénier celle de l’Ukraine. Même si le gouvernement de ce pays n’est pas très reluisant et s’il est fort corrompu, nous devons reconnaître la souveraineté de l’Ukraine. De la même façon que les horreurs dont s’était rendu coupable Saddam Hussein ne pouvaient justifier l’invasion de l’Irak en 2003, pour ne citer qu’un exemple. Le « droit d’ingérence » est une minable tentative faite par une bande de politiciens d’extrême-gauche ralliés aux « néocons » américains pour donner un vernis « humanitaire » aux diverses opérations militaires depuis les bombardements « humanitaires » sur Belgrade, les opérations en Afghanistan, et d’autres encore. La situation en Ukraine n’autorisait pas plus la Russie à intervenir, même si les minorités russophones et russophiles (ce n’est pas la même chose) étaient en butte à la répression organisée par les dirigeants de Kiev.
On ne peut pas avoir des principes à géométrie variable. Je sais bien qu’il y a une vieille russophilie française qui s’entretient de la nostalgie de l’Union soviétique, du regret de son effondrement, qui expliquent que les vieux staliniens et cryptostaliniens reportent aisément les sentiments qu’ils avaient envers l’URSS sur les nouveaux maîtres du Kremlin. Mais cela ne justifie pas qu’on change de principes quand il s’agit de faits qui mettent en cause Poutine et son régime dont l’orientation de plus en plus autoritaire n’a cessé de s’affirmer.
On n’oublie évidemment pas le double jeu et les manœuvres permanentes du gouvernement des États-Unis, qui serait fort heureux de déstabiliser complètement l’Europe pour pouvoir préparer le coup suivant : son règlement de comptes avec la Chine. Sachant tout de même que pour ce dernier enjeu, il est sûrement trop tard et que les rapports de forces internationaux sont complètement bouleversés. Les États-Unis entretiennent les conflits comme des moyens d’essayer de se maintenir à flot, alors qu’ils sont déjà entrés dans la spirale du déclin, comme l’Europe, d’ailleurs.
Dans l’idéal, il faudrait exiger l’arrêt des hostilités, le retrait des troupes russes sur les frontières d’avant 2014 et l’organisation sous contrôle international de référendums dans les provinces du Donbass et de Crimée qui permettraient à ces peuples de choisir librement, sous la menace d’aucun fusil, ni russe, ni ukrainien, s’ils veulent rester ukrainiens – éventuellement avec un statut spécial – devenir indépendants ou rejoindre la république fédérative de Russie. Ce serait la seule solution conforme au droit international.
Malheureusement, le droit international étant ce qu’il est, c’est-à-dire un droit sans force, cette hypothèse est fort improbable dans l’immédiat. Que pouvons-nous faire ? En vérité, peu de choses, sinon spéculer sur les intentions des uns ou des autres. Entre les exégètes de la pensée de feu Brzeziński et les kremlinologues qui lisent dans les pensées de Poutine, on ne sait plus où donner de la tête !
Il me semble cependant qu’on peut se mettre d’accord sur des exigences minimales. La première étant celle d’un cessez-le-feu. Comme le dit Kant, il n’y aucun droit de guerre, la guerre est le contraire du droit et donc il faut l’arrêter. Pour qu’il y ait un cessez-le-feu, il faut cesser de nourrir la guerre et donc refuser de devenir « cobelligérants » en envoyant des armes, des armes dont tout le monde sait par ailleurs qu’elles ne font qu’entretenir la guerre. Si nous avions un gouvernement soucieux des intérêts du peuple, et de la paix, il ferait tout son possible pour favoriser les négociations entre les deux parties en guerre. Quitte à paraître naïf, il faut lever, au moins partiellement les sanctions contre la Russie, sanctions inefficaces qui ne favorisent que les Russes et les Américains et donc les nations d’Europe sont les premières victimes et même les seules victimes.
L’attitude agressive à l’égard de la Russie ne sert que le régime de Poutine. Et tous les autres régimes, car l’entretien permanent de la menace guerrière est une des ressources essentielles de toutes les tyrannies. Nous aussi, nous subissons notre « quart d’heure de la haine », comme dans 1984. La guerre contre la Russie vient à point remplacer la guerre au COVID… Une politique d’ouverture, publiquement proclamée et adressée à l’opinion russe, par-delà ses gouvernants, pourrait être fort efficace pour faire reculer le pouvoir en place et ouvrir la marche vers la paix, dans le respect des principes de souveraineté nationale.
Je lance une flèche. La ramasse qui peut.
Denis Collin (La Sociale, 7 février 2023)