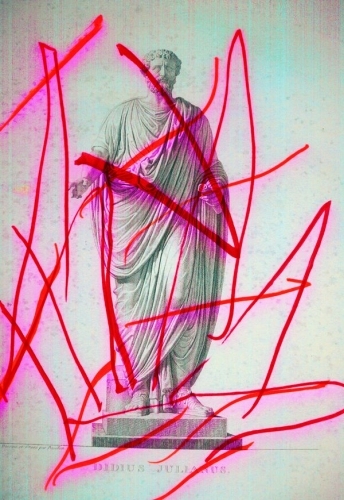Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Balbino Katz, le chroniqueur des vents et des marées, cueilli sur Breizh-Info et consacré à l'incapacité persistante de la gauche à ouvrir les yeux sur la réalité de l'immigration...

Immigration. La gauche face au réel, ou la noble impuissance de Philippe Bernard
Le vent devait venir du sud-ouest, sans doute, car la mer se levait en nappes sombres et sonores tandis que je tentais de marcher sur la digue de Lechiagat. À chaque rafale, j’avais l’impression d’être soulevé par la bourrasque comme un brin de varech. Renonçant à cette entreprise héroïque, je me suis réfugié au café des Brisants, ce repaire de demi-silence où les pêcheurs observent la météo comme on consulte une oracle capricieuse. Dehors, un vrai temps de chiottes, un rideau de pluie comme un mur liquide. Dedans, un peu de chaleur, une odeur de café brûlant, et Le Monde posé sur le comptoir.
C’est là que j’ai lu la chronique de Philippe Bernard, « Immigration : sortir la gauche du silence », publiée dans Le Monde du 22 novembre 2025 . Je ne lis pas souvent les chroniques du quotidien du soir sans y percevoir quelque gauchisme de confort, ce mélange de bonne conscience et d’aveuglement moral dont la gauche française s’est tant nourrie. Pourtant, il faut reconnaître ici à Bernard une qualité devenue rare : la probité. Il tente ce que si peu tentent encore, c’est-à-dire une critique interne, exigeante, presque douloureuse de son propre camp.
Cela seul mérite d’être salué.
En regardant les vagues heurter le musoir comme si elles voulaient en arracher les pierres, j’ai pensé que Bernard, lui aussi, frappe contre un mur dur, une fortification idéologique presque infranchissable : la gauche française et son incapacité quasi existentielle à regarder l’immigration en face.
Son texte le dit à mots précautionneux, presque embarrassés, mais il le dit. Il note, par exemple, que les chiffres de l’immigration, qu’il récapitule avec honnêteté, hausse du taux d’étrangers depuis 1999, doublement des premiers titres de séjour entre 2007 et 2024 produisent dans une partie du pays un réflexe d’angoisse, de rejet, ou simplement de lassitude. Et il dit ce qui est insupportable à une partie de son lectorat: la gauche refuse de regarder ces données, et en refusant de les voir, elle abandonne les classes populaires à d’autres discours, parce qu’elles sentent déjà dans leur vie concrète ce que les rédactions parisiennes refusent d’admettre.
Cette phrase pourrait être de Raymond Aron : « Ce n’est pas parce que les faits déplaisent qu’ils cessent d’être des faits. »
Bernard ajoute, et c’est bien vu, que les responsables de gauche, au lieu de commenter sérieusement des enquêtes inquiétantes (par exemple, la proportion de musulmans jugeant que la loi religieuse prime sur la loi républicaine, page 3) , préfèrent répondre par des mantras, des messages de « fraternité », des incantations. C’est toute la politique française qui se résume là, en une scène minuscule : une question brûlante posée sur France Inter, et un député qui esquive, qui contourne, qui fuit, comme si le réel était un piège dressé par l’extrême droite.
Ce réflexe révèle, plus profondément, une structure psychologique. La gauche française n’a jamais vraiment su penser la nation, encore moins sa continuité culturelle et historique. Jean Jaurès lui-même, que Bernard cite en évoquant sa phrase du 28 juin 1914 sur le « grave problème de la main-d’œuvre étrangère », avait dû composer avec cette tension interne entre internationalisme et responsabilité nationale. Sa clarté, aujourd’hui, n’est plus audible : ceux qui l’invoquent se gardent bien de lire réellement son œuvre.
Je dois rendre à Philippe Bernard que son diagnostic est le bon. Il écrit avec une honnêteté presque mélancolique, dépouillée de ces indignations convenues qui servent d’habitude de feuille de vigne à la gauche morale. Il tente quelque chose qui, pour qui a lu l’histoire politique humaine, ressemble à une entreprise tragique : faire appel à l’intelligence d’un camp politique contre lui-même. Lui rappeler que nier le réel ne le dissout pas. Lui rappeler que refuser de nommer un phénomène l’amplifie. Lui rappeler que le silence n’est pas une posture, mais un abandon.
C’est noble. Et c’est vain.
Je regardais, en écrivant ces lignes, les gouttes de pluie fouetter sans relâche la vitre du café. Il y avait dans cette obstination quelque chose qui rappelait la chronique elle-même. Une sorte d’effort sincère, répétitif, butant contre un monde qui ne veut pas entendre. Un effort admirable chez celui qui l’accomplit, désespéré quant à ses effets.
La gauche française ne souffre pas d’un déficit d’informations. Ni d’un manque de talents. Ni même d’un manque d’intelligence — il serait faux et injuste de le dire. Elle souffre d’une maladie plus grave : l’incapacité psychique à affronter la réalité lorsqu’elle contredit la vision morale qu’elle a d’elle-même. Hannah Arendt écrivait que « le mensonge est l’ultime refuge de ceux qui ne veulent pas affronter le poids du monde ». Le déni n’est pas une position politique : c’est une forme de fuite.
Philippe Bernard a tenté d’ouvrir une fenêtre. Il n’est pas certain que quelqu’un, dans son camp, veuille s’en approcher.
Dehors, le vent redoublait ; la mer aussi.
Et la gauche, une fois encore, détournait les yeux.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées (Breizh-Info, 24 novembre 2025)