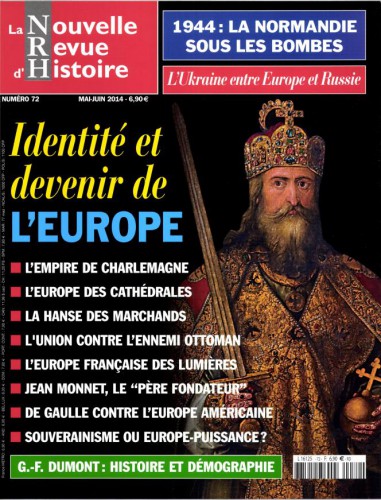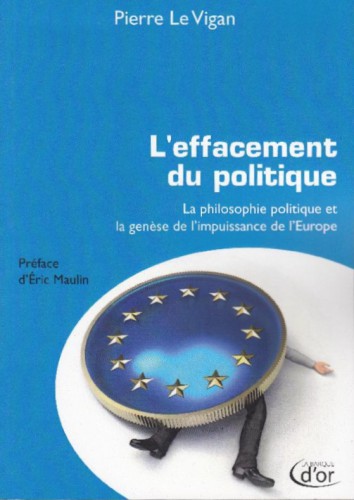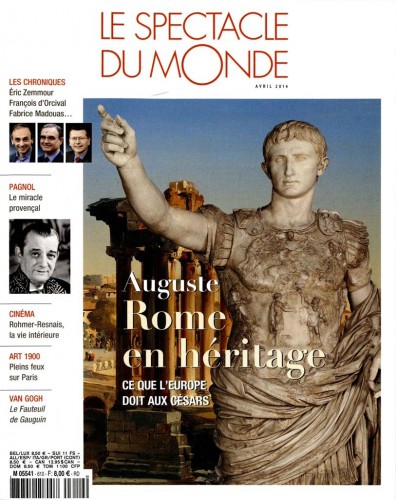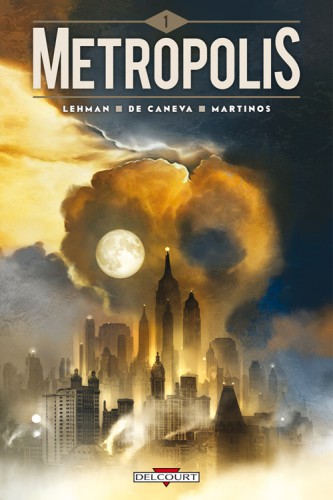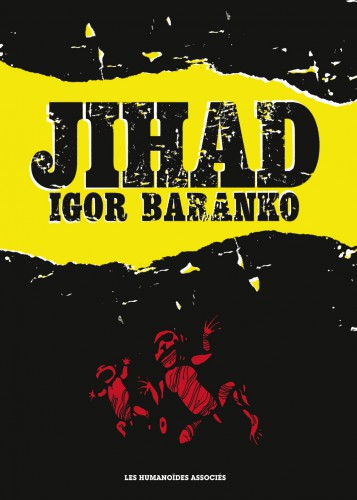Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Alain de Benoist, cueilli sur Boulevard Voltaire et consacré aux États-Unis et à leur place de grande puissance...

L'Europe ne pourra se faire que contre les États-Unis !
Après la chute du Mur de Berlin, les États-Unis sont devenus une « hyperpuissance ». Où en est aujourd’hui la puissante Amérique, entre crises financières et guerres erratiques ?
Le débat sur le « déclin américain » a été lancé aux États-Unis dès la fin des années 1980, par Paul Kennedy, dont le livre (Naissance et déclin des grandes puissances) est aujourd’hui célèbre dans le monde entier. Beaucoup de ceux qui partagent son point de vue raisonnent à partir de l’adage selon lequel « tout Empire périra ». Les États-Unis n’ont pourtant jamais créé un véritable Empire, mais une zone d’influence, ce qui n’est pas la même chose. Les alliés y sont considérés comme des vassaux, les ennemis comme des figures du Mal (le dernier en date étant Vladimir Poutine). Ces dernières années, la montée en puissance des pays émergents, à commencer par la Chine, le bilan catastrophique des guerres en Irak et en Afghanistan, l’affaiblissement du système du dollar, aujourd’hui ouvertement contesté par les Chinois et les Russes, l’accumulation depuis Reagan de déficits d’une ampleur encore jamais vue, voire l’évolution démographique (la population d’origine européenne ne représente déjà plus qu’une minorité des naissances), ont donné une certaine crédibilité à cette thèse. Cela dit, les États-Unis sont encore la principale puissance du monde, d’autant que la mondialisation crée un environnement favorable au développement de leur « soft power », théorisé en 1990 par Joseph Nye dans Bound to Lead.
Le fait que l’Amérique du Nord soit la seule nation au monde à avoir vu le jour à la suite d’un génocide peut-il expliquer sa psychologie si spécifique et l’idée que certains Américains puissent se faire de cette « destinée particulière » ?
J’ai plutôt l’impression que c’est, à l’inverse, cette psychologie qui explique l’extermination méthodique des Indiens. La mentalité américaine est marquée par une conception économique et commerciale du monde, par l’omniprésence des valeurs bibliques et par l’optimisme technicien. Les États-Unis ont une histoire courte, qui se confond avec celle de la modernité ; la civilisation américaine est une civilisation qui se déploie dans l’espace plus qu’elle ne se déploie dans le temps. Au cours de leur brève histoire, les États-Unis n’ont connu qu’un seul grand modèle politique, pratiquement inchangé depuis les origines – d’où leur conformisme (Céline, en 1925, parlait de la « platitude accablante de l’esprit USA »). La pensée des Pères fondateurs est pour l’essentiel inspirée de la philosophie des Lumières, qui implique le contractualisme, le langage des droits et la croyance au progrès. Christopher Lasch dit à juste titre « qu’aux États-Unis, la suppression des racines a toujours été perçue comme la condition essentielle à l’augmentation des libertés ». Les États-Unis sont nés d’une volonté de rupture avec l’Europe. Tocqueville écrivait : « Les passions qui agitent les Américains sont des passions commerciales, non des passions politiques. Ils transportent dans la politique les habitudes du négoce ». La « démocratie en Amérique » n’est que le règne d’une oligarchie financière.
Mais les premiers immigrants entendaient aussi créer une société nouvelle qui serait susceptible de régénérer l’humanité entière. Ils ont voulu fonder une nouvelle Terre promise qui pourrait devenir le modèle d’une République universelle. Ce thème biblique, qui est au centre de la pensée puritaine, revient comme un véritable leitmotiv dans toute l’histoire des États-Unis. Il constitue le fondement de la « religion civile » et de l’« exceptionnalisme » américains. Dès 1823, James Monroe avait placé sous le signe de la Providence la première doctrine américaine en matière de politique étrangère. Interventionnistes ou isolationnistes, pratiquement tous ses successeurs adopteront la même démarche. Et c’est aussi la théologie puritaine du « Covenant » qui inspire la doctrine de la « destinée manifeste » (Manifest Destiny) énoncée par John O’Sullivan en 1839 : « La nation d’entre les nations est destinée à manifester à l’humanité l’excellence des principes divins […] C’est pour cette divine mission auprès des nations du monde… que l’Amérique a été choisie ». Autrement dit, si Dieu a choisi de favoriser les Américains, ceux-ci ont du même coup le droit de convertir les autres peuples à leur façon d’exister, qui est nécessairement la meilleure.
Les « relations internationales » ne signifient alors rien d’autre que la diffusion à l’échelle planétaire du mode de vie américain. Représentant le modèle à la perfection, les Américains n’ont pas besoin de connaître les autres. C’est aux autres d’adopter leur façon de faire. On ne peut s’étonner, dans ces conditions, que les déboires rencontrés par les États-Unis dans leur politique extérieure résultent si souvent de leur incapacité à imaginer que d’autres peuples puissent penser différemment d’eux. En fait, pour beaucoup d’Américains, le monde extérieur (le « rest of the world ») n’existe tout simplement pas, ou plutôt il n’existe que pour autant qu’il s’américanise, condition nécessaire pour qu’il devienne compréhensible.
Le plus frappant chez les Américains, c’est leur incontestable capacité de rebond…
Cette capacité de rebond s’explique à la fois par le fait que les Américains n’ont pas d’états d’âme sur la valeur de leur modèle, par l’omniprésence de la violence dans leur culture, et aussi par le fait qu’ils n’ont pas subi au XXe siècle les abominables saignées qu’ont subies les Européens. Les États-Unis ont eu 117.000 morts pendant la Première Guerre mondiale (1,7 million pour la France), 418.000 morts pendant la Deuxième (au moins neuf millions pour l’Allemagne), environ 40.000 au Vietnam, soit au total moins que les pertes humaines enregistrées lors la guerre de Sécession. Les États-Unis ne doivent pas être sous-estimés, non seulement parce que leurs moyens restent considérables, mais parce qu’ils n’ont pas été vidés de leur énergie. Il n’en reste pas moins que, de même que les États-Unis sont nés d’un refus de l’Europe, l’Europe ne pourra se faire que contre les États-Unis.
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 21 juillet 2014)