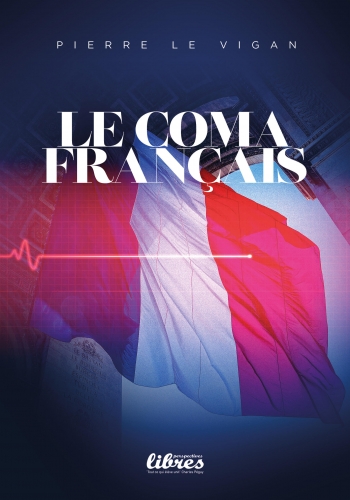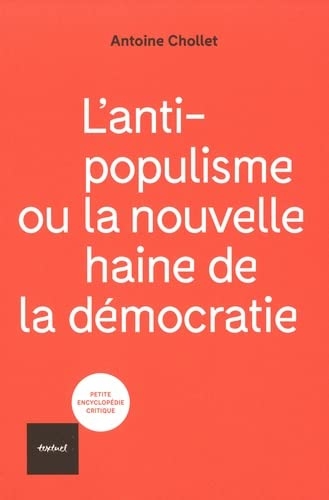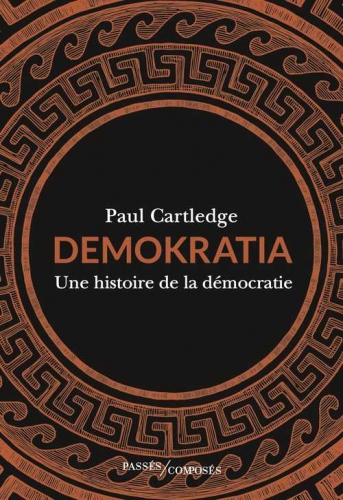Les éditions Perspectives libres viennent de publier un essai de Pierre Le Vigan intitulé Le coma français.
Urbaniste, collaborateur des revues Eléments, Krisis et Perspectives libres, Pierre Le Vigan a notamment publié Inventaire de la modernité avant liquidation (Avatar, 2007), Le Front du Cachalot (Dualpha, 2009), La banlieue contre la ville (La Barque d'Or, 2011), Écrire contre la modernité (La Barque d'Or, 2012), Soudain la postmodernité (La Barque d'or, 2015), Achever le nihilisme (Sigest, 2019), Nietzsche et l'Europe (Perspectives libres, 2022) et La planète des philosophes (Dualpha, 2023).
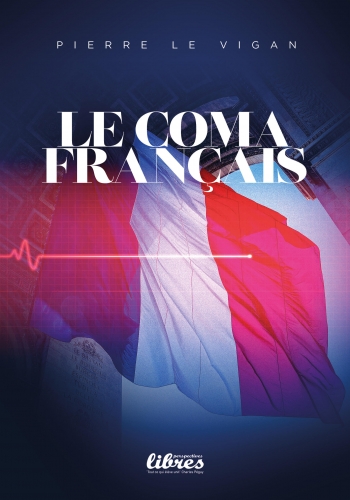
" Notre pays va mal. Il claudique mais avance vers plus de nihilisme. Comme nous étions montés haut, la chute est longue. Si « Jusque-là, ça va »
l’atterrissage se devine brutal. Nous commençons à être éparpillés façon puzzle passant d’un tout à un tas. Ayant abandonné toute confiance en nous comme corps social et historique, nous singeons les dérives américaines : « wokisme » ou « cancel culture ». Nous nous sommes vautrés dans une société sans éthique et sans esthétique. Il faut faire ce constat avant de réfléchir aux remèdes. Il faut redonner le pouvoir au peuple. Faire une révolution démocratique. Mais cela suppose la vertu civique et une rupture radicale avec la domination capitaliste sur le peuple de France. "