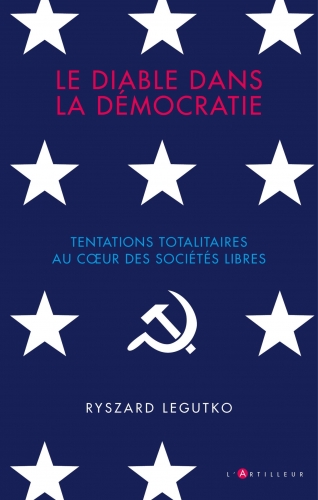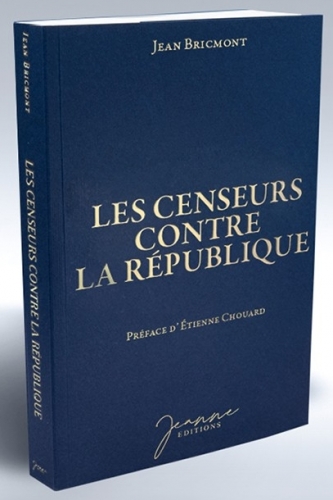Les éditions du Cerf viennent de publier un essai d'Arnaud Benedetti intitulé Comment sont morts les politiques ? - Le grand malaise du pouvoir. Rédacteur en chef de La Revue politique et parlementaire, Arnaud Benedetti est également professeur associé à Sorbonne Université, ainsi qu'aux Hautes études internationales et politiques.

La politique n'est plus ce qu'elle était. Impuissante et déclassée...
Il était une fois un pays, la France, qu'avait fait la politique et qui était fait pour la politique. Il en était la terre de toutes les conceptions, raisons et déraisons, passions et pondérations. Ce temps n'est plus.
Pourquoi assistons-nous au dépérissement de la politique ? Pourquoi n'assume-t-elle plus et ne protège-t-elle plus ni le peuple et les libertés, ni la nation et les citoyens ? Pourquoi ne résiste-t-elle pas à l'emprise de la globalisation, de l'individualisme et de la technique ? Comment cède-t-elle à la mainmise de la communication, du ritualisme et de l'expertise ? Comment abdique-t-elle son devoir de décision face aux opinions instantanées et volatiles ? Et comment les trois derniers quinquennats ont-ils accéléré le mouvement ?
C'est en mémorialiste impartial et en observateur capital qu'Arnaud Benedetti éclaire ici l'étrange défaite des politiques qui apparaissent déclassés, décrédibilisés, discrédités. En historien qu'il dévoile ce théâtre d'ombres. En chroniqueur qu'il décrypte ses simulacres. En contradicteur qu'il détaille son abyssal bilan qui cumule fractures sociales, désinvestissements civiques, replis communautaires. Et en penseur qu'il nous interroge sur la fragilité de la démocratie.
Voici, en forme de coup de poing, un appel au réveil.