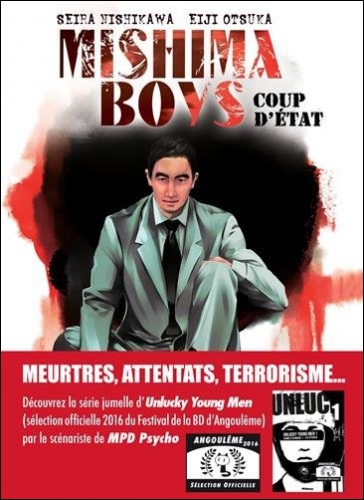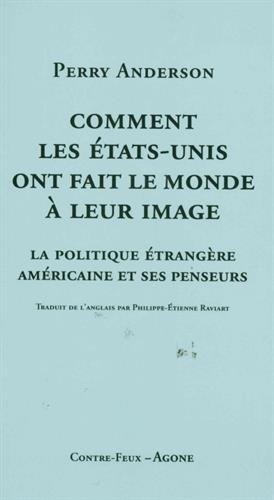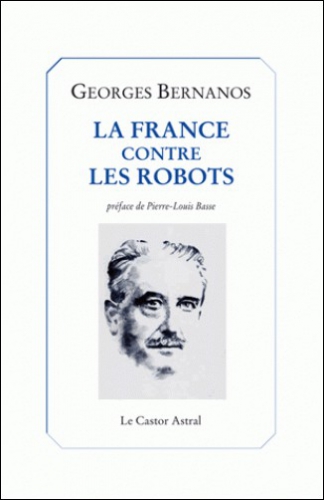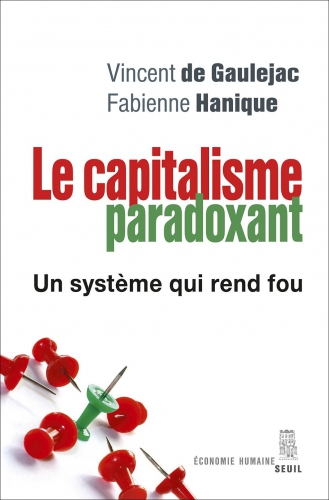« Dans la logique capitaliste, les chômeurs sont devenus des hommes superflus… »
En dépit des promesses répétées des hommes politiques de droite et de gauche, rien ne semble arrêter la progression du chômage. C’est une fatalité ?
Officiellement, on compte aujourd’hui 3,5 millions de chômeurs en France, soit un taux de chômage de 10,3 %. Mais ce taux varie selon la façon dont on le calcule. En ne comptabilisant que les personnes sans activité qui recherchent un emploi, on exclut les catégories B, C, D et E (ceux qui recherchent un emploi mais ont eu une activité réduite dans le mois, ceux qui sont en formation, en stage, en situation de contrats aidés, etc.). Si l’on combine toutes ces catégories, on arrive à 28,4 millions de personnes, soit à un taux de chômage de 21,1 %. Si, à l’inverse, on se réfère au taux d’emploi, on constate que le taux d’inactivité parmi les personnes en âge de travailler grimpe à 35,8 %. Et si l’on tient compte des emplois précaires, des « travailleurs pauvres », etc., les chiffres sont encore plus élevés.
L’évolution du chômage dépend, bien sûr, des politiques officielles, mais dans une certaine mesure seulement. Le chômage, aujourd’hui, n’est plus seulement conjoncturel, mais avant tout structurel, ce que beaucoup de gens n’ont pas encore compris. Cela signifie que le travail est devenu une denrée rare. Les emplois supprimés sont de moins en moins remplacés par d’autres. L’expansion des services est réelle, mais les services ne sont pas producteurs de capital. On sait, en outre, que d’ici vingt ans, près de la moitié des emplois du tertiaire seront remplacés par des machines en réseau. S’imaginer que l’on reviendra au plein-emploi est une chimère.
Il existe des gens qui vivent pour travailler, et d’autres qui travaillent pour vivre. Ceux qui refusent de perdre leur vie à la gagner ne s’inscriraient-ils pas dans une sorte d’ancestrale sagesse ? Le travail, est-ce vraiment une valeur en soi ?
Ce qu’il faut réaliser, c’est que ce que nous appelons aujourd’hui « travail » n’a pratiquement aucun rapport avec ce qu’était l’activité productive dans les siècles passés, à savoir une simple métabolisation de la nature. Travail n’est pas synonyme d’activité, ni même d’emploi. La quasi-généralisation du travail salarié a déjà représenté une révolution, à laquelle les masses sont longtemps restées hostiles, car elles étaient habituées à consommer elles-mêmes le produit de leur travail et non à considérer le travail comme un moyen d’acquérir les produits des autres, c’est-à-dire à travailler pour acheter le résultat du travail d’autrui.
Tout travail a une dimension duale : il est à la fois travail concret (il métabolise son objet) et travail abstrait (il représente une dépense d’énergie et de temps). Dans le système capitaliste, seul compte le travail abstrait, parce qu’étant indifférent à son contenu, étant égal pour toutes les marchandises, dont il permet ainsi la comparaison, il est aussi le seul qui se transforme en argent, médiatisant du même coup une nouvelle forme d’interdépendance sociale. Cela veut dire que, dans une société où la marchandise est la catégorie structurante fondamentale, le travail cesse d’être socialement distribué par les rapports de pouvoir traditionnels, mais remplit lui-même la fonction de ces anciens rapports. En régime capitaliste, le travail constitue à lui seul la forme dominante des rapports sociaux. Ses produits (marchandise, capital) sont à la fois des produits du travail concret et des formes objectivées de médiation sociale. Le travail cesse alors d’être un moyen pour devenir une fin.
La valeur, en régime capitaliste, est constituée par la dépense de temps de travail et constitue la forme dominante de la richesse : accumuler du capital, c’est accumuler le produit d’une dépense de temps de travail humain. C’est pour cela que les énormes gains de productivité engendrés par le système capitaliste n’ont pas engendré une baisse drastique du temps de travail, comme on aurait pu s’y attendre. Fondé sur la tendance à l’expansion illimitée, le système impose, au contraire, de toujours travailler plus. Et c’est là que l’on touche à sa contradiction fondamentale. D’un côté, le capitalisme cherche à faire travailler toujours plus parce que c’est en faisant travailler qu’il accumule du capital, de l’autre les gains de productivité permettent de produire toujours plus de marchandises avec toujours moins d’hommes, ce qui rend la production de richesse matérielle toujours plus indépendante de la dépense de temps de travail. Les chômeurs, dans cette optique, deviennent des hommes superflus.
Vous êtes connu pour être un bourreau de travail. Ça ne vous manque pas, parfois, de juste écouter pousser barbe et pelouse tout en caressant quelques chats de la maisonnée ?
Je travaille 80 à 90 heures par semaine pour la simple raison que j’aime faire ce que je fais. Cela ne fait pas de moi un adepte de l’idéologie du travail, bien au contraire. La Genèse (3, 17-19) fait du travail une conséquence du péché originel. Saint Paul proclame : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Thessal. 3, 10). Cette conception moraliste et punitive du travail m’est tout aussi étrangère que l’éthique protestante du travail-rédemption ou l’exaltation de la valeur du travail par les régimes totalitaires. Je n’oublie pas que le mot « travail » vient du latin tripalium, qui désignait à l’origine un instrument de torture. Je sais donc sacrifier aussi aux exigences d’un « temps libre » qui n’est précisément « libre » que parce qu’il est libéré du travail.
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 18 juillet 2015)