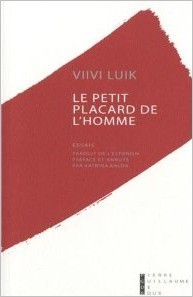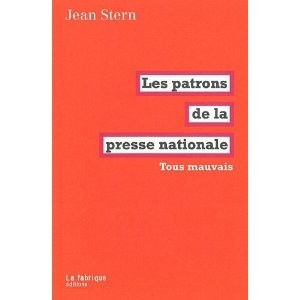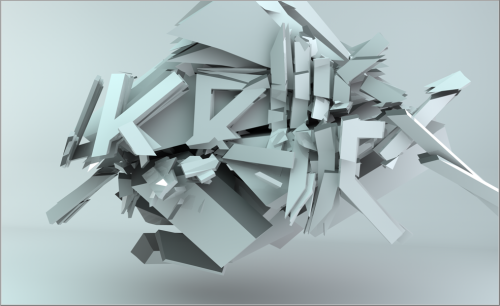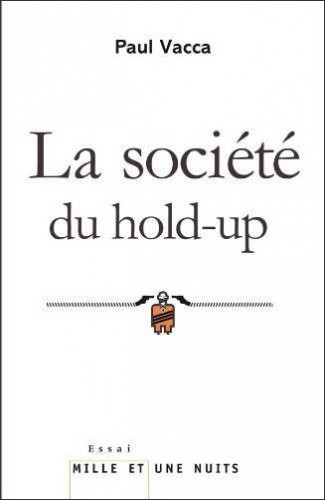Education et destructuration capitaliste de la société
Une enquête de l'observatoire des jeunes et des familles de la fondation Apprentis d'Auteuil révélait récemment qu'une famille sur deux rencontrait des difficultés considérables face à des enfants qui échappent de plus en plus à toute espèce de contrôle. Dans ce sondage, les troubles de comportement sont évoqués, l'impossibilité de fixer des règles et des limites, et ce malaise touche autant les parents d'origine modeste que ceux dont la situation est plus aisée. Pour autant, ce n'est pas tant la nature des relations entre générations qui est mise en question, que la valeur des perspectives plus larges dans lesquelles elles s'inscrivent. Car au-delà d'un constat de crise de l'éducation et de la formation des jeunes, c'est toute une civilisation qui révèle sa faille profonde, la gravité d'une maladie qui la mine et va finir par la terrasser.
En règle générale, la société technicienne qui est la nôtre offre naïvement l'aide du spécialiste pour remédier aux maux physiques ou moraux. Les pédopsychologues, comme les praticiens qui apportent une aide dans les domaines bien particuliers des déficiences personnelles (dyslexie, autisme, troubles mentaux, comportementaux, les dysfonctionnements familiaux, voire sociaux), les conseillers d'orientation, les formateurs de parents etc., constituent une brigade d'intervention qui, depuis quelques décennies, s'est étoffée, et connaît le même triomphe que, sur un autre plan, les professionnels de la justice, avocats de toutes catégories, ou la tribu de la finance. Car là où la valeur fait défaut, on cherche une solution dans la maîtrise du fonctionnement. Ces tentatives constituent au demeurant des sources appréciables de profits, tant la société libérale ne provoque des problèmes que pour offrir de pseudo solutions. Des cliniciens aux établissements privés, en passant par les soutiens à la carte ou les formations onéreuses, il y a toujours une « remédiation », comme l’on dit dans le jargon des technocrates de la pédagogie, pour toutes les défaillances.
Les familles qui se déstructurent, bien qu'on ait présenté ce chaos annoncé comme un progrès vers la liberté et la réappropriation de son propre corps, sa « libération », que l'on place souvent avant l'esprit, l'abandon des contraintes d'antan, perçues comme des obstacles à la réalisation du moi, sont les symptômes d'un état des choses dont on voit de plus en plus qu'il ressemble à un champ de ruines. La société libérale est fondée sur l’existence d’un individu dont l’autonomie est postulée par essence, dont le comportement est justifié par la raison supérieure de l’intérêt. Entre le désir du sujet et la satisfaction de celui-ci, tout tiers, surtout s’il possède une autorité de fait, devient vite insupportable. Le consommateur compulsif qu’est devenu l’enfant conditionné par les messages publicitaires, l’étalage de tentations mercantiles, et conforté par le discours libertaire, perçoit d’autant plus ses parents comme des empêcheurs de tourner en rond dans le champ de l’illimité, que l’anthropologie postmoderne leur dénie toute légitimité absolue, le relativisme sociétal étant devenu la règle dans le cercle des penseurs issus du structuralisme déstructurant. « … l’individu que la civilisation libérale commence seulement à produire en série éprouve les pires difficultés à intérioriser les limites et les interdits, pourtant indispensables à la construction d’une vie autonome. Faute de pouvoir prendre appui sur une quelconque autorité tierce – que tout le discours réel du capitalisme tend désormais à discréditer – il est, en effet, condamné à tourner indéfiniment en rond dans l’ « arène de l’illimitation » » (J.C. Michéa ; Le Complexe d’Orphée).
Le « droit de », assumé dans toute société codifiée, est devenu un « droit à », que le « droit des enfants », par exemple, a pu illustrer comme moyen de culpabiliser et de décrédibiliser les parents. La liste des droits n’a pas plus de fin, du reste, que celle des individus, encore qu’il faille aussi considérer que chacun a droit à plusieurs droits, voire à une quantité illimitée, en fonction de la variété de ses caprices, de ses pulsions, ou de ses besoins. La situation s’avère dramatique lorsque l’on prend conscience que la génération précédente, qui élève de nos jours ses enfants, a eu le malheur, ou le bonheur illusoire et mortifère, d’expérimenter la nouvelle société, et de perdre, la première, les repères traditionnels d’autorité, qu’elle a vertement contestées. Aussi est-elle particulièrement désarmée pour réagir avec perspicacité, pour autant qu’elle comprenne bien ce qui lui arrive.
La réaction générale, en effet, face à un chaos que tous, sauf quelques idéologues minoritaires, sont en mesure de constater, ne serait-ce que parce qu’ils en souffrent, est de diagnostiquer le mal dans sa dimension formelle et dans ses conséquences partielles. On considère que les ravages au sein des familles ou de l’école proviennent d’un manque de discipline, d’une absence de morale, d’une pénurie malheureuse de communication, quand ce ne sont pas les causes inverses, c’est-à-dire trop d’autorité, un excès d’injonctions moralisatrices, ou une trop grande familiarité entre générations.
Ces analyses échouent à cerner un phénomène qui excède les expériences singulières, même si c’est au niveau individuel qu’il s’incarne le plus visiblement. La généralisation de l’impuissance éducative montre qu’il n’est guère de recette assurée. C’est comme si l’on voulait accorder un orchestre pendant que le paquebot prend l’eau de toute part. Même s’il ne s’agit que de son petit orchestre, un duo, un trio, un quatuor, que l’on essaie d’harmoniser dans sa cabine particulière – et il n’est certes pas impossible de réussir, par moment, quelque bonne composition -, la situation d’ensemble est au naufrage, l’arrière plan génère un sentiment diffus de panique, et, comme une eau qui s’insinue partout, l’esprit de dissolution mine les meilleures volontés en même temps que les cadres que l’on croyait pérennes.
Ce qui change radicalement les données de la crise, par rapport aux temps anciens, c’est l’adoption consensuelle d’un paradigme, de ce que Renaud Camus, dans un livre, « Décivilisation », qui est un chef d’œuvre de lucidité, nomme l’hyperdémocratisme » : « J’appelle hyperdémocratie la volonté de faire sortir la démocratie de son lit politique pour la projeter dans des domaines qui, à première vue, ne lui sont guère congéniaux, et per exemple la culture, justement, ou la famille… ». Il s’agit-là d’une intolérance, propre à l’âge des masses, à tout ce qui évoque une réelle différence, ou une supériorité quelconque. Or, la civilisation quantitative actuelle tend à promouvoir l’égalité absolue, au nom de la lutte contre les « privilèges » et les « discriminations ». Depuis l’après-guerre, ce sont les « héritiers » qui sont visés, et Bourdieu a fait, dans les cabinets ministériels ainsi que dans les salles de professeurs, de nombreux émules. Or, comme le rappelle Renaud Camus, « tout mouvement vers l’égalité implique toujours, autant et souvent plus que l’élévation de la partie défavorisée, l’abaissement simultanée de la partie favorisé… »
La division de la société entre une classe où était de règle la contrainte, cette « syntaxe » des valeurs, (« J’ai appelé la syntaxe l’autre dans la langue : se contraindre à parler syntaxiquement, c’est reconnaître qu’on n’est pas seul, qu’à travers nous parlent une langue, un peuple, une histoire, une convention, un pacte d’in-nocence, un consentement à la non-adhésion à soi-même, à l’expression pure »), syntaxe qui est la formalisation au niveau de l’ethos, du legs des temps passés et de la bienséance civile, alliée à la transmission d’une culture savante, élitiste, et l’autre partie de la société, en principe exclue de cette éducation qui apprenait à se « tenir droit », mais qui, d’une façon ou d’une autre, en recevait les leçons, à tel point que, ce que l’on a nommé « école républicaine », était, peu ou prou, le symbole d’une civilisation qui était encore ouverte à l’ascendante exigence d’une éducation assumée consciemment, a laissé place à « la grosse classe unique de convergence centrale », totalitaire productrice et prescriptrice d’un discours hédoniste, ludique, démobilisateur, démoralisant et avachissant. Personne n’en est exempt. « … les héritiers n’héritent plus de rien (culturellement) et [sont] aussi déshérités que les non-héritiers. » Même dans les familles encore soucieuse d’une éducation digne de ce nom, il est très ardu, voire impossible, de garder à l’abri des enfants infectés par la maladie universelle de la vulgarité, du laisser aller et des plaisirs faciles et grossiers.
L’oligarchie postmoderne, souvent le fruit, grâce à l’émergence de nouveaux domaines économiques, liés à la révolution des transmissions de l’image et du son, ou bien portée par le triomphe du capitalisme financier, partage amplement les goûts plébéiens de la masse, comme des pauvres enrichis, des parvenus. Nous avons assisté à une révolution « culturelle » plus profonde que celle conduite par Mao. Aucun signe de ralliement ou de contre-offensive ne peut être viable. Peu nombreux sont ceux qui se souviennent ou connaissent vraiment ce que fut le monde d’avant, qui fait figure dorénavant de continent perdu. Et sa disparition n’est pourtant pas si lointaine ! Non qu’il fût parfait, et qu’il dût apparaître comme un idéal vers lequel faire retour, mais il gardait encore les principes qui furent ceux de toutes les époques, de toutes les civilisations, jusqu’à la nôtre, si différentes des autres, si anormale, si malade. Il était banal alors de considérer qu’il fallait faire des efforts pour devenir soi-même, que l’enfant, s’il avait vocation à se transformer en adulte, ne l’était pas pour autant, et qu’il n’était pas détenteur de cette distance de soi à soi, indispensable pour juger du monde, des autres, et pour acquérir une autonomie si prisée maintenant, sans qu’on sache ce qu’elle est vraiment, et qu’il était nécessaire, enfin, de se « désenseigner » pour accéder à une authentique éducation, à une maîtrise et à un savoir qui, comme l’indique l’étymologie latine, conduit à la voie idoine.
La situation peut donc s’avérer désespérée. Les saines réactions ne sont que des réactions, les sursauts ne sont pas des sauts vers autre chose, vers un autre monde. Les initiatives personnelles, aussi méritantes soient-elles, si elles n’aboutissent pas à des déconvenues, ne se présentent guère que comme des actes de guérilla. Il faudrait bien sûr que cette « petite guerre » se transmue en une grande, en un affrontement avec la source des maux, cette société libérale qui brouille tout, détruit tout, ne respecte rien, et choisit les valeurs marchandes plutôt que la valeur humaine.
On ne demandera certes pas aux hommes politiques et aux technocrates de la modernité d'apporter les véritables remèdes à ce désastre. Pour qu'il existe des chances de rencontrer, dans les sphères décisionnelles, une claire compréhension de ce qui se passe, il faudrait que les gouvernants soient autres qu'ils ne sont, ce qui est une vue bien singulière de l'esprit, un raisonnement pas l'absurde. Car accéder à la vérité du monde qu'ils conduisent à sa perte serait pour eu l'équivalent d'un suicide.
Claude Bourrinet (Voxnr, 8 décembre 2012)