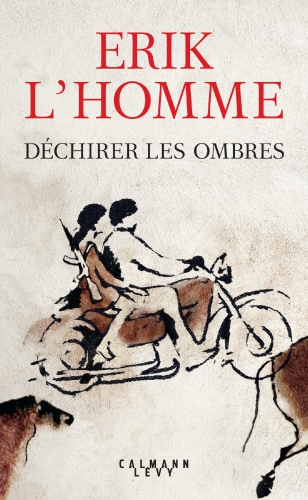Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Philippe Conrad, cueilli sur le site de l'Institut Iliade et et consacré à la défaite américaine en Afghanistan.
Agrégé d'histoire et professeur à l’École de guerre, successeur de Dominique Venner à la tête de la Nouvelle revue d'histoire, Philippe Conrad est l'auteur de nombreux ouvrages dont Histoire de la Reconquista (PUF, 1999), Le Poids des armes : Guerre et conflits de 1900 à 1945 (PUF, 2004), 1914 : La guerre n'aura pas lieu (Genèse, 2014) et dernièrement Al-Andalus - L’imposture du «paradis multiculturel» (La Nouvelle Librairie, 2020).

L’Afghanistan, éternel « tombeau des empires »
« Combattre en Afghanistan est très dur pour des raisons géographiques, nationales et religieuses. Avant de lancer une opération militaire, il faut tenir compte de nombreux éléments et prendre une décision mûrement réfléchie, la tête froide. » Auteur de ces lignes, le général Boris Gromov commandait, en février 1989, le retrait soviétique d’Afghanistan. En 2001, au moment où, en réponse aux attentats du 11 septembre, l’Amérique chassait le pouvoir taliban de Kaboul, il avertissait les responsables américains des difficultés qu’ils allaient rencontrer face au régime islamiste installé depuis 1996.
Ces hautes terres enclavées forment une région difficile que les envahisseurs successifs n’ont jamais pu maîtriser totalement. Voie d’invasion en direction du subcontinent indien et carrefour placé aux périphéries de plusieurs grands espaces de civilisation – l’Inde au sud-est, le monde des steppes d’Asie centrale au nord, le plateau iranien à l’ouest – l’Afghanistan a été convoité par tous les grands empires qui tentèrent de contrôler l’Asie centrale et méridionale.
Le pays ne fut généralement conquis que de manière éphémère. Les puissances mondiales qu’étaient l’Angleterre au XIXe siècle, l’URSS au XXe et les États-Unis au XXIe y ont même subi de sanglants échecs.
Une voie de passage et d’invasions depuis la nuit des temps
Quinze siècles avant notre ère, les Aryens ouvrent la voie. Ils seront suivis par les Perses, les Macédoniens d’Alexandre, les Saces, les Huns hephtalites, les Arabes, les Mongols de Gengis Khan, les Turco-mongols de Tamerlan puis de Bâbur…
L’Himalaya et les jungles de Birmanie barrant au nord et à l’est l’accès terrestre à l’Inde, c’est par l’ouest que les envahisseurs, les marchands ou les pèlerins bouddhistes chinois se dirigeaient vers les grandes et riches cités du bassin indo-gangétique. À certaines époques, la région – où se développera, au IVe siècle, le royaume d’Avagana (qui donnera leur nom aux Afghans) – apparaît même comme le centre de gravité de la puissance dominante du moment.
Voie de passage, le pays sera aussi une base de départ pour les envahisseurs qui constitueront, à partir d’elle, des empires plus ou moins durables. Le sultan Mahmoud fait ainsi de Ghazni, au début du XIe siècle, une capitale musulmane rivale de Bagdad. Il peut ainsi lancer depuis l’Afghanistan des razzias répétées et dévastatrices vers l’Inde toute proche.
Après lui, Bâbur se prétend l’héritier de Gengis Khan et de Tamerlan : il s’empare de Kaboul en 1504 avant de se lancer sur l’Inde pour y anéantir le royaume de Delhi. Repliés un temps sur leur refuge afghan, ses descendants bâtissent le brillant empire moghol. Au XVIIIe siècle, quand s’effondre la puissance de la Perse safavide, c’est Ahmed Shah qui construit le « grand Afghanistan » étendu de l’Iran à l’Inde.
Vaincre par la terreur et le massacre
Ce monde difficile fut le théâtre de l’un des épisodes les plus remarquables de l’épopée d’Alexandre. Parvenu dans la région de Kaboul, le conquérant macédonien fait remonter à son armée la haute vallée du Panshir jusqu’au col de Khawak (3548 m). Il le franchit en taillant son chemin dans la glace. En Transoxiane, six jours sont nécessaires pour traverser l’Oxus (l’actuel Amou Daria) en crue. Lors de la marche vers Maracanda (Samarcande), la capitale de la Sogdiane, Alexandre réussit la « pacification » par le massacre systématique des populations rebelles. Faute de pouvoir livrer des batailles rangées, les Macédoniens s’organisent en colonnes mobiles qui traquent et affament l’adversaire pour éradiquer la guérilla. Quand Alexandre marche vers l’Indus en juillet 327, il « nettoie » tout ce qui peut constituer une menace pour ses arrières.
Seize siècles plus tard, Gengis Khan établit sa domination avec les mêmes méthodes. Balkh, Bamyan, Ghazni et Hérat sont alors rasées. Toute leur population est méthodiquement massacrée. Isolées, les formidables forteresses qui se dressent à proximité de Bamyan sont finalement prises en 1222. Elles étaient pourtant jugées inexpugnables. Un siècle et demi plus tard, Tamerlan sera le digne successeur du conquérant des steppes. Envahi en 1380, l’Afghanistan sort exsangue de ce nouveau cataclysme.
Échec anglais puis russe aux XIXe et XXe siècles
Solidement installés aux Indes au XVIIIe siècle, les Britanniques entendent protéger l’ensemble du subcontinent de toute menace venant du nord-ouest et doivent pour cela contrôler la passe de Khaïber (Khyber). Inquiets des visées russes sur la région et soucieux d’interdire aux tsars l’accès aux mers chaudes, les Anglais installent l’un de leurs protégés à Kaboul en 1839, mais une grande révolte éclate deux ans plus tard et le général Elphinstone doit négocier une humiliante retraite.
L’Armée anglaise va connaître, une semaine durant, un véritable calvaire. Dans l’impossibilité de manœuvrer, elle subit le feu d’adversaires embusqués sur les hauteurs des points de passage obligés. Les pertes sont terribles : sur les seize mille cinq cents hommes (dont douze mille auxiliaires indigènes indiens) partis de Kaboul le 4 janvier 1842, un seul, le chirurgien Brydon, arrivera à Djalalabad une semaine plus tard ! La lenteur de la progression dans la neige épaisse, le froid terrible et les embuscades à répétition des Afghans ont eu raison de l’armée anglaise d’Afghanistan. Les Britanniques reviendront à Kaboul à la fin de la même année mais l’échec reste cuisant. Ils n’en ont pas fini avec les Afghans. Deux autres guerres les opposeront en 1878-1892 et en 1919.
En décembre 1979, l’intervention soviétique a pour objectif la liquidation d’une fraction du parti communiste local au profit d’une autre, jugée plus apte à maîtriser l’insurrection islamiste qui gagnait de nombreuses régions. L’opération « Bourrasque 333 » va en réalité déboucher sur un terrible enlisement, annonciateur de l’effondrement de l’empire soviétique.
L’Armée rouge avait choisi de ne contrôler que l’Afghanistan « utile » soit 20% du territoire correspondant aux zones les plus riches et les plus peuplées : les régions du nord frontalières de l’URSS (qui exploitait le gaz naturel local pour financer « l’aide » fournie aux Afghans), le tunnel de Salang, la région de Kaboul et les principales autres villes de la route contournant la masse d l’Hindou Kouch et conduisant de Kandahar à Hérat. Des régions entières furent donc abandonnées à l’ennemi. Ce choix facilita la vie et les déplacements de la résistance. Les occupants russes commirent aussi l’erreur de vouloir occuper le terrain avec un contingent permanent de cent vingt mille hommes (environ six cent mille furent ainsi, au fil des années, engagés en Afghanistan). Après dix ans d’occupation, ils auront perdu quatorze mille hommes et compteront trente cinq mille blessés.
Plusieurs offensives lancées dans la vallée du Panshir contre les troupes du commandant Massoud échouèrent, les unités blindées et mécanisées soviétiques se révélant mal adaptées au combat en montagne. L’emploi des hélicoptères pour contrôler les hauteurs et y déposer des unités d’élite et pour appuyer les colonnes blindées dans les vallées ne connut pas plus de succès. Les bombes à effet de souffle, le napalm, les munitions chimiques, la dispersion massive de mines antipersonnel ne vinrent pas davantage à bout des moudjahidines. La répression mise en œuvre par le Khad (la police politique du régime de Kaboul) dressa encore davantage la population contre les envahisseurs et leurs collaborateurs locaux. L’aide américaine (quinze milliards de dollars d’armements) acheva l’Armée rouge, grâce notamment aux redoutables missiles sol-air Stinger.
Et les Américains pour finir…
L’échec subi à l’époque par les Soviétiques aurait dû donner à réfléchir aux responsables américains quand ils décidèrent d’intervenir au sol en 2001 pour favoriser l’émergence locale d’un système démocratique des plus hypothétiques.
Pour parvenir à leurs fins, ils auraient dû se garder de s’installer au sol pour une longue durée. Ils savaient qu’ils avaient intérêt à faire combattre les Afghans par d’autres Afghans et à tenter de rallier certains chefs de tribus pachtounes pour s’opposer au pouvoir taliban, largement perçu comme étranger par certaines populations.
Une connaissance insuffisante du terrain et des réalités afghanes, tout comme les illusions entretenues par le projet de nation building auront eu raison des plans concoctés par les officines néo-conservatrices de Washington. Dès 2001, le colonel russe Franz Klintsevitch – qui avait combattu en Afghanistan de 1986 à 1988 – prévenait :
« En cas d’intervention des troupes terrestres, qu’il faut retarder le plus longtemps possible, les États-Unis doivent s’attendre à une guerre de plusieurs décennies, sauf à supprimer toute la population… »
N’ayant rien voulu comprendre ni apprendre, comme toujours, les États-Unis subissent aujourd’hui une humiliation majeure.
Vae victis.
Philippe Conrad (Institut Iliade, 25 août 2021)