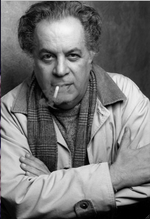Cybernétique de la crise, c'est le titre du point de vue de l'écrivain Stéphane Audeguy que le journal Le Monde a publié dans la rubrique "Débats" de son numéro daté du dimanche 3 janvier 2010.

Cybernétique de la criseLE MONDE | 02.01.10 | 13h49 • Mis à jour le 02.01.10 | 13h49
 a crise - la chose et le mot - fait l'objet d'un traitement si particulier que j'aimerais en dire ici deux ou trois choses. Non pas en tant que littérateur soucieux du beau langage ; simplement, un écrivain est un homme politique, dans un monde où la langue subit des dévoiements radicaux.
a crise - la chose et le mot - fait l'objet d'un traitement si particulier que j'aimerais en dire ici deux ou trois choses. Non pas en tant que littérateur soucieux du beau langage ; simplement, un écrivain est un homme politique, dans un monde où la langue subit des dévoiements radicaux.
Le discours dominant de la crise vise, curieusement, à masquer la crise. Et si le mot de crise est employé de façon absolue, comme disent les rhéteurs, c'est que le discours de la crise prétend régner absolument sur nous. Cet emploi est trompeur, car il désigne seulement, le plus souvent, une partie de la crise globale : celle qui concerne l'économie. Et nous sommes censés admettre que l'économie est tout. Simultanément, cette notion envahit tous les domaines de la vie sociale : sports, entreprises, santé publique, etc. Ces deux pratiques se complètent : la crise, en général, c'est la crise économique ; simultanément, tout est en crise, mais de façon dispersée, si l'on peut dire.
Se trouve ainsi escamotée la réalité : la crise est en fait totale et cohérente : elle concerne notre civilisation, ou plutôt cette société marchande mondialisée qui n'est pas une civilisation, mais prétend s'y substituer, un peu à la façon dont le mot de culture a fini par désigner à peu près n'importe quoi, un peu à la façon dont le Centre national de la littérature est devenu Centre national du livre (chacun ajoutera ici, dans son domaine de compétence, des exemples).
Pour Littré, la crise concernait les maladies : on parlait de crise heureuse ou funeste. L'issue était la mort ou la guérison. Le discours de la crise, lui, a rompu depuis longtemps avec cette façon de dire, et de penser. Le mot désigne des mutations du système économique mondialisé : simples crises de croissance d'une économie qui étend toujours davantage son empire. La seule mesure vraiment significative du sommet de Pittsburgh, c'est le passage du G8 au G20. Le G20 représente 80 % du PIB, et deux tiers de la population mondiale. Faut-il s'en réjouir ? Les décisions seront plus difficiles à prendre (car on voit mal sur quoi le Brésil et l'Inde pourraient tomber d'accord) ; d'autre part, le G20 ne représente pas ces deux tiers de la population, mais les assujettit aux lois de l'économie : que beaucoup désirent cette servitude ne change rien à l'affaire. Quant au tiers restant, il est atteint dans sa survie même (l'Afrique, sorte de tiers-état, est représentée au G20 par un seul pays : l'Afrique du Sud). Et tous, inexorablement, subissent la pollution, les mutations économiques brutales, les mouvements spéculatifs erratiques, dans un monde où l'on annonce une reprise de la consommation comme une bonne nouvelle ; à court terme, oui, en un sens ; mais, structurellement, c'est une catastrophe.
Comment un monde qui érige la concurrence en principe intangible peut-il engendrer autre chose que des crises ? Comment les dirigeants et les experts, qui tous partagent une foi entière en la rationalité de l'économie, peuvent-ils produire autre chose qu'une gestion de la crise (expression en elle-même aberrante) ? Le politique s'est dégradé, et l'on ne s'étonne pas de voir la notion élastique de gouvernance (anglicisme qui nous vient du business, et auquel je préfère le mot de cybernétique) se substituer à celle de gouvernement : la gouvernance, sorte de transitivité occupée à maintenir l'état des choses et sa scandaleuse nocivité pour le vivant, tout en feignant d'en corriger les effets, incontrôlés parce qu'incontrôlables.
Le mot crise renvoie en grec à l'idée de décision : un état critique appelle des décisions, des choix véritables. Le discours de la crise singe tout cela, mais énonce que nous n'avons pas le choix, puisque c'est la crise. Combien de gouvernants souhaitent secrètement se voir imposer des mesures par le Fonds monétaire international (FMI) ? Ils peuvent alors les présenter comme une douloureuse nécessité.
Cette cybernétique s'appuie sur la figure de l'expert (d'où le succès, en Italie, d'un ploutocrate parvenu à la tête du pays en se réclamant du monde de l'entreprise). Nous sommes invités à réfléchir aux "leçons de la crise", y compris dans les colonnes du Monde (dossier du 22 septembre). Mais cette expression présuppose que la crise est un phénomène rationnel ; à vrai dire, il s'agit d'écouter les leçons de la crise, et non pas d'en tirer ; chose désormais impossible dans l'économie mondialisée, comme nous le répètent les libéraux les plus cyniques.
Dans ce dossier du Monde, par exemple, un seul économiste, Thomas Philippon - il est jeune, et cette franchise lui passera - note entre autres choses que "l'égalité devant la loi est bafouée par la présence d'entreprises tellement grosses que personne ne sait comment les liquider sans mettre en danger l'ensemble du système" ; mais il ne songe pas à changer le système en question.
La crise est l'instrument rêvé de la cybernétique moderne : j'en prendrai deux exemples, à dessein hors de l'économie. Après les attentats du 11-Septembre, les Etats-Unis ont créé un ministère de la sécurité intérieure. Ce Department of Homeland Security est censé lutter contre le terrorisme, l'immigration, et préserver l'intégrité des frontières. Création extraordinaire, pour un pays dont l'identité s'est longtemps constituée contre un ennemi extérieur ; mais qui prolonge, en fait, la guerre froide : l'ennemi est à chercher désormais partout, à l'intérieur (affaires de Waco, d'Unabomber, d'Oklahoma City) comme à l'extérieur (attentats du World Trade Center de 1993 et de 2001).
Et si l'ennemi est ubiquitaire, l'état de crise devient la norme. En témoigne un gadget merveilleux, que chacun peut consulter sur le site du ministère. C'est un baromètre de la sécurité, qui affiche des niveaux de danger : le vert indique un risque faible ; le bleu, un risque général, jusqu'au rouge (danger extrême). Je le consulte depuis des années et, à ma connaissance, il n'a jamais été au vert ; le 5 octobre, par exemple, le "niveau de menace" est "élevé". De toutes façons, le vert n'est guère rassurant, car voici ce que le ministère conseille de faire alors : "Elaborez un plan d'urgence pour votre famille ; partagez-le avec vos amis, testez-le ; créez un kit de fournitures d'urgence pour la maisonnée ; informez-vous en vous procurant la brochure." Se préparer, c'est le bon sens : préparez-vous maintenant "sur le site www.ready.gov ; envisagez de prendre des cours de premiers secours auprès de la Croix-Rouge américaine, etc.". Voilà donc une crise de sécurité qui dure depuis sept ans, dont on ne voit pas la fin, et dont il est évident que le ministère n'a pas intérêt à voir la fin, puisqu'elle serait aussi la sienne.
Mais en quoi consiste, dans les faits, une gestion d'une crise ? Prenons l'exemple du récent "scandale" de l'écurie Renault en F1. Voilà un constructeur automobile pris en flagrant délit de tricherie caractérisée. Les experts prévoient des sanctions sévères. Cependant, la Fédération internationale ne peut guère renvoyer des circuits une entreprise qui contribue autant à sa prospérité que Renault (ce qui frappe dans cette crise-là, comme dans la crise économique, c'est le degré d'intrication des acteurs, et la dépendance des instances censées réguler avec ce qu'elles sont censées réguler).
On propose alors au public un bouc émissaire : le directeur de l'écurie, Flavio Briatore, est exclu à vie par la Fédération (la discussion sur la culpabilité réelle de cet homme équivalant ici, en inutilité, aux polémiques sur les bonus des traders, rouages sans importance du système). Un Italien tricheur, avec la gueule de l'emploi : quelle aubaine pour tout le monde, et par exemple pour L'Equipe, journal spécialisé dans l'indignation vertueuse ! Puis le verdict tombe : "Le Conseil mondial du sport automobile a décidé de suspendre la disqualification de Renault F1 jusqu'à la fin de 2011." Renault doit donc veiller à ne pas tricher avant la fin de la prochaine saison... Il n'est pas certain que cette gestion de crise fonctionne tout à fait bien : certains commanditaires de l'écurie Renault renâclent, semble-t-il, à continuer à associer leur nom à une entreprise malhonnête (car, s'il est possible que Renault ait ignoré la fraude de Briatore, c'est bien ce créateur d'automobiles qui a bénéficié de la tricherie et du titre afférent de champion du monde).
Cette idéologie de la crise est un symptôme parmi d'autres d'une crise de la notion même de civilisation. La solution la moins pessimiste serait que le système connaisse, non pas une crise de plus, mais un effondrement. Nous en sommes là, entre désespoir et rage. Quand je dis nous, c'est une façon de parler ; car la ploutocratie mondialisée, elle, est assurée pour l'instant d'une quasi-immunité.
On apprend par exemple que le jour de la faillite de Lehman Brothers, des recruteurs sont venus s'installer dans le restaurant d'à côté pour réembaucher ses cadres ; les employés des usines délocalisées, eux, reçoivent une lettre leur offrant un emploi à l'autre bout de la Terre, et pour un salaire de misère. Pour la ploutocratie, la crise peut être douloureuse, mais elle est passagère ; pour les autres, c'est-à-dire pour quasiment toute la population mondiale, c'est un mode d'assujettissement permanent et une catastrophe qui continue de s'étendre.
Stéphane Audeguy
Stéphane Audeguy, romancier et essayiste
Auteur de La Théorie des nuages (2005) et de Fils unique (2006) chez Gallimard, a publié en 2009 Nous autres, In memoriam et L'Enfant du carnaval (Gallimard). Dans des chroniques intitulées Memorabilia, il évoque certains objets contemporains qui, tel le GPS, composent les signes de notre modernité (NRF, n° 592).