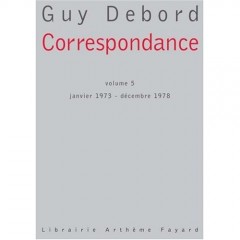Nietzsche et la science-fiction (2ème partie)
3) Présence des grands thèmes de la S-F dans l’oeuvre nietzschéenne
Si Nietzsche, comme nous venons de le montrer, systématise la variation des points de vue et des échelles en mettant en mettant en œuvre des procédés qui seront largement utilisés par les écrivains de S-F, il est peut-être plus étonnant encore de constater dans son oeuvre la présence de tous les thèmes qui seront ceux de la S-F. Nous nous contenterons ici d’une énumération qui n’a nullement la prétention d’être exhaustive.
Partons de la vie extra-terrestre, évoquéeplus haut : déjà présupposée par Fontenelle ou Kant, elle l’est nettement plus chez Nietzsche, où elle s’accompagne quelquefois du thème de l’apocalypse. Le plus bel exemple en est cette véritable saga interstellaire que l’on trouve dans Aurore sous le titre « Une issue tragique de la connaissance » : « On n’a encore jamais posé le problème de savoir quel besoin de connaissance pourrait pousser l’humanité à se sacrifier elle-même, à mourir, un éclair de sagesse prémonitoire au fond des yeux. Peut-être que s’il s’établit un jour une fraternité dans l’intérêt de la connaissance avec les habitants d*autres planètes, et si au cours des millénaires le savoir s’est propagé d’étoile en étoile, peut-être alors l’enthousiasme de la connaissance culminera à cette hauteur [21].La vie extra-terrestre sert ici de médiation entre deux idées très fréquentes chez le penseur, surtout dans ses oeuvres de jeunesse : l’idée d’un savoir devenu valeur suprême aux antipodes d’une connaissance conçue comme simple gagne-pain, et celle d’une disparition de l’espèce humaine pouvant présenter tous les degrés du sens, depuis la pure absurdité astronomique jusqu’au mythe romantique évoqué dans le texto cité. L’éventualité d’un sacrifice offert sur l’autel de la connaissance n’a rien de spécifiquement nietzschéen ; il faut reconnaître par contre que cette épopée d’une humanité future qui, après avoir échappé aux frontières terrestres, accepterait sa propre disparition, a de bien étranges résonances. Est-il trop audacieux de supposer que Nietzsche, en écrivant ces lignes, songe à un voyage intersidéral dont les hommes du futur n’auraient qu’une chance infime de revenir ? Rien dans ce texte très allusif ne semble s’opposer une telle interprétation, aussi surprenantequ’elle puisse paraître : force nous est alors de reconnaître que si notre lecture est correcte, Jules Verne n’a été qu’un bien timide visionnaire comparé au penseur allemand.
Le thème d’une apocalypse causée par la science et les techniques qu’elle engendre, thème devenu dominant dans la S-F depuis la seconde guerre mondiale et particulièrement depuis Hiroshima, est omniprésent dans les écrits de Nietzsche. On pourrait composer un très substantiel recueil avec toutes les critiques et les mises en garde par lesquelles le philosophe accuseune science qui devient l’ennemie de la vie, un savoir qui tend à s’inscrire toujours davantage dans un processus suicidaire. « Un âge de barbarie commence, les sciences se mettront à son service ! » [22]. Nietzsche, comme avant lui Hegel, a beaucoup rêvé dans ses premières oeuvres à une Grèce sans doute idéalisée qui ignorait le divorce entre la théorie et la pratique, à des Grecs pour qui le savoir n’avait de valeur qu’en tant que guide de l’existence, qui avaient le génie d’intégrer de façon quasiment biologique la connaissance et de la mettre au service de la vie. C’est cette référence constante à la Grèce qui permet à Nietzsche de dénoncer une culture moderne fondée sur la dichotomie du savoir et de la vie, une connaissance dont l’abstraction grandissante transforme celui qui la possède en une sorte de Janus dont les deux faces n’ont plusaucune ressemb1ance, ou, si l’on préfère, en un schizophrène qui ne cherche ni ne trouve plus dans sa vie le moindre reflet de son savoir ni dans son savoir le plus petit écho de sa vie. L’idéalisme forcené qui conduit la science à oublier qu’elle est terrestre et qu’elle n’existe que par lesvivants qui la construisent et la valorisent, peut mener l’humanité à la barbarie voire à l’anéantissement. Ce qui semb1e si évident à tout individu de notre vingtième siècle finissant n’était, ne l’oublions pas, de la «science-fiction » à la fin d’un siècle persuadé que les lendemains chanteraient sous la houlette d’une technique orchestrant le bonheur universel.
Mais l’hypothèse d’une autre fin de l’humanité, moins brutale et peut-être plus vraisemblable, est celle d’une lente dégénérescence guidée précisément par ces progrès matériels divinisés par l’idéologie scientiste. Persuadés d’avoir atteint la perfection parce que la médecine et la chimie auront adouci la mort et écarté la douleur, anesthésiés sur une planète d’où la technique aura annihilé la dureté des conditions climatiques et effacé les dangers et les provocations de la nature, uniformisés dans le moule plantaire d’un mode de vie et d’une morale identiques, les hommes ne vont-ils pas prendre sans s’en rendre compte le chemin d’un assoupissement mortel ? Et qui osera encore lancer une parole de mise en garde ? « Celui qui sent d’une autre manière, à l’asile des fous il entre de plein gré » [23] .Le paragraphe cinq du prologue d’Ainsi parlait Zarathoustra décrit de façon hallucinante ce monde du « dernier homme » annoncé pas Nietzsche en de multiples pages de son œuvre : ces quelques dizaines de lignes peuvent être considérées comme le véritable archétype de toutes les anti-utopies du vingtième siècle, dont la plus célèbre est sans doute A brave new world d’Aldous Huxley [24]. Le talent des écrivains de S-F ne sauraitfaire oublier que son génie a permis à Nietzsche d’exprimer davantage en un court paragraphe que bien des romanciers en plusieurs centaines de pages.
A supposer cependant qu’un cataclysme nucléaire brise le meilleur des mondes et ramène l’humanité à un stade pré-technologique, les rapports des hommes à la technique et la valeur accordée à la connaissance risquent d’être entièrement bouleversés. Les descriptions de la terre à l’issue d’un conflit nucléaire, les peintures d’un monde post-atomique dans lequel la science est devenue synonyme de mort et où refleurissent les coutumes les plus barbares et les croyances les plusarchaïques, constituent, depuis 1945 surtout, la part la plus prolifique de la création littéraire (et depuis peu cinématographique) de Science-Fiction. L’exemple le plus connu en est le roman de Richard Matheson Je suis une légende[25] et le film qu’en a tiré Boris Sagal Le survivant (1971), qui nous dépeignent, dans un monde ravagé par un conflit planétaire, le combat des quelques rares survivants ayant encore foi en une renaissance technologique contre des mutants sacrifiant à une religion fondée sur la haine de la science. Cette idée d’une haine pour la science et d’un retour à des croyances archaïques est souvent présente dans l’oeuvre de Nietzsche. Il l’a particulièrement développée dans un paragraphe très dense de Humain, trop humain qui, prenant appui sur l’extrapolation selon laquelle la science, s’hypertrophiant monstrueusement, ne procurera plus de plaisir qu’à un nombre infime de chercheurs, évoque la dévalorisation de la connaissance et le retour à des croyances et à des modes de pensée plus prodigues en récompenses idéologiques. Nietzsche conclut ainsi ce paragraphe : « La ruine des sciences, la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate ; l’humanité devra se remettre à tisser sa toile après l’avoir, telle Pénélope, défaite pendant la nuit. Mais qui nous garantira qu’elle on retrouvera toujours la force ? » [26]. Nous trouvons dans ces quelques lignes l’intuition d’un éternel retour négatif, l’idée d’une série de recommencements ouvrant des parcours qui iraient en se rétrécissant, l’esquisse d’une entropie de la civilisation dont les spirales se réduiraientpour finalement se réduire à un point. Nous montrerons par ailleurs que cet éternel retour négatif , qui apparaît dans d’autres textes nietzschéens, a autantde réalité et d’importance que l’éternel retour positif, voire “sélectif”, que l’interprétation contestable de Gilles Deleuze a mis exagérément en avant. Si l’on s’amuse à projeter dans le passé l’hypothèse que Nietzsche situe ici dans l’avenir on aboutit à la fiction de l’Atlantide ou à tous les récits qui s’en rapprochent en supposant que 1’humanité a déjà atteint dans un passé plus ou moins lointain un stade technologique au moins égal à celui qui est le sien aujourd’hui. Certains de ces récits adoptent sans le savoir le postulat nietzschéen suivant lequel la nouvelle boucle n’aura pas nécessairement autant d’ampleur que la précédente.
Quant à l’hypothèse extrême d’une disparition totale de l’espèce humaine, point n’a été besoin d’attendre l’explosion des premières bombes atomiques pour que la S-F en parcoure les multiples éventualités. Dès 1935, dans une nouvelle intitulée La nuit [27], Don A. Stuart décrivit avec beaucoup de poésie la planète morte que découvre un voyageur temporel rejoignant la Terre en un moment où le système solaire est proche de sa fin : même les merveilleuses machines avaient fini par s’arrêter après des millions d’armées de survie à la lueur blafarde d’un soleil de fin du monde. Si l’auteur avait lu Nietzsche, il aurait pu mettre en exergue de sa nouvelle cet aphorisme de l’été 1879 : « Via Appia - enfin tout repose - un jour la terre sera un tombeau flottant dans l’espace » [28].
Nous ne pouvons évidemment, dans les limites de cette étude, mettre en relation les multiples descriptions du futur présentes dans 1’œuvre nietzschéenne et les mondes imaginaires de la S-F du vingtième siècle. On ne nous tiendra pas rigueur d’isoler ici un exemple parmi beaucoup d’autres possibles. Dans un paragraphe d’Aurore intitulé « Scènes d’un avenir possible » [29], Nietzsche décrit une société future dans laquelle « le malfaiteur se dénonce lui-même, « où il se dicte lui-même publiquement sa punition » : une telle société pourrait renoncer à tout notre arsenal policier, et son univers moral et juridique serait bien sûr très différent du nôtre. Nous retrouvons cette hypothèse au point de départ d’une intrigue fort astucieusement élaborée par William Tenn (Châtiment payé d’avance [30] : l’auteur imagine un système juridique permettant aux “candidats criminels” de purger leur peine avant de commettre leur forfait. Deux de ces candidats au crime connaissent bien des tortures psychologiques avant de renoncer finalement au crime dont ils avaient pourtant déjà purgé la punition.
Evoquons, pour mettre un terme à ce catalogue très partiel un procédé de plus en plus utilisé par la S-F contemporaine et dont on trouve également plusieurs applications chez Nietzsche : il s’ait du « présent alternatif » ou l’ « uchronie » [31], qui consiste à imaginer un autre présent – à la suite de variations plus ou moins importantes affectant les événements passés. L’américain Poul Anderson, dans une des nouvelles ayant été réunies pour composer son plus célèbre ouvrage La patrouille du temps (1960), nous donne une très curieuse description du vingtième siècle d’une histoire dans laquelle Rome aurait été vaincue par Carthage. Dans Le Maître du Haut-Château (1962), Philip K. Dick, l’un des écrivains les plus doués de ces dernières années,trace le portrait d’une Amérique dominée par les nazis et les Japonais aprèsla victoire totale de l’Axe [32]. Nietzsche les a précédés en imaginant dans Aurore un monde dans lequel les idées morales et politiques de Platon se seraient imposées : ces idées, remarque-t-il, n’étaient pas plus irréalisables que celles du christianisme ou que celles de Mahomet qui ont pourtant réussi à modeler la civilisation pour des siècles. « Quelques hasards en moins et quelques hasards en plus, et le monde aurait connu la platonisation du midi européen » [33]. La même certitude selon laquelle l’histoire n’est ni logique ni encore moins guidée par l’Esprit ou la Raison, mais n’est que le royaume du hasard, inspire Nietzsche comme les écrivains de Science-Fiction.
Vie extra-terrestre, apocalypse scientifico-technique, civilisation décadente du dernier homme, renaissance de croyances et de pratiques archaïques, disparition de la biosphère, morales et comportements révolutionnaires, présents alternatifs : aucun des chemins arpentés par l’imagination des écrivains de S-F du vingtième siècle n’était inconnu de l’auteur du Zarathoustra. Et si le film de S-F le plus remarquable de ces dernières années (certains n’hésitent pas à dire : l’un des plus beaux films de toute l’histoire du cinéma) 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, fait allusion à Nietzsche en illustrant une de ses séquences les plus importantes par la musique de Richard Strauss Ainsi parlait Zarathoustra [34], n’est-ce pas parce que Kubrick, en artiste accompli, a deviné dans l’oeuvre nietzschéenne une étonnante fraternité avec les univers de la Science-Fiction ?
4) Nietzsche théoricien de la Science-Fiction ?
On s’étonnera moins, à partir des éléments qui précèdent, de découvrir sous la plume de Nietzsche de véritables appels à une création artistique et en particulier littéraire bouleversant nos frontières spatiales et temporelles. Nous avons peu évoqué jusqu’à présent un domaine fort riche de la S-F qui répond parfaitement à ces bouleversements : il s’agit de la « politique-fiction ». Chacun connaît l’œuvre de Georges Orwell 1984 [35],devenu un classique de la littérature : l’écrivain anglais y décrivait, au lendemain de la seconde guerre mondiale, une société totalitaire dans laquelle le mystérieux « Big Brother » incarnait un pouvoir insaisissable et omniscient. Mais 1984 était encore à la limite de l’extrapolation, il se rapprochait davantage des scénarios construits aujourd’hui par les futurologues et leurs ordinateurs que des récits éclatés de la nouvelle S-F. Depuis quelques années la S-F, et en particulier la S-F française, souvent très politisée, construit des univers politiques qui semblent parfois, au premier abord, assez proches des nôtres. Mais les références à notre réalité historique n’y sont que des mirages destinés à nous faire perdre pied au moment où nous croyons trouver un rassurant appui. La torture psychologique à la fois si proche et si lointaine dont usent les maîtres du futur qui hantent les nouvelles d’un Dominique Douay [36], les mondes à la fois si familiers et si étranges d’un Jean-Pierre Andrevon [37], font de la politique-fiction une invention du futur qui n’a plus rien à voir avec les extrapolations de la S-F classique. Est-il interdit de penser que c’est à des créations de ce type que songeait Nietzsche lorsqu’il appelait de ses voeux une production imaginaire libérée des tabous du réalisme et de la servitude historique. Les auteurs de la nouvelle S-F ne sont-ils pas ceux qui répondent le mieux à l’appel lancé par le philosophe en 1877 : « Pourquoi ne pas imaginer entièrement des histoires de peuples, de révolutions, de partis politiques ? Pourquoi le romancier ne rivalise-t-il pas avec l’historien ? Je vois là un avenir pour la poésie » [38]
Quatre ans plus tard, dans Aurore, l’interpellation nietzschéenne se fait plus pressante et traduit un désir plus ardent encore. Le philosophe demande aux poètes de redevenir des « voyants », il attend des créateurs littéraires qu’ils soient les peintres du futur, les démiurges de l’improbable, il supplie les écrivains de s’arracher au présent, de décoller du réel, de rompre les amarres : « S’ils voulaient nous faire ressentir quelque chose des vertus futures ! Ou des vertus qui n’existeront jamais sur la terre, bien qu’elles puissent exister quelque part au monde, - des constellations flamboyantes de pourpre et des immenses voies lactées du beau ! Où êtes-vous, astronomes de l’idéal ? » [39] Là encore, n’est-ce pas la S-F qui a su, mieux que tout autre courant artistique, relever le défi nietzschéen ? On nous objectera que la psychologie des extra-terrestres ou des terriens du futur n’a bien souvent été qu’une facile projection des comportements et des structures mentales do du vingtième siècle, que les conflits si abondamment décrits par le « space opera » [40] n’étaient que l’agrandissement galactique des luttes terrestres entre grandes puissances ou de médiocres avatars de la guerre froide : c’est bien entendu parfaitement exact. Mais la S-F a su depuis une vingtaine d’années (et avait déjà su chez les plus grands auteurs de l’époque antérieure) rompre avec ces stéréotypes et libérer toutes les puissances de l’imaginaire. Ces vertus extra-terrestres dont Nietzsche réclamait la peinture, nous en trouvons unétonnant catalogue dans les écrits de la nouvelle Science-Fiction. Ainsi dans Le temps des changements [41], Robert Silverberg dresse le portrait psychologique des hommes d’une civilisation lointaine dans laquelle le « Moi » est non seulement haïssable, mais rigoureusement prohibé, ce tabou constituant le pilier de la morale et de l’ordre social de ce monde. La rencontre d’un individu de cette planète, qui a toujours cru que parler de soi était la faute la plusgrave, avec un terrien fier de son individualité, provoquera un conflit fort habilement analysé. Seuls les auteurs de S-F ont eu. l’audace d’imaginer entièrement des mondes avec leur histoire, leur culture, leur morale, leur science et leur technologie : les « astronomes de l’idéal » réclamés par Nietzsche ne sont-ils pas aujourd’hui des romanciers comme Frank Herbert, qui nous a donné avec Dune [42] l’une des fresques les plus achevées de la S-F et l’une des descriptions le plus riches et les plus cohérentes d’une civilisation étrangère â la nôtre, ou comme Cordwainer Smith (de son vrai nom Paul Linebarger), ce diplomate américain qui a consacré tous ses loisirs à rêver aux Seigneurs de l’Instrumentalité [43], nous apportant avec eux l’un des univers les plus étrangesde la littérature contemporaine ?
Notre interrogation se change en certitude à la lecture de ce fragment de l’automne 1880, dans lequel on peut voir non seulement un appel à une création imaginaire déchaînée mais une sorte de manifeste que pourraient faire leur tous les auteurs de Science-Fiction : « Les poètes ont encore à découvrir les possibilités de la vie, l’orbite stellaire s’ouvre devant eux, non plus Arcadie ni une vallée de Campanie : une imagination d’une audace sans limite, soutenue parles connaissances de l’évolution animale, est possible. Toute notre poésie est d’un terre-à-terre si « petit-bourgeois », la grande possibilité d’hommes supérieurs fait encore défaut. C’est seulement après la mort de la religion que pourra de nouveau proliférer l’invention dans le domaine du divin [44]. Le doute n’est désormais plus permis ; on ne saurait voir dans ce texte une simple accumulation de métaphores. C’est bien dans une création imaginaire capable de vaincre l’attraction terrestre pour se laisser attirer dans le sillage des étoiles, c’est bien dans une poésie cosmique n’hésitant pas à se situer à l’échelle galactique et non plus à celle de l’Arcadie, que le philosophe met ses espoirs. Après avoir souhaité en 1877 que les romanciers de l’avenir construisent des mondes aussi crédibles et cohérents que ceux décrits par les historiens, il attend en 1880 qu’une imagination libérée de toute barrière spatiale ou temporelle donne à la création artistique un autre souffle, une nouvelle dimension, et peut-être une force comparable à celle qu’avait le mythe dans la civilisation hellénique. A cette « imagination audace sans limite » répondent aussi bien les épopées galactiques du space opera que les recherches plus exigeante guidées par l’impulsion visionnaire dont se réclame l’anglais Moorcock, fondateur de la nouve1le Science-Fiction tt l’un de ses plus brillants représentants [45]. S’il est inévitable que cette absence de limites conduise souvent à des productions marquées par la facilité ou à l’inverse gâchées par un hermétisme suspect, elle est aussi à l’origine d’oeuvres d’une grande force poétique et visionnaire. Nous avons déjà montré comment « les connaissances de l’évolution animale » pouvaient servir de fil conducteur au roman de Simak Demain les chiens dans lequel une autre espèce dominante a succédé à la race humaine. Ces connaissances guident aussi la plus belle oeuvre de Theodore Sturgeon Les plus qu’humains [46] qui nous suggère comment cinq individus anormaux (dont un enfant trisomique) fontla synthèse de leurs pouvoirs particuliers et forment de cette manière uneentité nouvelle supérieure aux membres les plus brillants de la race humaine. La S-Fest pratiquement la seule à avoir su parcourir les « possibilités de la vie » â la découverte desquelles Nietzsche invitait les poètes. Depuis le début du sicle, elle a multiplié à l’infini les formes de vie dont notre planète offre pourtant déjà un échantillon d’une fantastique diversité, elle a surtout fait éclater les limites à l’intérieur desquelles se déplloie la vie terrestre en situant bien souvent l’homme à un degré le rapprochant davantage de l’amibe que des êtres les plus évolués. Quant â la « mort de la religion » située par Nietzsche dans un futur apparemment assez proche, André Malraux avait l’habitude de la considérer comme un phénomène contemporain. S’il avait raison, nous devrions commencer aujourd’hui à voir se manifester cette « invention dans le domaine du divin » prophétisée dans le texte cité. Ne peut-on en voir les prémisses dans l’onirisme sansfrein des meilleurs écrivains de S-F contemporains ? Parmi ces « inventeurs de divin », retenons ici l’américain Philip José Faner conjuguant dans Le faiseur d’univers[47] psychanalyse, cosmogonie et théologie, afin de nous retracer le fabuleux périple d’un homme-dieu retrouvant peu à peu la mémoire en gravissant les étages du monde dontil a oublié qu’il était le créateur, il nous propose une odyssée dignedes poètes antiques mais reflétant incontestablement les conceptions et la sensibilité d’une culture qui est bien celle de la « mort de la re1igion ». Quant à l’expression « invention dans le domaine du divin », elle pourrait prêter à contresens si elle n’était éclairée par l’allusion aux « hommes supérieurs » qui la précède immédiatement. Elle signifie en réalité invention dans le domaine du Surhumain, notion que le philosophe ne possède point encore en 1880 même si de nombreux aphorismes en préparent la venue. En nous offrant un extraordinaire kaléidoscope d’ « hommes supérieurs », en parcourantl’infinité des pouvoirs créateurs d’une humanité apte aux plus prodigieuses métamorphoses, la S-F n’est-elle pas aujourd’hui l’un des lieux privilégiés où se construit l’espèce à venir ? Elle a du moins pour effet d’étendre à des millions d’hommes la « grande nostalgie » éprouvée par Zarathoustra après qu’il ait été visité par l’ombre de la beauté du Surhomme : et cette nostalgie n’est-elle pas le moteur encore invisible des révolutions futures ?
La S-F est peut-être par excellence le laboratoire de cette civilisation expérimentale dont le philosophe allemand nous invitait à être les membres volontaires : « Nous sommes des expériences : soyons-le de bon gré ! » [48]. La prolifération des êtres, des cultures et des futurs créée par la S-F ne peut que nous y aider.
Conclusion
La parenté, dont nous avons tenté de dénouer les liens, entre la pensée nietzschéenne et la Science-Fiction, concerne donc aussi bien les intuitions initiales et les méthodes utilisées que les thèmes développés ; les appels lancés par le penseur en faveurd’une création artistique soutenue par une « imagination d’une audace sans limite » suffisent à justifier un rapprochement a priori peu évident. Cette parenté semble avoir pour fondement une conception du temps révolutionnaire au moment où Nietzsche l’a élaborée et que la S-F a puissamment contribué à « vulgariser » (au sens le plus noble comme au sens le plus péjoratif du terme).
Au schéma temporel imposé par le judéo-christianisme, celui d’un temps linéaire s’inscrivant nécessairement entre une origine déterminante et un point oméga programmé dès l’instant zéro, schéma à l’intérieur duquel s’est installée la dialectique hégélienne comme le matérialisme dialectique, se substitue une autre temporalité privilégiant la dimension du futur et ouvrant l’avenir à l’infini des possibles. Cette nouvelle conception du temps doit beaucoup aux grandes découvertes scientifiques du XIXème siècle, particulièrement aux découvertes biologiques et à la théorie évolutionniste. Si Darwin a, nul ne l’ignore, profondément marqué la pensée nietzschéenne, il fut aussi, on le sait moins, la lecture préférée de celui qu’on considère comme le véritable père de la Science-Fiction moderne : l’anglais H.G. Wells. Nous tenons sans doute avec l’auteur de L’origine des espèces un début de solution à notre problème. En effet la conviction scientifique selon laquelle l’homme n’est qu’un nouveau-né dans une chaîne biologique de plusieurs milliards d’années a pour conséquence d’ouvrir les portes de l’avenir ; la temporalité de l’espèce se substitue à celle de l’individu en permettant un brusque changement d’échelle. Alors que Hegel interdisait au philosophe de franchir le Rhodus et se gaussait de celui qui s’imagine dépasser son temps.
Nietzsche n’hésite pas à bondir par dessus les millénaires en parcourant vers l’avenir le temps que Darwin avait remonté vers les origines : « Avançons ensemble de quelques milliers d’années, mes amis ! Il y a encore beaucoup de joie réservée aux hommes, dont le parfum même n’est pas encore arrivé aux vivants d’aujourd’hui », écrit-il dans Le voyageur et son ombre [50]. Mais Nietzsche se sépare radicalement de ceux qui voudraient réinscrire le transformisme darwinien dans le temps linéaire judéo-chrétien en bouclant l’évolution par une origine divine et/ou un aboutissement nécessaire. I1 ne cesse de rappeler que l’avenir n’est pas joué, qu’il appartient à l’homme de donner un sens à un processus historique qui en soi n’en a aucun. Ainsi le texte que nous venons de citer se poursuit par un voeu teinté d’inquiétude : « Nous avons certes le droit de nous promettre cette joie, bien mieux, de la prédire et de l’évoquer comme un événement nécessaire, pourvu que de la raison humaine ne s’arrête pas » [51]. L’avenir n’est en effet ouvert que parce que le passé lui-même ne répond à aucune finalité, que parce que l’histoire, fruit de la contingence, n’a aucun sens : mais cette histoire a produit sans le vouloir et sans le savoir, un être capable aujourd’hui de donner une signification à son devenir, capable de prendre en main sa propre évolution, et de se réconcilier par là avec le monde et avec le temps. « L’humanité peut d’ores et déjà faire absolument d’elle-même ce qu’elle veut » [52] : cette certitude exprimée nettement dès 1879 donne son sens aux paroles de Zarathoustra et éclaire les derniers écrits de Nietzsche. Elle est partagée par les écrivains de S—F qui, beaucoup plus sérieux que les futurologues, ne prétendent pas à la « logie » du futur mais seulement à la fiction de l’avenir. Cela signifie-t-il que la S-F se contente de rêver en laissant à d’autres le soin d’agir et de préparer effectivement cet avenir ? Ou au contraire, n’est-ce pas parce qu’elle sait se libérer du présent, comme a su le faire l’auteur des Inactuelles, que la S-F contribue à la construction du futur, parce qu’elle se réclame de l’imagnation qu’elle est réellement agissante ?
A la fin du XIXème siècle, Nietzsche nous a offert deux images : celle du « dernier homme » et celle du « Surhomme ». La S-F du siècle nous en a donné mille et une répliques, bâtissant par ses anti-utopies tous les univers de la décadence possible et rêvant les multiples formes de paradis galactiques et d’individus aux pouvoirs créateurs inouïs. La fonction du « dernier homme » et des anti-utopies est presque évidente : c’est une fonction préventive que Nietzsche avait rapidement perçue, puisque après avoir évoqué, dans Humain, trop humain un retour possible de l’homme au stade du singe, il affirme que « c’est justement parce que nous pouvons envisagercette perspective que nous serons peut-être être en état de parer à un tel aboutissement de l’avenir » [53]. L’abondance de la S-F apocalyptique de ces dernières décennies nous laisse à penser que ce doit être un mal extrême qui exige une aussi violente thérapeutique, mais on peut à l’inverse supposer que le déchaînement récent des images catastrophiques est déjà 1’indice d’une proche guérison. Quant à l’image du Surhomme et aux créations encore trop imparfaites qui en sont la continuation dans la S-F contemporaine, n’est-il flac encore trop tôt pour leur assigner un rôle qui ne pourrait aujourd’hui être conçu que de façon réductrice ? Ce n’est nullement se dérober que de laisser ouverte une telle interrogation, et de se contenter, en guise de conclusion, de supposer qu’à l’ombre de l’image grandiose du Surhomme, les allégories de la S-F contribuent à promouvoir la figure de l’être qui succédera à celui que la mort de Dieu a condamné à la métamorphose : ce n’est pas fuir que d’inviter maintenant le lecteur à écouter, à travers les rêves de la S-F, « l’avenir qui dicte sa règle à notre présent » [54].
Philippe Granarolo
NOTES
21) Aurore, livre I, § 45 (O.C., p. 48).
22) Fragment posthume, hiver 1880-1881, in Aurore, O.C., p. 673.
23) Ainsi parlait Zarathoustra, prologue, § 5.
24) Parmi les dizaines d’ouvrages ayant précédé Le meilleur des mondes de Huxley, ou ayant repris le même thème, on peut retenir Quand le dormeur s’éveillera de Welles (1899), Métropolis de Théa Von Harbou (mis en scène par son mari le grand Fritz Lang), Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (1951) adapté au cinéma par François Truffaut, et plus près de nous Les monades urbaines de Silverberg (1960) et Soleil chaud, Poisson des profondeurs de Michel Jeury (1976).
25) Ed. Denoël, collection « Présence du futur ». Sur le même thème, parmi une production considérable, on peut détacher Cantique pour Leibowitz de Walter M. Miller (1959), Rêve de fer de Norman Spinrad et Malevil de Robert Merle (1972).
26) Humain, trop humain, livre IV, § 251 (« L’avenir de la science », O.C. p. 176).
27) Night, nouvelle publiée en 1935 dans la revue Astounding Stories par Don A. Stuart, pseudonyme de John W. Campbell, auteur qui devait jouer un rôle décisif dans l’évolution de la S-F avant de se consacrer uniquement à la direction de la revue Astounding qu’il assura jusqu’à sa mort en 1971. On trouve une traduction de cette nouvelle dans le recueil déjà signalé Les meilleurs récits d’Astounding Stories.
28) Fragment posthume juillet 1879 (in Humain, trop humain, 0.C., tome II p. 413).
29) Aurore, livre III, § 187 (O.C., p. 141). L’aphorisme se conclut par cette affirmation que ferait volontiers sienne n’importe quel écrivain de S-F : « Bien des tentatives doivent encore être faites ! Tant d’avenir doit encore voir le jour ! ».
30) Time in advance de W. Tenn, nouvelle initialement parue dans la revue américaine Galaxy en août 1956, et traduite dans le volume n° 8 de la revue Marginal (juillet-août 1975, Editions Opta).
31) Cf. l’article « Uchronie » dans l’encyclopédie de Pierre Versins déjà citée. Il n’est pas sans intérêt de noter qu’en 1876 paraissait un ouvrage anonyme ayant pour titre Uchronie, Esquisse historique du développement de la civilisation européenne tel qu’il n’a pas été, tel qu’il aurait pu être, et que la préface de l’ouvrage était signée Charles Renouvier.
32)La patrouille du temps de Poul Anderson (Editions Marabout). Le maître du haut château de Ph.K.Dick (Ed. J’ai Lu). Lemême procédé est utilisé parKeith Roberts dans Pavane (Ed. Opta,1971) qui décrit un monde occidental dominé par la papauté à la suite de l’assassinat d’Elizabeth 1er d’Angleterre et du triomphe de l’Invincible Armada.
33)Aurore, livre V, & 496 (“Du principe mauvais », O.C.p.256).
34) Poème symphonique composé en 1896 par Richard Strauss en hommage à Frédéric Nietzsche.
35)Collection « Folio » ,Gallimard.
36) Par exemple dans sa nouvelle Venceremos ! publiée dans le périodique Univers (n°1, juin 1975, Ed. « J’ai Lu »).
37)Cf. en particulier son recueil de nouvelles Cela se produira bientôt (Ed. Denoël, collection « Présence du futur »). J.P. Andrevon peut être considéré comme le chef de file de cette école française de S-F qui, malgré un goût excessif pour certaines complications formelles souvent gratuites, a apporté un souffle original à un courant dominé jusqu’alors presque exclusivement par les anglo-saxons.
38)Fragment posthume été 1877 (0.C. Humain,trop humain, T.I, p.473.
39) Aurore, livre V, §551 (« Des vertus futures », .0.C. p.281.
40) « Opérade l’espace », genre privilégié dans les années 1930-1950, et consistant à décrire de vastes entreprises de colonisation à l’échelle de l’univers ou de grandioses conflits galactiques. C’est ce type dé littérature qui, malheureusement, résume le plus souvent pour le profane le vaste domaine qu’est la S-F, ce qui détourne bien des lecteurs « cultivés » d’un genre pourtant extrêmement riche et divers.
41) Le temps des changements, de Robert Silverberg, (Ed. Opta, collection « Anti-Mondes” (1971).
42) Ed. Robert Laffont, collection « Ailleurs et demain ». Publié en 1965.
43)Publié en 1959. Traduit en français aux Ed. .Opta (« Club du livre d’anticipation »). Le meilleur jugement sur Cordwainer Smith nous est donné par un autre grand romancier de S-F Rlobert Silverberg qui a pu dire: “Je pense que Smith est un visiteur d’une époque éloignée du futur vivant parmi nous, peut-être comme un exilé de sa propre ère historique, ou peut-être simplement en touriste, et s’usant à projeter une partie de ses connaissances du futur sous forme de science-fiction »
44) Fragment posthume automne 1880 (in Aurore, O.C., p,565-566).
45)Auteur de Elric le Nécromancien, ouvrage appartenant à ce que les anglo-saxons nomment l’ « héroïc fantasy », de Voici l’homme, et du Programme final (Ed. Opta). Moorcock écrit dans sa préface à l’anthologie The New S-F : « L’impulsion visionnaire s’est extrêmement raffinée depuis l’époque de Wells et d’Huxley. Aujourd’hui les romanciers assurent de plus en plus les responsabilités du poète ; ils cherchent à accorder leur technique à leur vision. Ils continuent à inventer une imagerie qui s’accorde à leur propos, et des techniques narratives qui s’accordent à l’un et à l’autre » (c’est nous qui soulignons).
46) Publié en 1933. Traduction française aux Ed. « J’ai Lu ».
47) Publié en 1963.Traduction française aux Ed. Opta (collection “Anti-Mondes »). Une autre belle réussite de la « mytho—fiction » est le livre de Roger Zélazny L’île des morts (Ed. « J’ai Lu »).
48) Aurore, livre V,& 453(« Interrègne moral », O.C., p.241.
49)Cf. en particulier la préface de la Philosophie du Droit.
50) Le voyageur et son ombre, § 183 (« Colère et châtiment ont fait leur temps », in Humain, trop humain, 0.C. p.234.
51) Ibidem.
52) Opinions et sentences mêlées, § 179 (« Bonheur de ce temps », in Humain, trop humain, O.C., tome II, p. 234.
53) Humain, trop humain, livre V, § 247 (« L’ humanité tourne en rond », O.C., p.173.
54) Humain, trop humain, préface de 1886, § 7 (O.C., p. 20). Evoquant la mission de l’ « esprit libre », Nietzsche nous dit alors : « C’est notre vocation qui dispose de nous, même quand nous ne la connaissons pas encore; l’avenir qui dicte sa règle à notre présent ».