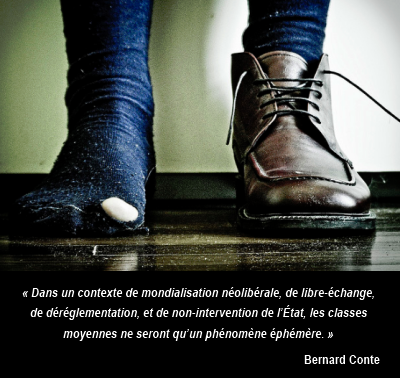Nous reproduisons ci-dessous un point de vue du directeur de B.I. Infos, Louis Dalmas, cueilli sur Enquête&Débat et consacré à la nécessaire révolte des peuples contre les oligarchies criminelles qui les dominent...

L'avertissement aux criminels
Comment faire entendre la voix des peuples ? Pour pouvoir écouter cette voix, il faut avoir une idée de ce qu’elle peut dénoncer, c’est-à-dire l’état de notre monde occidental actuel. Quel est cet état ? C’est simple. C’est un espace en trompe l’œil dirigé par des criminels qui ont recours au mensonge pour maintenir leur domination.
Les mots peuvent vous paraître durs. Ils correspondent pourtant à une réalité. Je vais essayer de les justifier en les reprenant un à un..
Un espace en trompe-l’œil. Nous vivons dans un monde de fausseté. Les prêcheurs de vertu sont de faux innocents, les engagements électoraux sont de fausses promesses, les stars “pipoles” sont de fausses idoles, les soi-disant philosophes sont de faux sages, l’érotisme médiatique est une fausse sexualité, la publicité est une fausse documentation, les nouvelles de journaux sont une fausse connaissance, les copies d’objets de luxe sont de fausses richesses. Tout,cela, on le voit tous les jours. Mais il y a beaucoup plus grave. Dans trois domaines.
1) Un des deux ressorts les plus importants de l’activité humaine – l’autre étant le sexe – est l’argent. Or l’argent n’existe pratiquement plus sous une forme tangible. Sa représentation concrète – la monnaie – s’est peu à peu déréalisée. L’objet monnaie est devenu d’abord une image, avec les divers billets de la monnaie fiduciaire, puis un simple jeu d’écritures, l’enregistrement sur des machines de la monnaie scripturale, qui assure aujourd’hui 90 % des transactions dans le monde. L’argent n’a plus de présence matérielle : il alimente un formidable monde virtuel, qui est en lui-même une aliénation totale de l’instrument de nos échanges en société. Ce monde virtuel, qui ressemble à celui d’Alice derrière le miroir ou aux univers parallèles de la science-fiction, s’est gonflé en une sorte d’énorme cancer financier ayant perdu tout contact avec la réalité de la production et du travail.
2) Deuxième domaine en trompe-l’œil : la représentation démocratique. La soi-disant “démocratie“ occidentale, sans cesse brandie comme garantie de civilisation, n’est qu’un leurre. Son exercice est réservé aux individus riches ou aux organisations puissantes, capables de financer des campagnes électorales qui coûtent cher. Les résultats de consultations populaires, comme des référendums, sont remis en question jusqu’à ce que le peuple vote dans le bon sens. Les principales instances de direction européenne ne sont pas élues. L’ONU et les parlements nationaux sont ignorés quand il s’agit de faire la guerre. La démocratie parlementaire n’est qu’un alibi servant à justifier l’existence d’une caste de politiciens professionnels plus soucieux de leurs carrières que des intérêts de la nation.
3) Troisième domaine en trompe-l’œil : la démagogie faussement morale des “droits de l’homme“, de la “protection des civils“ (qui consiste à les bombarder) et du “devoir d’ingérence“, utilisée pour agresser les Etats manifestant des velléités d’indépendance. Cette gigantesque fabrication morale, destinée à faire croire aux peuples que leurs gouvernements se battent pour la vertu contre le vice, pour le bien contre le mal, ne sert qu’à dissimuler les véritables buts économiques et pétroliers de la nouvelle colonisation impériale.
Ce monde en trompe-l’œil est dirigé par des criminels. Un mélange de faux monnayeurs et d’assassins. Les faux monnayeurs – le terme n’est pas de moi, il est du prix Nobel français d’économie Maurice Allais – sont les banques qui ont volé aux établissements nationaux le pouvoir de création de la monnaie, qui ont remplacé les gouvernements à la tête des grands pays industrialisés et qui étranglent les Etats par les intérêts des dettes souveraines qu’ils les ont obligés à contracter.
Leurs hommes, à l’image de ceux de Goldman Sachs par exemple, ont carrément pris le contrôle de pays entiers comme la Grèce, l’Italie et l’Espagne.
Les assassins sont les matamores de Washington, Londres ou Paris, et leurs complices, qui déclenchent des guerres et tuent leurs opposants. Cinq guerres en deux décennies – Yougoslavie, Irak, Afghanistan, Côte d’Ivoire, Libye ; des dizaines de milliers de victimes civiles ; des Etats rayés de la carte ; des économies détruites ; des régions ravagées. Des meurtres d’individus ciblés, par des drones téléguidés ou des commandos spéciaux, comme les savants iraniens ou Oussama ben Laden. Des chefs d’Etats éliminés, ou en voie de l’être. Milosevic, qu’on a laissé mourir. Castro et Chavez, objets de multiples tentatives d’assassinat. Ceaucescu et Kadhafi, lynchés. Saddam Hussein, exécuté après une parodie de procès. Gbagbo renversé et emprisonné.
Il n’est pas question de porter un jugement sur ces hommes, encore moins de prendre aveuglément leur défense. Il s’agit simplement de souligner la méthode sanglante désormais utilisée ouvertement, qui remplace un monde de justice par un monde d‘assassins se servant de l’OTAN et de tueurs à gages pour supprimer par la violence toute velléité d’opposition.
Des criminels qui ont recours au mensonge pour maintenir leur domination. Le pouvoir des banques et le retour politique à la barbarie s’appuient sur une impressionnante machinerie de propagande dont on a peine à imaginer la portée et l’efficacité. Cela va d’un déluge de dénigrement des soi-disant “dictateurs“ dont on veut se débarrasser aux campagnes de justification des guerres impériales, en passant par l’entretien de la terreur d’un effondrement économique nécessitant le sauvetage des banques, tout cela bien entendu fabriqué de toutes pièces à coups de calomnies, d’affirmations trompeuses et de manipulations des médias.
Le résultat est qu’un gouffre se creuse tous les jours davantage entre les peuples et leurs gouvernants. C’est sans doute un des phénomènes les plus spectaculaires de notre actualité. J’ai évoqué longuement ce gouffre dans mes deux livres “Le crépuscule des élites“ et “Le bal des aveugles“. La perte de confiance dans les dirigeants de la société se manifeste par un sentiment d’impuissance (le désintérêt pour la politique et les abstentions aux consultations électorales) ou la montée de la colère (les printemps arabes, les révoltes de la faim dans le Tiers monde, les manifestations publiques et la rage des indignés dans de nombreux pays européens, etc.) Des signes avant-coureurs d’un soulèvement encore balbutiant et inorganisé, mais qui s’oriente peu à peu vers une fracassante explosion.
La voix des peuples commence à se faire entendre. Elle est multiforme : spontanée, provoquée et entretenue par les gens qui ont intérêt à la subversion, infiltrée par les maîtres qui cherchent à la contrôler, mais elle s’exprime de plus en plus. A nous de l’aider à se rendre consciente, c’est-à-dire à formuler ses objectifs. Ces objectifs me paraissent clairs, bien qu’aucun politicien ne les précise avec rigueur : refuser de payer les intérêts des dettes souveraines : annuler ces dettes ou tout au moins les renégocier ; abolir le pouvoir des banques en séparant celles de dépôt de celles de spéculation (comme l’avait fait jadis la loi Glass-Seagall) ; rendre la main aux Etats en leur permettant d’emprunter à leurs banques nationales ; rejeter les mesures d’austérité qui étranglent les peuples et ne font que creuser de nouveaux trous à boucher ; prendre l’argent où ils se trouve (et où il y en beaucoup) en imposant fortement les grandes fortunes ; sortir de l’entreprise de destruction massive qu’est l’OTAN ; récupérer les sommes colossales dilapidées dans les opérations militaires ; rejeter l’emprise des marchés et du système économique néo-libéral ; se libérer des contraintes de l’hégémonie impérialiste américaine en retrouvant la souveraineté de la nation. Ce ne sont que quelques idées parmi d’autres. Mais elles ont le mérite de se distinguer franchement des rustines appliquées par la droite et la gauche au pneu crevé du capitalisme occidental.
Nous vivons dans un Occident économiquement pourri, dirigé par des gangsters, avec des peuples dupés par leurs maîtres. Il est grand temps de réagir. On nous demande “comment faire entendre la voix des peuples“ ? Ce n’est pas compliqué. Il faut soutenir ceux qui, comme nous, comme notre journal, comme nos livres, comme nos amis, font écho à cette voix. Avec un message limpide : il faut cesser de faire payer par les pauvres les méfaits des riches. Le système actuel ne peut pas durer. La croûte des dominants danse sur un volcan. Nous devons leur faire craindre d’être balayés par son éruption.
Louis DALMAS (Enquête&Débat, 29 novembre 2011)