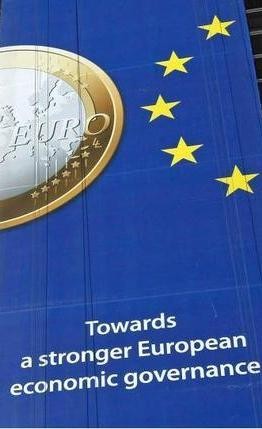Nous reproduisons ci-dessous un article d'Alain Frachon, cueilli dans le quotidien Le Monde, qui dresse un constat inquiétant et pose, au final, une question essentielle. On aimerait savoir ce qu'en pensent les candidats à l'élection présidentielle...
Tout le monde réarme, sauf les Européens
La Russie réarme, à grande vitesse. La Chine pourrait doubler son budget de la défense d'ici à 2015. Les Etats-Unis entendent rester la première puissance militaire mondiale. Un seul continent désarme, comme s'il avait chassé la guerre de son horizon : l'Europe. Est-ce que c'est important ?
Commençons par l'actualité la plus récente, celle des propos fracassants tenus par Vladimir Poutine au début de la semaine. A quelques jours de l'élection présidentielle du 4 mars, qu'il n'imagine pas perdre, M. Poutine a annoncé le plus gigantesque programme militaire russe depuis la fin de la guerre froide. L'une de ses priorités sera de moderniser et de transformer de fond en comble l'appareil militaire du pays, écrit-il dans le quotidien Rossiyskaya Gazeta.
L'ennemi principal est désigné : l'Ouest. La plus grande menace qui pèse sur la Russie, celle qui peut rendre obsolète son arsenal de missiles, est le bouclier antimissile américain, poursuit le premier ministre. Ce système de défense antimissile, auquel Washington a proposé à Moscou de participer, est censé protéger l'Europe. Vladimir Poutine ne l'entend pas ainsi. "Nous devons contrer les efforts des Etats-Unis et de l'OTAN en matière de défense antimissile", assure-t-il. Pas question d'accepter l'offre de collaboration des Etats-Unis : "On ne saurait être trop patriotique dans cette affaire", dit l'ancien président ; la réponse de la Russie sera "de tenir en échec le projet américain, y compris sa composante européenne".
Dans les dix années à venir, M. Poutine prévoit de passer pour 772 milliards de dollars (583 milliards d'euros) de commandes militaires. La liste des courses est éclectique : 400 nouveaux missiles balistiques intercontinentaux ; 2 300 blindés de la dernière génération ; 600 avions de combat ; 8 sous-marins porteurs de missiles nucléaires et 50 bâtiments de surface - sans compter une palanquée de matériels plus légers.
A l'arrivée, en 2022, le poste défense dans les finances publiques russes représentera de 5 % à 6 % du produit intérieur brut (PIB) du pays.
La plupart des experts s'accordent sur trois points. L'état de l'armée russe actuelle n'est pas brillant et justifie une politique de modernisation. Mais le programme de M. Poutine n'en est pas moins marqué par quelque chose qui relève de la paranoïa. Enfin, il est à peu près sûr que l'industrie de défense russe est incapable de fournir ce que lui demande le candidat.
Le deuxième effort militaire le plus notable sur la planète est celui de la Chine. D'ici à 2015, son budget militaire aura doublé, estiment cette semaine les spécialistes de la revue Jane's Defence. Il devrait alors atteindre 238 milliards de dollars (180 milliards d'euros). Cela fait plus de vingt ans que son taux de progression est à deux chiffres.
Jane's Defence juge que le total des dépenses militaires chinoises se montera à 120 milliards de dollars en 2012, soit plus que le budget militaire combiné des huit premiers membres de l'OTAN, à l'exception des Etats-Unis. Méfiants et très concernés, les Japonais assurent que les Chinois ne donnent pas les vrais chiffres de leurs dépenses militaires. Jane's Defence considère qu'elles ne sont pas disproportionnées : elles représenteraient 2 % du PIB de la deuxième économie mondiale.
Qui est l'ennemi ? Cette fois encore, les Etats-Unis. Mais les analystes de la politique de défense chinoise disent que Pékin n'a aucunement l'intention d'égaler la puissance militaire américaine. Le premier objectif stratégique des Chinois est de protéger leur environnement maritime, ces 1 800 kilomètres de côtes qui s'étirent de la mer Jaune au nord à la mer de Chine méridionale. Voies d'eau essentielles qui acheminent une énorme partie de l'approvisionnement énergétique et alimentaire du pays.
La Chine considère que cette zone maritime relève de sa tutelle. C'est là, et pas ailleurs, qu'elle entend afficher sa prépondérance. Les armes qu'elle développe - missiles anti-porte-avions, porte-avions, bombardiers furtifs - n'ont qu'un objectif : chasser les Etats-Unis du Pacifique occidental.
Les Américains ne vont pas se laisser faire. Au contraire. Ils veulent rester une puissance militaire écrasante - plus de 40 % de l'effort militaire mondial à eux seuls. Avec plus de 700 milliards de dollars, leur budget de défense 2011 est à peine inférieur à ce que M. Poutine veut dépenser d'ici à 2022.
L'Amérique sort de dix ans de guerre, en Irak et en Afghanistan, avec des résultats mitigés. Lancés par George W. Bush, qui a simultanément diminué les impôts, ces deux conflits ont fait exploser la dette américaine.
Pour des raisons financières et stratégiques, Barack Obama veut dégager les Etats-Unis de ces engagements prolongés à l'étranger. Il a commencé à réduire le budget de la défense, un peu. L'objectif affiché est de passer en dix ans d'un volume de quelque 700 milliards de dollars annuels à un peu moins de 500. Ce qui devrait assurer aux Etats-Unis une domination militaire incontestée jusqu'au beau milieu du siècle...
Mais M. Obama réoriente aussi les priorités stratégiques du pays. Il veut contrer le projet chinois : l'Amérique restera, dit-il, une puissance militaire du Pacifique. Elle y renforce ses alliances et en noue de nouvelles. Aucune coupe dans le budget de la défense ne concernera cette région. Le réalignement américain se fait aux dépens de l'Europe.
Il n'y restera bientôt plus que 30 000 soldats américains, contre 100 000 encore à la fin de la guerre froide.
L'Europe choisit ce moment précis pour désarmer. Massivement. Elle ne s'estime pas concernée par la course aux armements alentour. Ni par le retrait américain du Vieux Continent ou par les années de turbulences qui s'annoncent au Proche-Orient.
A l'exception de la France et de la Grande-Bretagne, tous les pays européens taillent dans leur défense. Ils avancent qu'ils modernisent et rationalisent leurs armées. Mais l'argument cache mal la réalité : les Européens désarment. Renonceraient-ils à être l'un des acteurs du siècle ?
Alain Frachon (Le Monde, 23 février 2012)