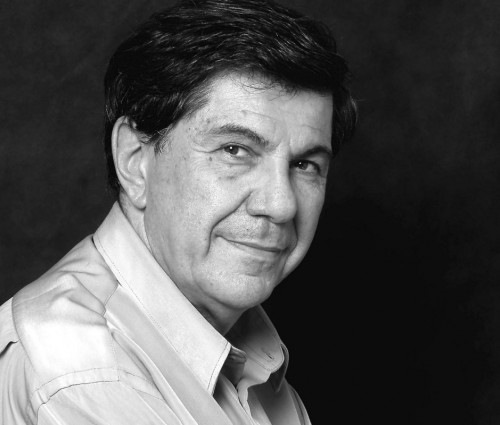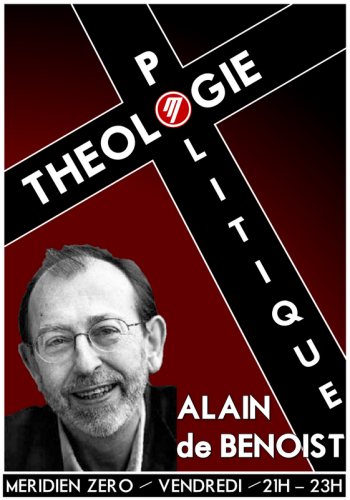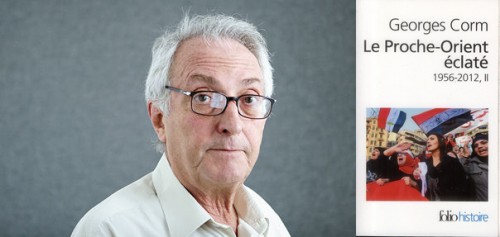Un retour vers la défense citoyenne ?
A l’heure où les autorités politiques, de droite comme de gauche, transforme l’armée française en une armée de poche ; où la criminalité s’amplifie et devient toujours plus violente dans les zones urbaines, que le citoyen est victime d’une surveillance généralisée étatique et extra-étatique, qu’il subit une pression fiscale de plus en plus lourde, THEATRUM BELLI se tourne vers Bernard Wicht, qui dans son dernier livre « Europe Mad Max demain ? le retour de la défense citoyenne » prône « un retour à l’initiative individuelle » et « la formation de petites communautés organisées » pour à nouveau prendre son destin en main et assurer soi-même sa propre sécurité…en s’appuyant sur la figure du « citoyen-soldat ».
THEATRUM BELLI : Les électeurs helvétiques viennent massivement de voter à 73% pour le maintien du concept démocratique de citoyen-soldat ? Quel est votre sentiment sur résultat de ce vote ?
Bernard WICHT : C’est réjouissant ! Selon mon analyse, l’argument qui a eu le plus d’impact est celui de l’ « obligation » (pas nécessairement militaire), c’est-à-dire l’opinion – y compris dans les milieux peu sensibles aux questions militaires – qu’une société ne peut exister « sans obligation », que le citoyen se doit d’accomplir une activité au service de la communauté. L’unanimité des cantons (26) en faveur de l’obligation de servir est également particulièrement frappante dans ce sens-là. En revanche, la notion de liberté républicaine (les citoyens participant à la gestion des affaires communes) est peu apparue dans les débats. J’y vois un déficit de culture politique faisant que l’on peine à exprimer et à expliquer les concepts fondamentaux sur lesquels reposent l’Etat dans notre pays. Il faut également ajouter un autre facteur : la situation socio-économique difficile que connaît l’Europe actuellement ainsi que les pressions que subit la Suisse dans ce contexte ont certainement eu une influence sur la décision – l’ère de la « paix éternelle » promise à la fin de la Guerre froide est terminée. Le scénario des récentes manœuvres militaires de notre armée illustre bien ce changement de perception (une défense des frontières face à des bandes armées provenant d’une Europe en plein effondrement).
TB : Vous avez publié en mai dernier un livre au titre quelque peu provocateur « Europe Mad Max demain ? Retour à la défense citoyenne ». Pourquoi un tel titre ?
BW : Le titre n’est pas moi, c’est le choix de l’éditeur qui souhaitait quelque chose de percutant ! C’est le sous-titre qui indique l’orientation de ma réflexion, à savoir un travail sur le citoyen-soldat à l’âge de la globalisation et du chaos.
TB : En prônant le concept de défense citoyenne, vous mettez en relief, sans le nommer, le concept de subsidiarité ascendante qui, à l’origine, est un concept militaire : Durant l’époque romaine : le « subsidium » qui était une ligne de troupe se tenant en alerte, derrière le front de bataille, prête à porter secours en cas de défaillance… Cette philosophie politique antique peut-elle être à nouveau d’actualité au XXIe siècle ?
BW : Ma référence principale n’est pas tant l’Antiquité romaine, mais plutôt les républiques urbaines de la Renaissance italienne. Celles-ci sont déjà modernes, en particulier en raison de leurs activités commerciales et de la naissance du premier capitalisme. Ce dernier élément est très important à mes yeux et n’apparaît que peu dans l’empire romain (où l’économie est encore peu développée) : d’où mon intérêt pour les cités italiennes du Quattrocento. De nos jours en effet, je pense que toute réflexion politico-stratégique doit sous-entendre l’existence prédominante du capitalisme globale, au risque sinon de retomber dans de « mauvais remake » de l’Etat-nation et des armées de conscription. De mon point de vue à cet égard, lorsqu’on réfléchit à l’outil militaire, il faut avoir bien présent à l’esprit que nous avons perdu le contrôle de l’échelon national (sans parler de ceux situés au-dessus) et, par conséquent, des armées et gouvernements nationaux. C’est pourquoi dans ma démarche sur la défense citoyenne aujourd’hui, j’ai pris comme point de repère notamment la notion de chaos qui nous « délivre » en quelque sorte d’un cadre politique préconçu. Dans le même sens, je me suis penché attentivement sur l’affirmation des groupes armés (de tous ordres) comme nouvelles « machines de guerre » en ce début de XXIe siècle. J’ai ainsi émis l’hypothèse que ceux-ci étaient en train de supplanter les forces armées régulières des Etats, ceci au même titre que les armées mercenaires de la Renaissance ont supplanté la chevalerie médiévale et, plus tard, les armées nationales issues de la Révolution française ont supplanté celles de l’Ancien Régime. Cela signifie que je considère que le tournant est non pas seulement stratégico-militaire mais aussi, et surtout, historique.
TB : Comment analysez-vous le fossé qui se creuse entre l’Etat et la nation ?
BW : Je considère qu’il n’y a d’ores et déjà plus adéquation entre les deux. La nation avec ses valeurs et son idéal de solidarité est morte dans les tranchées de Verdun, les ruines de Stalingrad, les crématoires d’Auschwitz et les rizières du Vietnam. On oublie un peu vite le traumatisme des deux guerres mondiales, la destruction morale de notre civilisation que cela a signifié, et le fait que des sociétés ne peuvent se relever facilement d’un tel choc. J’analyse le délitement actuel de nos sociétés (de la chute de la natalité au renversement des valeurs que nous vivons notamment dans le domaine de la sexualité) comme provenant fondamentalement de ces séismes à répétition. Les travaux de l’historien britannique Arnold Toynbee sur la « grande guerre destructrice », la « sécession des prolétariats » – autrement dit sur les formes que prend le déclin d’une civilisation – trouvent ici toute leur pertinence.
TB : Dans des nations européennes qui se communautarisent, ne pensez-vous pas que ce concept de défense citoyenne puisse être appliqué par des communautés ethnico-religieuses aux intérêts antagonistes ?
BW : C’est déjà le cas ; pensons aux diasporas politiquement encadrées, aux gangs contrôlant certains quartiers urbains, aux réseaux mafieux, etc. A la fois la destruction des nations à laquelle je viens de faire référence, la globalisation financière amenant l’explosion de l’économie grise, ainsi que la fin de l’ère industrielle ont créé un terreau très favorable à la fragmentation de nos sociétés, à leur recomposition en sous-groupes pris en main par les nouveaux prédateurs susmentionnés. Il ne faut pas oublier non plus que des pans entiers de l’économie régulière ne pourraient plus fonctionner sans les travailleurs clandestins, que l’économie parallèle représente en outre environ 15% du PIB des grands Etats européens, etc., etc., etc. Il est donc urgent de se poser la question de la défense citoyenne parce que les communautés auxquelles vous faites allusion ont « fait le pas » (bon gré – mal gré) depuis longtemps : c’est le citoyen qui est « en retard », c’est lui qui est désarmé. Si nous faisons brièvement le catalogue des catégories de combattants existant de nos jours (partisans, forces spéciales, contractors, terroristes, shadow warriors), nous constatons immédiatement que le citoyen est absent; il reste donc sans défense dans une monde où la violence a retrouvé son état anarchique. En ce sens, ma contribution demeure bien modeste compte tenu de l’urgence de la situation.
TB : La défense citoyenne peut-elle être considérée comme une réponse « localiste » au phénomène de la mondialisation ?
BW : Comme je l’ai dit plus haut, je pense que nous avons perdu le contrôle de l’échelon national. Donc, oui, la réponse est sans doute plutôt « local ». Mais, selon moi, ce n’est pas tant dans l’opposition local/global qu’il faut travailler : la société de l’information nous offre l’opportunité de travailler en réseau open source, de manière coopérative… au-delà du local au sens strict. De mon point de vue, le facteur déterminant n’est donc pas tant le local que l’autonomie, c’est-à-dire la capacité de contrôler ses propres processus de fonctionnement (dont en priorité la sécurité). Car, si au niveau local nous restons totalement dépendant du niveau global, rien ne change ! J’ai insisté précédemment sur l’importance de prendre en considération la dynamique du capitalisme parce que, précisément, toute initiative qui n’est pas en mesure de développer une certaine marge de manœuvre vis-à-vis de cette dynamique est vouée à l’échec. Nous y reviendrons plus loin à propos des coopératives. Revenons à la dialectique local/global que vous évoquez, il n’est cependant pas possible d’agir localement si l’on ne dispose pas d’un discours global ; le cas du mouvement néo-zapatiste au Chiapas est particulièrement parlant à cet égard – une faible rébellion pratiquement sans impact militaire qui parvient en revanche à développer un discours de portée mondiale. Cet exemple tendrait à montrer qu’aujourd’hui aucune action locale (ou autre) ne peut s’inscrire dans la durée sans un discours adéquat. Je dis un « discours » et non pas du « storytelling », c’est-à-dire non pas du marketing mais une véritable mise en forme de la réalité apte à se démarquer des deux discours dominant que sont celui de l’empire (la mondialisation néo-libérale) et celui de l’apocalypse (l’épuisement des ressources, le réchauffement climatique et la fin des temps)…. faute de mieux, j’ai appelé pour le moment cette troisième voie le « discours du rebelle ». La notion de rebelle en lien avec celle d’autonomie (y compris le concept anarcho-punk de TAZ) ouvrent ici des perspectives prometteuses telles que le refus de la réquisition techniciste, la réappropriation de sa propre histoire ou encore le lien con-substanciel entre résistance et renaissance. Vous comprenez dès lors pourquoi je trouve la réduction de la réponse au rapport local/global un peu « courte ».
TB : Julien Freund a écrit qu’« une collectivité politique qui n’est plus une patrie pour ses membres cesse d’être défendue pour tomber plus ou moins rapidement sous la dépendance d’une autre unité politique ». La Défense citoyenne peut-elle régénérer les concepts de patrie et de souveraineté ?
BW : Certainement, la Défense citoyenne se comprend dans cette perspective, mais pas dans le sens d’une restauration de l’état antérieur. Comme je viens de le dire, nous ne retrouverons pas la Nation : « l’histoire ne repasse pas les plats » ! C’est là que se situe le premier enjeu de toute réflexion prospective : ne pas vouloir « re-bricoler le passé », s’efforcer de penser en fonction des nouveaux paramètres en vigueur (d’où l’importance de prendre en compte la société de l’information).
TB : Vous voyez le développement possible de SMP à travers le système de la coopérative. Cette idée ne pourrait-elle pas être développée au sein des mutuelles (comme services) étant donné que leur philosophie d’origine était centrée sur le secours et l’entraide avant d’être focalisée sur la dimension santé ?
BW : Sans aucun doute. Toute démarche de reconstruction passe obligatoirement par là…. la forme peut toutefois varier. L’essentiel dans le système coopératif (ou mutualiste) est de donner au groupe une certaine autonomie – nous y revoilà – notamment dans le domaine économique (une marge de manoeuvre par rapport à la dynamique du capitalisme global). A travers la coopérative, il est possible d’échapper quelque peu au diktat du marché et des grands acteurs mondiaux. Il est d’ailleurs intéressant de constater que les coopératives ne fonctionnent bien que dans un tel contexte; en période de « vaches grasses » l’idée ne fait généralement pas recette. Dans mon livre j’ai donné l’exemples des Acadiens au Canada qui, par ce biais, dès la fin du XIXe siècle ont pu se soustraire à la tutelle des grandes entreprises anglaises qui les exploitaient. De nos jours, il ne faut pas oublier non plus que le mouvement anarcho-punk a d’ores et déjà ouvert des pistes en la matière : hormis le concept de TAZ déjà évoqué, il y aussi la philosophie do it yourself (DIY) avec ses formules choc telles que « ne haïssez pas les médias, devenez les médias » ! Or aujourd’hui, d’après mon appréciation, la sécurité serait un bon point de départ : prendre en main sa propre sécurité, c’est prendre conscience que JE suis le premier responsable de mon propre destin ! En effet, comme dans toute grande transformation, la « reconnaissance précède la connaissance » (Th. Gaudin); en d’autres termes c’est la prise de conscience qui est le prérequis de l’action (qui, à son tour, a besoin ensuite d’un discours pour se légitimer dans la durée).
TB : Comment voyez-vous la Défense citoyenne comme réponse au tout sécuritaire centralisé (de plus en plus liberticide) par l’Etat ?
BW : Comme je l’ai dit plus haut à propos de la Renaissance italienne, ma démarche est foncièrement machiavélienne : je me préoccupe de la liberté républicaine (au sens de participation effective à la gestion des affaires communes). Dans cette optique, la dérive sécuritaire de l’Etat moderne est très préoccupante; les criminologues parlent désormais à ce sujet du passage à un Etat pénal-carcéral, c’est-à-dire une réorientation du monopole de la violence légitime non plus vers l’ennemi extérieur commun, vers la guerre extérieure mais vers l’intérieur, vers la population en général. L’Etat pénal-carcéral tend ainsi à déployer un dispositif sécuritaire ne visant plus à réprimer le crime et les criminels mais ciblant tout citoyen quel qu’il soit, au prétexte qu’il pourrait, un jour, avoir un comportement déviant. On parle aussi à cet égard de « nord-irlandisation » de l’Etat moderne avec la mise en place de lois d’exception, d’un système de surveillance omniprésent (caméras, portiques de sécurité, etc.) et d’une militarisation des forces de police. On le constate, l’Etat pénal-carcéral a besoin d’un « ennemi intérieur » pour fonctionner, pour pouvoir cristalliser les peurs et justifier de la sorte le renforcement des mesures coercitives… il y a risque que le citoyen ne devienne cet ennemi. Rappelons au passage que l’Etat moderne n’est pas démocratique par essence; la citoyenneté, la représentation, la souveraineté populaire sont le fruit d’une négociation, voire d’une lutte dans laquelle les populations ont été en mesure de « faire le poids » dans ce rapport de force avec l’Etat. Le citoyen-soldat a été un élément clef de ce marchandage, de cette affirmation démocratique…. qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
C’est vis-à-vis de cette réalité que le cadre de raisonnement élaboré par Machiavel m’interpelle si fortement. Le Chancelier florentin s’est trouvé confronté à une situation très similaire avec les menaces qui pesaient sur la liberté à son époque (les oligarchies en place et le recours à des mercenaires). Dans sa réflexion, il établit à ce sujet un champ d’oppositions paradigmatiques qui se révèle très précieux : liberté/tyrannie; armée de citoyens/prétoriens; république/empire; vertu/corruption. Un tel cadre permet de répondre aux objections que j’entends souvent – « hors de l’Etat point de salut ! ». Machiavel nous indique ainsi que la communauté doit s’organiser avant tout en fonction de la liberté et de ses présupposés plutôt que selon un principe étatique moderne qui peut se révéler liberticide !
TB : Monsieur Wicht, nous vous remercions pour cet entretien.
Bernard Wicht, propos recueillis par Stéphane GAUDIN (Theatrum Belli, 7 octobre 2013)