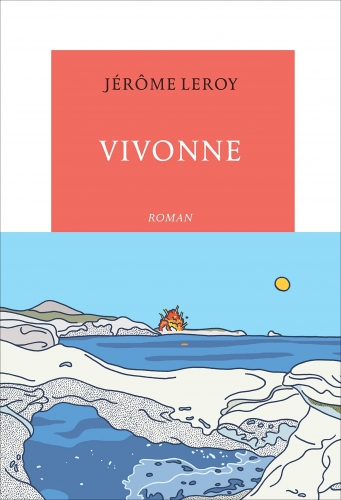Fondements philosophiques de l’autodéfense
À Portet-sur-Garonne, près de Toulouse, le propriétaire d’un terrain vient de prendre des mesures radicales contre les « gens du voyage » qui occupent périodiquement un terrain qui lui appartient. À chaque fois que ces nomades occupent son terrain avec des dizaines de voitures et de caravanes, ledit propriétaire, un citoyen local (en l’espèce un sous-homme, selon la philosophie politique de Jacques Attali, qui tient les sédentaires enracinés pour des arriérés), se rend à la gendarmerie, où on lui explique qu’on n’y peut rien. Il s’adresse ensuite à la justice et entame une procédure coûteuse qui, au bout de plusieurs semaines, aboutit à une décision d’expulsion, laquelle ne prend effet qu’au bout de plusieurs autres semaines ; après quoi, il reste à la charge du propriétaire le nettoyage des lieux…
Aux grands maux, les grands remèdes
Le propriétaire a donc choisi d’inverser la logique des choses. Puisqu’on ne peut – paraît-il – empêcher les squatters d’entrer et de résider chez lui, il a fait en sorte de les empêcher d’en sortir. À la dernière intrusion, il a loué une pelleteuse et creusé un fossé entre le terrain et la route d’accès, puis une grue, grâce à laquelle il a déposé un bloc de béton de trois tonnes au milieu du chemin d’accès au terrain. En se serrant sur le bas-côté, les voitures peuvent passer, mais pas les caravanes qui restent bloquées sur le terrain.
Maintenant, c’est au tour des nomades de se plaindre auprès de la gendarmerie, qui n’y peut rien, comme d’habitude, et renvoie les plaignants vers la justice, comme d’habitude. Ce qui ravit le propriétaire, qui leur dit juste : « Bon courage, chacun son tour ! » Cela me ravit, moi aussi, au passage, mais là n’est pas la question…
Derrière cette anecdote, qui, de prime abord relève du jeu classique de la réponse du berger à la bergère sous une forme drolatique, se joue un problème de philosophie politique fondamental : la légitimité et le rôle de l’État.
Pourquoi l’État ?
Notre philosophie politique, telle qu’acceptée par la doxa depuis les Lumières, repose sur la notion de pacte ou de contrat social, héritée de Hobbes et de Locke, deux philosophes anglais du XVIIe siècle. Dans le Léviathan, Hobbes réfute la théorie classique d’Aristote, puis de l’Église, comme quoi l’homme est par nature un animal social. Hobbes explique qu’à l’état de nature – c’est bien sûr une uchronie, un mythe non historique – l’homme est violent et égoïste et que la règle de la vie primitive était la guerre de tous contre tous. Lassés de cette anarchie meurtrière, les hommes, un jour, décidèrent de passer entre eux un contrat et d’inventer une entité nouvelle, l’État, en lui déléguant une part de leur liberté, en contrepartie du maintien d’un ordre social. Pour assurer son rôle, il fallait que l’État fût fort, redouté et équitable. C’est pourquoi Hobbes assigna à l’État le nom symbolique de Léviathan, un monstre biblique, cruel dragon des mers qui sortira des eaux pour ravager les cités pécheresses à la fin des temps.
Cette jolie fable constructiviste (qui nie un ordre naturel des choses, à savoir le caractère essentiellement et originellement social de l’être humain, préexistant à toute projet prétendument rationnel d’organisation sociale) justifie le « monopole de la violence légitime » de l’État qui, par son statut et son action d’entité publique, au service de l’intérêt général, forte, redoutée et équitable, abolit la violence et la vengeance privées. Les forces de l’ordre et la Justice sont en l’espèce les bras armés de l’État dans l’exercice de sa mission de contrainte et de répression. Tout cela est bel et bon. Il faudra au passage expliquer à Christophe Barbier, à Alain Duhamel et aux syndicats de commissaires qu’éborgner les citoyens à coups de lanceurs de balles de défense ne relève que tangentiellement de l’exercice d’une violence légitime, mais on ne va pas s’appesantir. Pour être exercée par un pouvoir légal, la violence n’est pas pour autant légitime.
L’impuissance de l’État
Mais allons plus au fond des choses et revenons à notre propriétaire de Portet-sur-Garonne. Admettons, à des fins exploratoires, qu’il y ait un contrat entre l’État et les citoyens.
S’il y a contrat, il y a échange de services entre eux ou de services contre une compensation financière, par consentement mutuel entre parties librement contractantes, et tout contrat prévoit les raisons et les modalités d’une rupture du contrat en cas de défaillance de l’une des parties. Un contrat, c’est fait pour se marier, mais cela prévoit les conditions du divorce…
En l’occurrence, à Portet-sur-Garonne, on constate une défaillance de l’État. Il en va de même pour tous les citoyens et entreprises de tout ordre qui se font dévaliser, agresser, cambrioler, avec ou sans violence. L’État manque à ses obligations contractuelles de protection de la propriété ou du droit à la sécurité physique des biens et des personnes, qui restent des droits fondamentaux. Que ce soit par défaillance des forces de l’ordre ou de la Justice, qu’il s’agisse d’incurie, de manque de moyens (ah, le « manque de moyens », la ritournelle des débats télévisés… Le manque de moyens, c’est la balle en touche du syndicaliste…) ou de volonté politique, la faute de policiers incapables, de juges gauchistes ou de ministres de la Justice déviants, c’est là l’objet de débats médiatiques et politiques, mais cela n’a aucune conséquence sur le constat que nous faisons. Il n’y a pas en l’espèce de cas de force majeure à plaider pour exonérer l’État de ses obligations.
Mon arrière-grand-mère ne fermait pas sa porte à clé
Permettez-moi une anecdote personnelle pour illustrer mon propos sur la dégénérescence de la fonction régalienne. J’ai bien connu une de mes arrière-grands-mères, morte à 94 ans, en 1964. Cette personne, née sous Napoléon III, était de condition modeste, dans un milieu rural, mais elle a passé toute sa vie dans un luxe extraordinaire dont elle n’a jamais eu conscience et que seules nos générations peuvent comprendre aujourd’hui. Jamais de sa vie elle n’a fermé sa maison à clé, même la nuit, même quand elle s’absentait. Je ne sais même pas si elle avait une clé, on avait dû l’égarer sous la présidence d’Émile Loubet… Il est vrai qu’il n’y avait pas forcément grand-chose à voler, mais aussi l’État-Léviathan remplissait ses obligations contractuelles supposées et une deuxième condamnation pour vol, surtout avec violence, exposait le contrevenant à un séjour en Guyane, jusqu’en 1938. Oui, je sais, c’est réac mais, jeunes lecteurs, imaginez-vous quel sentiment de confort on ressent à ne pas avoir besoin d’antivol pour son vélo ? C’est un luxe dont on jouissait encore dans les années 70.
Bien entendu, cette société connaissait des crimes et des délits, malgré la répression judiciaire et une grande efficacité de l’État dans l’exercice de ses fonctions régaliennes. Mais, à une époque où le téléphone était rare et le téléphone portable n’existait pas, et où donc le temps d’intervention des agents de la force publique était supérieur à celui d’aujourd’hui, la société, l’État et la Justice acceptaient le principe de l’auto-défense en l’absence de secours publics immédiats. C’était là faire preuve de sagesse et de logique. Seule était bannie l’auto-justice, la vengeance privée. On voit bien là la dégénérescence de l’État régalien (dans ses composantes exécutives, judiciaires et législatives).
Les impôts en échange de la sécurité
Pour revenir aux théories de Hobbes, elles recèlent une faiblesse potentiellement très dangereuse pour la légitimité, voire l’existence même de l’État. Elles supposent en effet que l’État est efficace, comme si c’était une vérité d’évidence, un fait de nature.
Or, l’État contemporain est, de fait, globalement inefficace en termes de rapport entre les services rendus et les coûts (les fameux « prélèvements obligatoires », soit le pourcentage de la richesse produite par la société qui est prélevé par l’État). Une école de pensée états-unienne, les « anarcaps » ou « anarcho-capitalistes », en a développé une théorie qui ne manque pas de pertinence intellectuelle dans l’analyse.
Rappelons que, dans une société non tyrannique, la liberté inclut parmi ses composantes essentielles le principe du consentement à l’impôt.
Notre propriétaire de Portet-sur-Garonne, après cinq ou six chemins de croix auprès de la maréchaussée et de l’administration judiciaire, quel est son sentiment ? « Il est sympa, l’adjudant X ; il compatit vraiment à mes problèmes. Le juge est débordé, mais il a pris le temps de m’expliquer pourquoi c’était si long de régler l’affaire, à cause des lois. Ce n’est pas que les personnes soient désagréables. Le problème, c’est que ça ne fonctionne pas. Et après, il faut que je fasse enlever les poubelles et les saletés qu’ils ont laissées. Quand je pense à tout ce que je paye comme impôts… »
Ensuite, le même loue, à ses frais, une pelleteuse, une grue et un bloc de béton de trois tonnes pour mettre en œuvre la seule méthode qui lui reste, selon lui, pour dissuader à l’avenir les squatters de s’installer chez lui. « Quand je pense à tout ce que je paye comme impôts ! La gendarmerie et la justice, ça ne sert à rien et ça coûte cher. Et après il faut dépenser de l’argent pour régler soi-même les problèmes… »
Et là commence le chemin qui mène au refus du consentement à l’impôt, refus que les « anarcaps » justifient par la nécessité de recourir, aux frais du citoyen, aux prestations de sociétés privées pour rendre les services nécessaires au bon fonctionnement de la société. C’est la conséquence de la rupture du contrat social par l’État défaillant. D’une manière moins intellectualisée, le phénomène Gilets jaunes dénonce cette même rupture et se révolte contre une oppression fiscale injuste, inégalitaire et mal répartie entre les classes sociales et les territoires.
L’inefficacité de l’État est hors de prix
Les « anarcaps » ont-ils tort ? Non, dans la description qu’ils font du phénomène. Comparons, sur soixante ans, la qualité des services rendus par l’État et le montant des prélèvements obligatoires. Quand mon arrière-grand-mère est morte, le taux de prélèvement était de 36 % du PIB. Les villes et les campagnes étaient plus sûres ; la Sécurité sociale remboursait à 100 % ; les cathos mettaient sans problème leurs enfants au lycée public « sans Dieu » où ils recevaient un enseignement de très haute qualité (même de professeurs communistes ou SFIO) ; les trains arrivaient à l’heure et, dans les grandes villes aux activités commerciales et industrielles intenses, le facteur passait deux fois par jour déposer le courrier.
Aujourd’hui, le montant des prélèvements obligatoires avoisine officiellement les 48 %. Tout augmente…
En réalité, dans une perspective historique, ce dernier chiffre est faux comme une déclaration d’Olivier Véran. Il faudrait en effet y rajouter les dépenses qu’engagent aujourd’hui les entreprises et les particuliers pour pallier la défaillance de l’État et se garantir une qualité de services égale à celle dont ils jouissaient « gratuitement » il y a quelques décennies. On peut considérer ces dépenses comme des dépenses contraintes assimilables à un impôt transféré au privé.
Par exemple : le chiffre d’affaires de l’industrie de la sécurité privée, du fait de la défaillance de l’État régalien. Cette industrie n’existait pratiquement pas, parce qu’on n’en avait pas besoin ou, à tout le moins, pas à l’échelle actuelle, et sa croissance est aujourd’hui exponentielle. Vigiles aux portes des magasins et dans les usines ; industrie de la télé-surveillance des domiciles et des établissements (installations fixes, personnel de veille et d’intervention). On y rajoute l’augmentation du coût des assurances, etc…
Par exemple : les dépenses de mutuelles médicales aux frais des entreprises et des salariés et retraités.
Par exemple : la différence de chiffre d’affaires de l’école privée entre 1960 et aujourd’hui, où le choix de l’école privée n’est plus majoritairement une décision confessionnelle, mais la nécessité de protéger ses enfants de la « fabrique du crétin » (l’école publique) ; le chiffre d’affaires d’Acadomia et consorts ; etc…
Si on réintègre tous les coûts de services privatisés du fait de la défaillance de l’État par rapport aux années 60, je ne crois pas me tromper en estimant à 60 % et non 48 %, chiffre officiel, le montant des prélèvements obligatoires tels qu’on les définissait alors, à services comparables rendus par l’État. Et là, on commence à trouver que ça fait cher…
Alors, les « anarcaps » ont-ils raison sur tout ?
Non, leur conclusion, la nécessaire et souhaitable extinction de l’État, est erronée de bout en bout. Bon diagnostic, mauvaise thérapeutique… Il s’agit en effet pour nous de définir les conditions et les modalités de restauration d’un État capable et efficace, alors que les anarcaps « jettent le bébé avec l’eau du bain ».
Les « anarcaps », en tant qu’ils sont anars, cultivent une vision « micro » de la société, basée sur la proximité, et croient effectivement que le groupe est régi par des systèmes de relations et d’échanges interpersonnels, de type libertaire, égalitaire et contractuel. Ils n’envisagent pas l’origine, la nature, la profondeur historique et les intérêts collectifs des grands groupes humains comme les peuples et les nations. En tant que capitalistes, ils réduisent la relation entre les individus et les groupes à l’échange intéressé et à la maximisation du profit, dans une approche matérialiste et court-termiste de la société où rien n’existe que le quantifiable dans l’instantané du temps. L’histoire n’entre pas dans les catégories mentales de l’« anarcap ». On peut rompre le contrat préexistant et tout privatiser.
Là est la faille. Les sociétés ne sont pas des agrégats d’individus indifférenciés contractant librement et, si l’on peut souscrire au diagnostic d’un État contemporain tout aussi obèse qu’inefficace, l’État classique reste le seul instrument connu qui, convenablement mené, garantisse la sécurité et la pérennité des communautés humaines organiques. L’homme – zoon politikon, dit Aristote – est l’animal social et politique à la fois, social et socialisé parce que politique, inscrit dans une cité qui n’est ni un groupe auquel tel ou tel viendrait s’agréger sans contrainte, ni un simple marché où s’échangent des services.
Alors que le monde contemporain (y compris aux États-Unis, pays des « anarcaps ») et les populations sont soumises à trois angoisses simultanées, à trois menaces perçues comme mortelles – sécuritaire, économique et identitaire, ou culturelle si vous préférez –, l’État reste la seule réponse connue. Lui seul peut préserver la frontière et l’identité, ainsi que les lieux de débat et de prises de décisions collectives qui engagent l’avenir de la communauté.
En revanche, et l’on donnera raison à Hobbes sur ce point, l’État doit être fort, respecté parce que respectable, et équitable. Nous en sommes loin aujourd’hui.
La bonne nouvelle est économique. Les « anarcaps » auraient dû y réfléchir. C’est qu’un État efficace, minimal parce que centré sur le régalien, fort, respecté et équitable, revient beaucoup moins cher aux contribuables qu’un État incapable, obèse, faible, décrié et injuste.
Lionel Rondouin (Site de la revue Éléments, 7 janvier 2021)