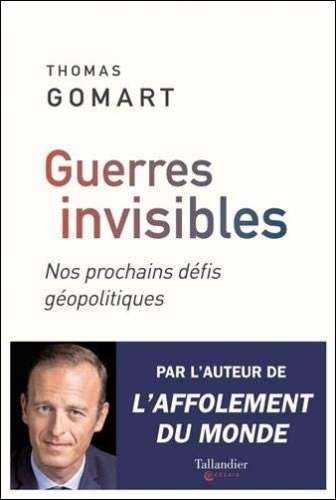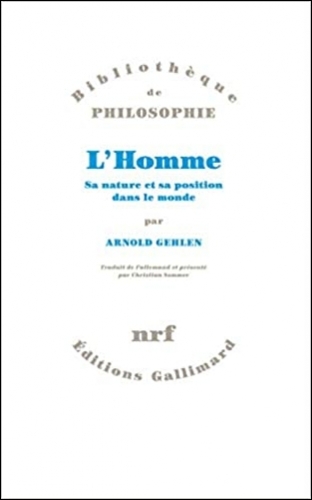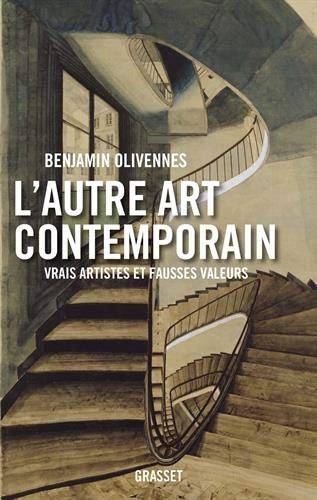Végéter est-il l’impératif catégorique et sanitaire du troisième millénaire ?
Il serait difficile de trouver quelque chose de plus emblématique de la condition psychologique et culturelle que notre époque expérimente, et en même temps de plus avilissant – si on ne veut pas aller jusqu’à l’adjectif « répugnant » – que les spots que le gouvernement allemand a diffusés pour convaincre ses citoyens de respecter de la manière la plus rigide les recommandations de limitations de la liberté de mouvement imposées afin de circonscrire la contagion au Covid-19. Dans le premier de ceux-ci, un garçon d’une vingtaine d’années, vautré à la maison sur son divan, canette de Coca-Cola en main et patates frites à portée de bouche, noie dans l’ennui une journée inutile. Dans le second, le même, hypothétique étudiant ingénieur à l’Université de Chemnitz, partage son aboulie avec sa petite amie ; du divan on est passé au lit, et pour réjouir l’inertie on est passé à de copieuses portions de poulet frit. Dans le troisième, le centre de l’attention, « Tobi le paresseux », autodéfinition qui va de soi, passe son temps devant son ordinateur mangeant des raviolis froids à même la boîte sans se soucier de les réchauffer. Ces scènes sont situées dans l’ambiance du « terrible » hiver 2020 ; et pour les accompagner, outre une musique de fond suggestive, on retrouve dans le futur les mêmes protagonistes vieillis, qui se vantent de l’« aventure » vécue un demi-siècle plus tôt qui les a contraint à se barricader dans leur maison et à ne rien faire, devenant ainsi – pour avoir scrupuleusement veillé à ne pas être des véhicules de la contagion – des héros. Ce dernier qualificatif plusieurs fois répété (on pourrait s’attendre à ce que Tobi reçoive une médaille pour son absence exemplaire de vie en société) est associé à d’autres mots non moins dissonants comme « destin », « devoir social », « destin de la nation », et le désormais omniprésent « ennemi invisible ».
Idéal sanitaire, phase post-goebbelsienne de l’appareil de propagande
On ne peut s’étonner que le produit de cette phase post-goebbelsienne de l’appareil de propagande de guerre allemand ait enchanté simultanément des médias comme Vanity Fair, Il Foglio [périodique néo-conservateur italien (NDT)], La Repubblica (quotidien italien libéral-libertaire), d’accord pour le trouver « génial », ni que son ironie peu subtile soit louée par les publicitaires italiens. En effet, que peut-on trouver de mieux pour décrire le type d’homme idéal (et de femme, cela va sans dire) de la Cosmopolis souhaitée par les partisans de l’idéologie des « droits humains » : un consommateur produit en série, se nourrissant de rebuts, prêt docilement à obéir à l’appel des autorités démocratiques et des mass médias et à se réfugier, sans plus réagir, dans l’individualisme le plus grégaire et le plus strict, se remontant le moral à coups de visioconférences, de chats en ligne, de séries sur quelque plateforme de multi-médias, et, pourquoi pas ? de signatures virtuelles de pétitions pour soutenir les causes du « genre » ou de l’« inclusivité » disponibles sur ces mêmes sites.
Progresse également ainsi, sur les ailes de la peur instillée par une incessante communication anxiogène, cette mutation anthropologique graduelle qui, en quelques décennies, a trouvé dans les épisodes épidémiques un nouveau véhicule de grande efficacité. De fait, l’ablation des liens interpersonnels est recommandée, avec une emphase et une fréquence toujours s’accélérant, comme l’unique remède possible pour se mettre à l’abri de la contagion du virus ; et certains arrivent à y voir des aspects positifs. On ne s’étonnera pas qu’au nombre de ceux-ci, se trouve Bill Gates, prêt à décrire le monde futur avec des accents guère empreints de préoccupation sociale : pour un certain nombre d’années, nous confie-t-il, nous aurons au moins une atmosphère plus pure, car avec une baisse de 50 % des voyages, les émissions de gaz à effet de serre se réduiront considérablement, même si cela nous contraint à avoir peu d’amis. Le télétravail prospèrera – et avec lui, pourrait-on ajouter, l’utilisation ultérieure de produits Microsoft – et les rapports sociaux seront atrophiés. Cette perspective ne semble pas susciter d’inquiétudes excessives ni parmi les intellectuels médiatisés, ni parmi les politiques, ni parmi les scientifiques.
La vie à tout prix
Parmi les intellectuels médiatiques, nombreux ceux qui invoquent un « droit à la santé », concept purement insensé, que personne ne songerait à opposer à la survenue d’un infarctus, d’une hémorragie cérébrale ou d’une forme grave de tumeur, sachant bien qu’aucun sujet frappé de pathologies de ce type ne saurait être en mesure d’exercer ce droit, auquel serait substitué le réel et souhaitable droit au soin ; un « droit à la santé » plus fort que n’importe quelle peur de délitement du lien social.
Presque tous les seconds [les politiques (NDT)] suivent comme un seul homme et ne songent qu’à calmer les protestations légitimes des catégories productives pénalisées par les fermetures imposées, à coup d’aides comme s’il en pleuvait et en bonne partie à fonds perdus qui seront payés ultérieurement moyennant de substantielles augmentations de charges fiscales, car le déficit de l’État ne pourra pas être maintenu éternellement. Les conséquences de l’obligatoire (et désirée) « distanciation » sur la capacité de résistance du tissu social les laisse tout à fait indifférents.
Enfin, quant aux experts médiatiques, leur conviction unanime – que la vie compte plus par la dimension quantitative de sa durée que par sa qualité – s’exprime au quotidien dans les modalités les plus diverses sur toutes les scènes télévisées, radiophoniques ou imprimées…
À elles trois, ces composantes fondamentales de la classe dirigeante des démocraties occidentales (ces régimes qui devraient incarner le meilleur des modèles possibles de gouvernement des « pays avancés ») en viennent à oublier un aspect incontournable de la réalité, en raison même de la cécité induite par le conformisme de fer du politiquement correct : l’impossibilité d’éliminer le risque de l’existence humaine, aussi bien individuelle que collective. Et encore plus la douloureuse nécessité de l’accepter.
Le « végéter » se substitue au « vivre »
Pendant des millénaires, la culture des peuples – de tous les peuples de la terre – s’est résignée à cet état de fait et l’a reliée à la volonté impénétrable du Destin et/ou de la divinité vénérée, et l’a incorporé dans le système de normes destiné à gouverner la vie des communautés. L’illusion prométhéenne typique de la modernité, alimentée par les préjugés du rationalisme comme les époques précédentes pouvaient l’être par ceux de la magie, a poussé certains, pas uniquement dans les milieux scientifiques, à croire qu’il était possible et même nécessaire de se rebeller contre cette loi de la nature. Et que l’existence individuelle puisse et doive être exemptée de l’aléa de l’imprévisible et de l’inattendu. Étanche, tenue sous contrôle – sécurisée, pour le dire dans la novlangue à la mode – et ce dans tous les cas. Avec pour conséquence de suivre et célébrer un horizon idéal dans lequel le végéter se substitue au vivre.
À l’exhibition de corps à l’état végétatif, magnifiée par les spots allemands, vient un message qui associe le refus du risque à un acte d’héroïsme. Un contresens formidable, mais qui explique mieux que toute autre chose la substance profonde de l’esprit du temps dans lequel nous vivons.
Qui refuse cette vision se voit automatiquement attribuer un caractère d’insensibilité, sinon de folie. La vieille figure du pestiféré à assigner à résidence revient sous forme de menace dans l’imaginaire collectif sur fond de débats qui remplissent les talk-shows, pendant que l’opinion publique se sépare verticalement dans tous les pays frappés par l’épidémie : entre les terrorisés qui se réjouissent du panorama spectral de cités désertes et qui voudraient les voir telles au moins jusqu’à l’épiphanie d’un miraculeux vaccin et ceux qui souffrent du confinement et attendent le moindre signe de retour à la normale pour replonger dans les rites de masse de l’apéritif.
Réinsérer le risque dans l’horizon de la normalité
À la stupidité du négationnisme – que quelqu’un exagérant et plaisantant un peu trop avec les données de la biologie (qui, dans le passé, a donné lieu à des utilisations politiques quelque peu problématiques), a pu définir comme le fruit d’un « processus mental non éloigné de celui qui survient dans certains types de démence » –, est opposée une autre forme de stupidité, à la fois identique et contraire, laquelle conduit à l’incompréhension et au refus des raisons de ceux qui, à un scénario de restrictions permanentes de la liberté de mouvement, d’obligation sine die d’endosser des masques chirurgicaux, de maintenir un mètre quatre-vingt de distance avec le prochain et d’éviter les « lieux de sociabilité » et les rencontres avec famille et amis, préfèreraient un autre scénario où, tout en respectant pourtant de manière temporaire les mesures adéquates de prudence, le risque serait accepté et graduellement réinséré dans l’horizon de la normalité.
La diabolisation de ce choix et l’insistance anxiogène autour de présages funestes, sur le vaccin qui ne fonctionnera pas ou aura des effets limités dans le temps, sur les mortifères « troisièmes vagues » (et les suivantes en préparation), auront quasi certainement des effets opposés à ceux espérés, précipitant des strates croissantes de la population dans un état de prostration psychologique difficilement récupérable, dont on constate déjà les évidents symptômes. Mais apparemment, les dogmes idéologiques qui dominent la scène culturelle contemporaine empêchent d’accepter quelque attitude de confrontation à l’existence qui puisse paraître excessivement virile, et donc – dans l’expression banalisante de la vulgate progressiste – « machiste ».
Végéter devient donc l’impératif catégorique du troisième millénaire. Il ne reste qu’à espérer qu’un jour, un sursaut d’orgueil collectif, face à une perspective aussi déprimante, puisse se transformer en sérieuse et sacrosainte réaction ; et de faire, chacun à son niveau, tout son possible pour qu’une telle réaction advienne.
Marco Tarchi, traduit de l’italien par Claude Chollet (Site de la revue Éléments, 15 janvier 2021)