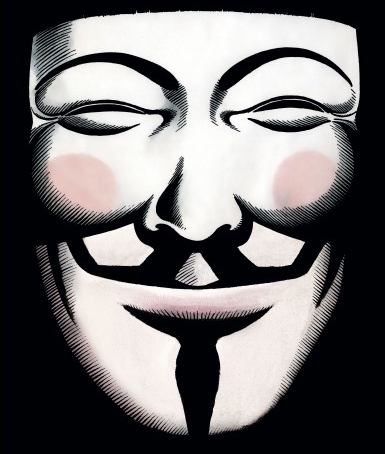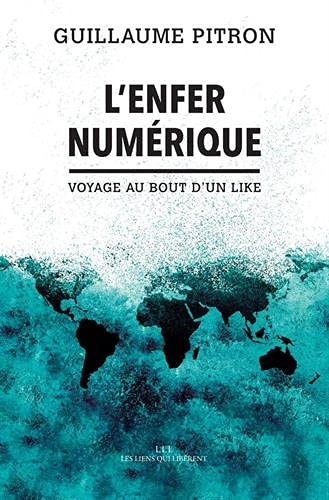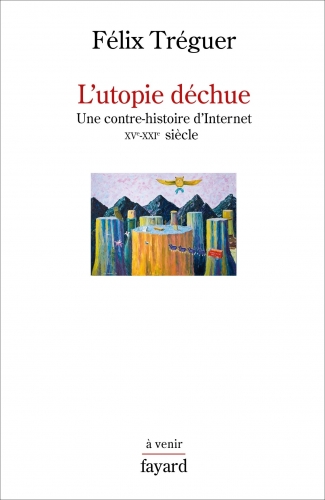La fin d’Internet
Internet pourrait-il disparaître ? L’hypothèse semble paradoxale, puisque, par définition, il a été conçu (du moins ses ébauches par la Darpa), pour résister à une guerre atomique. Le principe du réseau (x peut passer par A ou par B pour atteindre C) était précisément pensé dans cette perspective : décentralisation contre interruption ; jamais la communication ne serait empêchée puisqu’elle transiterait par d’innombrables canaux. Mais, bien qu’Internet soit supposé ultra résilient - et on le disait aussi dans les années 90 impossible à censurer ou à limiter et nous savons maintenant que ce n’est pas vrai- une thèse s’est répandue très tôt : celle du « big one », la grande catastrophe, le Pearl Harbour informatique » : puisque sur Internet, chaque point du réseau peut joindre tout autre, tout peut être contaminé par tout. Des think tanks comme la Rand imaginent donc qu’une puissance hostile paralyse l’ensemble du système. Une autre variante, beaucoup plus vraisemblable, serait qu’une opération contre certains systèmes informatiques détraque non pas Internet ou tous les pays, mais certaines fonctions indispensables à la vie d’une nation : plus d’électricité, de banques ou de transports, au moins pendant quelques heures, cela permettrait-il à un adversaire de nous imposer sa volonté ou de produire une effet de chaos irréversible ?
Toute utopie suscite ses dystopies, toute description d’un monde idéal enfin libéré des contraintes du présent appelle des avertissements en retour : si nous n’y prenons garde, des forces mauvaises détourneront les possibilités de la technologie ou les aspirations des hommes pour construire le pire des mondes : toute la rhétorique de la cyberguerre et de la cybersécurité est basée sur l’hypothèse la plus pessimiste.
Elle n’est pas absurde sur le plan des principes : tout finira un jour, y compris la planète terre ou l’auteur de ces lignes. Mais comment et pourquoi ?
On peut, et la thèse à déjà circulé, imaginer une fin d’Internet, soit indirectement par suite d’une catastrophe générale ou d’une crise énergétique grave interdisant de l’alimenter en électricité, soit par insuffisance de bande passante (une thèse à la mode vers 2005), soit délibérément.
Une première idée serait d’interrompre l’infrastructure physique d’Internet : le système repose sur une couche matérielle (à côté des couches dites logicielles et sémantiques, les règles qui font fonctionner le tout et les messages qui s’adressent aux utilisateurs finaux : des êtres humains). Et tout ce qui est matériel peut être saboté. Peut-on couper les câbles sous-marins par lesquels circulent les échanges ? Intervenir de vive force dans les data centers, sur les routeurs, chez les grande plateformes et en tous lieux - après tout situés dans des immeubles, donc susceptibles d’être attaqués ou ravagés ? Pour le dire autrement : tout ce qui passe sur Internet passe quelque part sur des ordinateurs ou les données sont physiquement stockées quelques part, donc, il y a des lieux que pourraient attaquer des terroristes, par exemple.
On peut imaginer une cause involontaire de destruction des infrastructures - électriques, par exemple - indispensables pour faire fonctionner le tout. Météorites, ondes, tempête solaire, incendies gigantesques ? Cela devient une question d’échelle pour les désastres naturels. D’une panne d’électricité d’une province à la disparition de la Silicon Valley dans une faille, et à une interruption durable à l’échelle de la planète? - Et pour une action menée par l’homme, sauf à imaginer une secte millénariste qui veuille nous ramener à un stade technologique antérieur, quelle serait leur motivation, si l’on part de l’hypothèse qu’une panne générale frapperait aussi tout pays susceptible de les commanditer ?
De la même façon, il est permis de fantasmer sur un logiciel malicieux qui infecterait l’ensemble du Net, aurait le temps de s’installe et ne rencontrerait pas de contrepoison à sa mesure ? C’est un scénario sur lequel travaillent des gens très sérieux. Mais à supposer même que l’épée transperce le bouclier - et que des centaines de sociétés high tech avec des milliers de chercheurs qui vivent précisément du repérage et de l’élimination des dangers numériques contagieux n’y puissent rien - quel intérêt stratégique autre que nihiliste ? Nous sommes là typiquement devant le « cygne noir » absolu : un événement d’une probabilité presque inenvisageable (et par définition s’en préserver demanderait des efforts immenses destinés à être renouvelés constamment face à l’ingéniosité de l’attaquant présumé, forcément innovant) mais aux conséquences immenses.
Ce type de terreurs est nourri par le fait qu’il y a eu des coupures partielles d’Internet, soit du fait d’une décision politique comme en Égypte en 2011, soit de manière accidentelle, comme lorsqu’une paysanne géorgienne de 75 ans, la « hackeuse à la bêche » qui préparait son jardin coupa un fil en cuivre et priva d’Internet une partie de l’Arménie en 2011. Il y aussi eu des projets bizarres. Pour mémoire, rappelons qu’en 2010 des sénateurs américains avaient proposé de créer un kill switch, un bouton d’urgence qui aurait permis au Président américain de couper Internet, comme on coupe le courant, en cas d’urgence.
En toute hypothèse, définitive ou temporaire, partielle ou planétaire, la coupure d’Internet, s’inscrit dans la logique selon laquelle tout ce qui fonctionne est susceptible d’être détraqué ; elle nous obligerait surtout à penser à nos réactions, aux fonctions et aux soutiens, y compris psychologiques, dont nous serions privés et à nos réactions. Dans un livre digne des modernes collapsologues, mais datant de 1971, Il Medioevo prossimo venturo (le Moyen-âge qui vient), Roberto Vacca, un scientifique italien, imaginait une sorte de panne par contagion (électricité, routes encombrées, paniques dans les villes) qui finissait par balayer notre civilisation. Et c’était avant Internet.
François-Bernard Huyghe (Huyghe.fr, 20 juillet 2019)