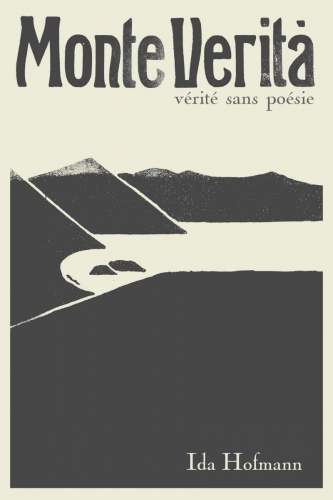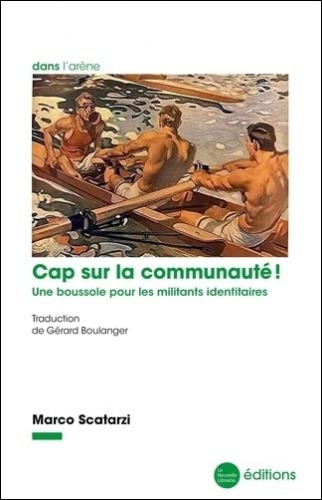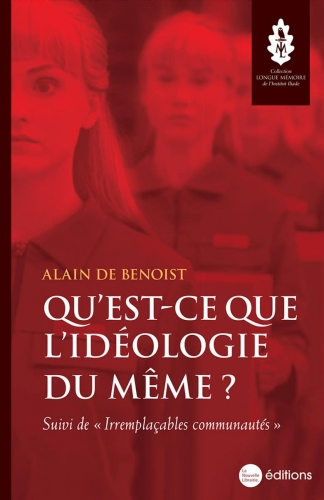Entretien avec Guillaume Travers : « le Moyen Âge conserve une puissance d’évocation considérable »
L’économie médiévale est le fruit de la féodalité. Quelles sont les aspects fondamentaux de ce système que l’on retrouve dans son système économie ?
Guillaume Travers : Trois éléments me semblent essentiels. Tout d’abord, le système féodal s’inscrit dans un monde essentiellement rural, marqué par un très fort attachement à la terre. Tout y est fortement territorialisé, ancré dans des communautés villageoises, des seigneuries, des provinces. Cela contraste fortement avec le monde antique, qui connaissait la grande ville, le commerce lointain. Le monde médiéval est celui qui communautés qui, dans une large mesure, sont autarciques. Le deuxième point est l’importance de l’idéal de vie communautaire : communautés villageoises dans le monde rural, et communautés de métiers en ville. Tout y est subordonné : rites, fêtes, l’organisation des travaux, etc. Chaque communauté a sa fierté, veut honorer ses saints aussi bien que les autres, etc. Enfin, un point fondamental est l’importance du serment : la hiérarchie sociale est fondée sur des relations d’allégeance mutuelle, qui n’ont rien d’unidirectionnel. Chacun a des devoirs envers les autres. La société est le produit de ces relations fondées sur l’honneur, la parole donnée, la coutume, etc.
Le monde paysan est fortement marqué par l’aspect communautaire. Comment s’organise la propriété collective des biens communaux ?
Le monde paysan, qui est évidemment majoritaire, a une très forte dimension communautaire. Les grands moments de la vie paysanne, à commencer par les récoltes, mettent en branle l’ensemble de la communauté. On ne laboure ni ne récolte seul dans son coin : chacun a besoin de tous. La communauté villageoise est donc une communauté de vie, mais aussi une communauté de travail. En outre, sur de nombreuses terres, le concept de propriété n’a pas de sens. Même si la terre est celle d’un seigneur, celui-ci ne peut pas la vendre, en faire ce qu’il veut. Il doit respecter les droits de villageois sur cette terre, pour y faire paître du bétail, y collecter du bois ou des fruits, etc. Ainsi, l’organisation de ces « champs communs » est régulée par un très grand nombre de droits issus des serments passés et de la coutume. Ce n’est ni une propriété privée, ni l’anarchie d’une propriété collective qui ne connaîtrait aucune limite. Sur ce point encore, le Moyen Âge nous apparaît comme un monde peu compréhensible si l’on s’en tient aux cadres mentaux modernes.
Comment la notion de travail était-elle perçue par les européens du Moyen-Age ?
Contrairement à l’Antiquité, qui perçoit négativement le travail (le tripalium, d’où vient le mot « travail », est un instrument de torture), celui-ci est central au Moyen Âge. Tout le monde ne travaille pas, bien évidemment : les nobles au moins en sont dispensés, car il se consacrent à la fonction militaire (le cas des religieux est plus complexe, car l’activité monastique valorise le travail manuel). Dans le tiers-état, les communautés sont essentiellement définies par leur métier. La communauté villageoise est avant tout la communauté des paysans, et les corporations du monde urbain sont des communautés de métiers. Cependant, la conception du travail dont témoigne cette organisation est toute différente de la conception moderne : le travail n’y est pas une marchandise, il n’a pas un prix de marché. Tout le but de l’organisation corporative est d’encadrer le travail, de fixer sa juste valeur indépendamment de l’offre et de la demande, de maintenir une grande exigence de qualité des biens produits, et de permettre à chacun de vivre dignement. Le travail a ainsi un but qualitatif. L’idée selon laquelle le travail serait un moyen de faire fortune, d’accumuler de la richesse, est un non-sens pour les esprits médiévaux : ces esprits visent la qualité, non la quantité. C’est l’essor du commerce, ainsi que l’a bien montré Werner Sombart, qui progressivement orientera l’esprit des hommes vers la seule quantité.
Les productions et les échanges commerciaux étaient fixés par l’idée de « juste prix ». Qu’implique ce principe ?
L’idée de juste prix se comprend avant tout par contraste avec le « système des prix » moderne. Aujourd’hui, pour nous, le prix d’une chose est quelque chose d’impersonnel : c’est le résultat de la confrontation d’une offre et d’une demande. On regarde par exemple les prix des matières premières, ou des denrées alimentaires, monter et baisser sans y attribuer aucune valeur morale, aucune signification. Ces prix résultent de la pure confrontation de milliers d’intérêts privés sur le « marché » mondial. À l’inverse, le « juste prix » est un prix qui reflète une vision du bien commun. Par exemple, le prix d’un bien doit être suffisamment élevé pour rémunérer le travail d’un artisan, la qualité d’une œuvre. Mais il ne doit pas être trop élevé pour permettre à la communauté de vivre. Un autre exemple parlant est celui d’une pénurie alimentaire. Sur un marché libre, celui qui a un stock de grains peut l’écouler à prix d’or en exploitant la farine. La théorie du « juste prix » nous dit au contraire qu’il doit offrir son grain à prix raisonnables, précisément parce que c’est intérêt de la communauté qui est en jeu.
Quelle était la place de l’argent et du crédit dans ce modèle économique ?
Il faut distinguer deux choses, l’argent et le crédit. Concernant l’argent, la monnaie, sa place est marginale. Dans une large mesure, on peut dire que le Moyen Âge naît comme une réponse à la « famine monétaire » (Marc Bloch) qui suit l’effondrement de l’Empire romain et l’irruption de l’islam en Méditerranée. Si la monnaie n’est plus couramment disponible, alors il faut trouver d’autres modes d’échange. Ce sera le don et le contre-don, et ce seront aussi les serments. Par exemple, puisque la quantité de monnaie n’est pas suffisante pour payer des salaires, on recours à d’autres engagements : un seigneur laisse exploiter sa terre, mais exige en retour un paiement en nature (champart). Quant aux valeurs monétaires, elles n’inspirent pas du tout les hommes du Moyen Âge, qui ne se battent pas pour l’argent, mais pour d’autres valeurs, notamment sacrées.
Concernant le crédit, cette question est souvent mal comprise. Des formes de crédit existent, et les mécanismes de don et de contre-don en sont une : si mon voisin a besoin de tel outil, je lui prête, et il viendra à mon secours dans le futur. Ces opérations de crédit quotidien sont créatrices d’obligations réciproques, sans cesse renouvelées. Elles sont le ciment de la communauté : on se doit aujourd’hui parce que l’on s’est déjà aidé hier, parce qu’il faut sans cesse rendre ce qu’on a reçu. C’est bien différent de l’usure qui, elle, est explicitement condamnée. L’usure est un excès, quelque chose qui brise l’existence communautaire : elle se produit lorsque j’exige trop, tout de suite, en exploitant les nécessités immédiates de mes voisins.
Guildes et corporations organisent le monde des artisans urbains. Comment se forment et évoluent ses institutions ?
La naissance des communautés de métiers coïncide avec celle des villes. Cependant, leur histoire primitive est assez mal connue, faute de sources. On ne connaît bien les corporations que plusieurs décennies après leur apparition. Ce qui est certain est la chose suivante : le Moyen Âge est un monde communautés. Durant le haut Moyen Âge, ces communautés sont presque essentiellement rurales. Avec l’essor du monde urbain, un nombre croissant d’artisans s’installent en ville. Les corporations se forment pour devenir leur communauté. Les corporations jouent évidemment un rôle économique (régulation des prix, limitation de la concurrence, etc.), mais ce sont aussi des communautés de vie. Elles garantissent des prestations sociales en cas d’accident, protègent non seulement l’artisan mais aussi sa famille, organisent des fêtes communautaires, honorent des saints propres, etc. Tout au long du Moyen Âge, ce fonctionnement semble satisfaisant, et le rôle structurant des corporations n’est pas remis en question. Ce n’est qu’assez tardivement qu’elles sont attaquées, essentiellement au XVIIIe siècle, et par ceux qui refusent toute vision communautaire de l’existence, au nom d’un individualisme abstrait. À ce moment-là, les choses n’ont plus grand-chose à voir avec ce qu’elles ont longtemps été. En effet, au XVIIe et au XVIIIe siècles principalement, l’interventionnisme royal va progressivement dénaturer le fonctionnement des corporations : alors qu’elles étaient un composant fonctionner de l’ordre social, leur statut a peu à peu évolué pour devenir un privilège royal qu’on achète.
L’origine du capitalisme en Occident fait débat. Comment expliquer qu’il naisse et se développe en Europe à la fin du Moyen-Age ?
La question est fort complexe, et j’y consacre d’ailleurs un second volume (Capitalisme moderne et société de marché) à paraître dans quelques jours chez le même éditeur. Pour faire simple, disons qu’il y a plusieurs forces. La première et la plus puissante est la philosophie individualiste, source du libéralisme, qui est portée par la classe bourgeoise montante. La source même de cette philosophie fait débat, et des influences religieuses (judaïsme, protestantisme) sont indéniables. Il y a ensuite la montée en puissance des Etats centralisés : ces Etats se construisent en partie contre les attachement plus locaux, contre les féodalités, les provinces, etc., qui étaient le cœur du monde médiéval. Il y a enfin un rôle de la technique, qui se manifeste un peu plus tard : au XIXe siècle, les chemins de fer permettent un décloisonnement des provinces sans précédent.
Au 19ème et au 20ème siècle, de William Morris à Werner Sombart, des courants très différends vont idéaliser et réhabiliter l’apport communautaire médiéval. Quelle place conserve dans l’imaginaire européen ce « contre-modèle » dans son opposition au capitalisme triomphant ?
Il est absolument frappant que tout le XIXe siècle contribue à réhabiliter le monde médiéval : outre les deux noms que vous mentionnez, on pourrait aussi citer tout le courant romantique allemand, de nombreux auteurs catholiques, quantité de romans de chevalerie anglais. Les hommes de ce siècle ont sous les yeux le triomphe du capitalisme, qui est particulièrement violent au XIXe siècle : déracinement de l’ancienne population rurale, abandon des fêtes, des traditions populaires, destruction de la nature et enlaidissement du monde par les usines, etc. S’il est parfois idéalisé, le Moyen Âge conserve une puissance d’évocation considérable. Je crois qu’il en est toujours ainsi aujourd’hui. Le mélange de sacré et de chevaleresque, l’architecture de lourdes pierres, la légèreté des cathédrales, l’existence communautaire, sont autant d’images qui éveillent l’imaginaire de nombres de nos contemporains. Notons enfin que les historiens ont depuis longtemps fait litière de l’idée d’un « sombre » Moyen Âge : il faut pour cela rendre grâce à Marc Bloch, Georges Duby, Jacques le Goff, Régine Pernoud, et quelques autres.
Pensez-vous que le « socialisme féodal » soit une source d’inspiration encore d’actualité ?
Je pense que le modèle économique féodal peut nous inspirer. Tout d’abord, je pense que nous pourrions partiellement y revenir, qu’on le veuille ou non : les grandes villes sont de plus en plus invivables, il y a un vrai besoin de réenracinement, de circuits courts, etc. Je vois autour de moi des petites communautés en train de se reformer en milieu rural. Tout cela est évidemment le fait d’une minorité très consciente. Mais les circonstances pourraient accélérer la dynamique de manière imprévue. N’oublions pas que la fin de l’Empire romain a vu la population des villes s’effondrer (celle de Rome divisée par 20) : la civilisation urbaine n’est pas un acquis, et pourrait refluer un jour. Il nous faudra alors d’autres modèles.
Guillaume Travers (Rébellion, 31 août 2020)