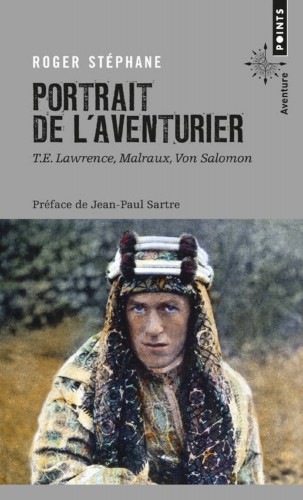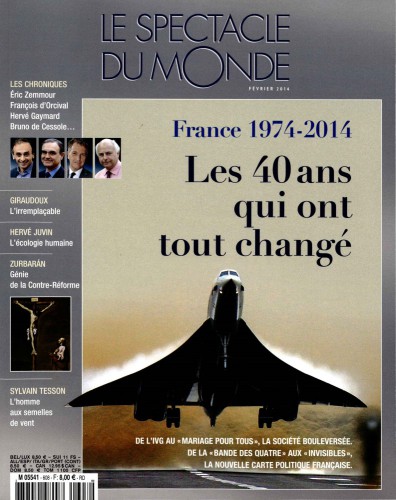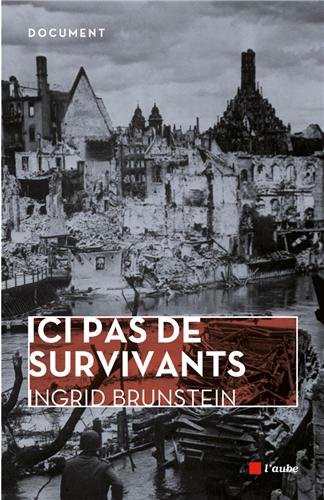Nous reproduisons ci-dessous un court entretien avec Alain de Benoist, cueilli sur le blog de la revue Éléments et consacré à la théorie du genre. Alain de Benoist, qui a consacré une large partie de son dernier essai, Les démons du Bien (Pierre-Guillaume de Roux, 2013) à cette idéologie, doit y revenir prochainement dans Non à la théorie du genre ! , un court ouvrage polémique qui sera publié aux éditions Mordicus.
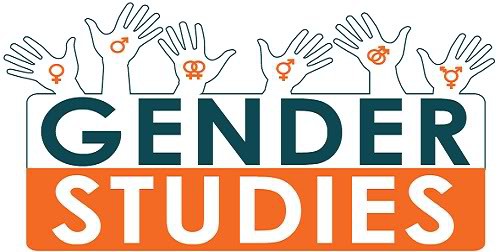
Alain de Benoist : «Non à la théorie du genre !»
Si l’on en croit les journalistes Samuel Laurent et Jonathan Parienté, du « Monde », la « première escroquerie des anti-“gender” » est qu’ils « postulent qu’il existe une idéologie du “gender” ». Connaissant sans doute mieux la question, Sylvain Bourmeau, le directeur de « Libération », est déjà moins catégorique. Certes, lui aussi dit que la « théorie du genre » n’existe pas, mais qu’elle est un « précieux concept de genre que la gauche gagnerait à revendiquer haut et fort ». Concept, idéologie, théorie, comment appeler ce drôle de « genre » ?
Il est parfaitement ridicule de nier l’existence d’une théorie ou idéologie du genre à laquelle des dizaines d’ouvrages ont déjà été consacrés, alors même qu’on s’emploie à en promouvoir les principes. Les journalistes dont vous parlez font marche arrière, car ils découvrent l’ampleur des protestations suscitées par la théorie du genre. Ces gens-là se moquent du monde. Vincent Peillon, lui aussi, affirme maintenant que la théorie du genre n’est pas enseignée à l’« école de la République ». Mais en même temps, il adresse aux directeurs d’établissements scolaires des « outils pédagogiques » lié à un dispositif dit « ABCD de l’égalité », qui se propose de « déconstruire » dès le plus jeune âge des « stéréotypes » qui ne peuvent être considérés comme tels qu’à la condition d’adhérer à la théorie du genre. L’un de ces « outils », par exemple, explique doctement, à propos de la « danse scolaire du Petit Chaperon rouge » (sic) que les filles devront être incitées à jouer le loup, tandis que le rôle du Petit Chaperon rouge sera attribué aux garçons, « la lutte contre les stéréotypes passant d’abord par la mixité des rôles loup-Chaperon ». Ces mots sont révélateurs. Avec l’ambition affichée de « mixer les rôles », il ne s’agit plus du tout de lutter contre les discriminations…
La théorie du genre se révèle par là pour ce qu’elle est : une héritière de ce féminisme égalitaire qui, bien loin de s’employer à réhabiliter ou promouvoir le féminin, proclame qu’il ne peut y avoir d’égalité entre les hommes et les femmes qu’à la condition de faire disparaître tout ce qui permet de les distinguer. Une telle ambition relève clairement de ce que j’ai appelé l’idéologie du Même – une idéologie allergique aux différences, pour laquelle l’égalité est synonyme de mêmeté, une idéologie qui milite en faveur de l’indistinction généralisée.
Il existe une critique chrétienne de l’« idéologie du genre ». Elle s’est déployée d’ailleurs avec beaucoup de vigueur et de force pendant la « Manif pour tous ». On s’en doute, votre approche est différente, puisque vous avez écrit : « L’idéologie du genre, c’est le grand retour du cache-sexe. L’idéologie feuille de vigne : non plus “cachez ce sexe que je ne saurais voir”, mais “cachez ce sexe qui n’a rien à nous dire” ». En quoi votre critique est-elle différente ?
Dans les milieux catholiques, l’idéologie du genre est surtout interprétée comme une théorie visant à légitimer l’homosexualité (dans laquelle le Vatican voit une « conduite sexuelle désordonnée »). C’est à mon sens voir les choses par le petit bout de la lorgnette. La théorie du genre va beaucoup plus loin. En affirmant que l’identité sexuelle n’a aucun rapport avec le sexe, mais se ramène à une « construction sociale » qui ne se fonde sur rien d’autre que le désir individuel ou l’influence du milieu, elle se dévoile en réalité comme une idéologie anti-sexe, liée à un simple fantasme d’auto-engendrement. On se garde de le dire chez les chrétiens, car au cours de son histoire le christianisme a lui-même entretenu des rapports pour le moins ambigus avec la notion de sexe.
Peut-on « fabriquer » une fille en élevant un enfant « neutre » comme une fille, ou un garçon en l’élevant comme un garçon ? L’être humain est-il « neutre » en matière de sexe ?
Les philosophes des Lumières considéraient l’individu comme une table rase à la naissance, une cire vierge. Le postulat de « neutralité » en matière de « genre » que soutient la théorie du même nom se situe dans le prolongement de cette croyance. Ce n’est bien entendu qu’un mythe, contredit par toutes les études empiriques dont on dispose. Celles-ci nous montrent que, dès la naissance, les comportements des garçons et des filles, leurs prédispositions, leurs affinités, etc. sont différents, et que ces différences se retrouveront plus tard dans tous les domaines de la vie. Les travaux réalisés sur les primates montrent de leur côté qu’on retrouve chez les grands singes des différences analogues : les petites guénons préfèrent jouer avec des poupées, les petits mâles avec des bâtons ou des ballons – ce qui ne peut évidemment s’expliquer chez eux par une « attente sociale » ou culturelle. Non seulement, il n’y a pas de « neutralité » sexuelle chez l’être humain, mais le sexe n’est pas qu’une affaire d’organes génitaux. Même le fonctionnement du cerveau diffère chez les hommes et chez les femmes ! Ce qui n’enlève bien entendu rien à l’égale valeur du féminin et du masculin.
Alain de Benoist (Blog Éléments, 3 février 2014)