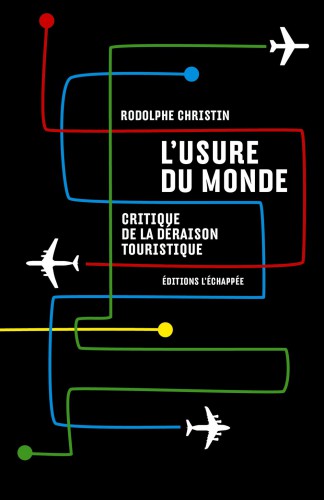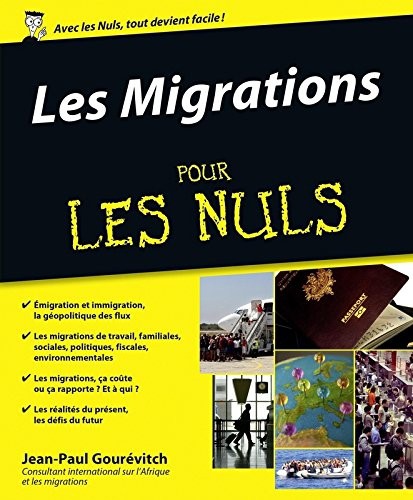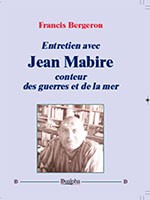Le thriller a-t-il tué le polar ?
Macabre découverte en ce début de troisième millénaire : le roman policier classique agonise dans les rayons de vos bibliothèques. Déjà, tous les soupçons se portent sur son frère sulfureux, le thriller. Enquête et analyse au coeur des enjeux éditoriaux de la fiction populaire criminelle.
Premier constat : le suspect brouille les pistes. La distinction entre polar et thriller pourrait passer pour jargonneuse. Une « querelle d'allemands » entre rejetons revanchards de l'impérialisme anglo-saxon, un simple débat esthétique, voire une évaluation du niveau de prostitution de son auteur dans un contexte marchand (où le thriller serait la simple version « commerciale » du polar, et son auteur un « social-traître » notoire).
Les différences entre polar et thriller ne sont ni spécieuses, ni esthétiques et n’ont rien à voir avec son potentiel de rentabilité économique. Les deux genres n’ont pas les mêmes fonctions auprès du lecteur. Si leurs conceptions du désordre sont compatibles et complémentaires, elles ne sont pas similaires, et donc non concurrentielles.
Le cas du polar
Dans le roman policier, « l'Enigme » est un meurtre (ou une série de meurtres). C'est l'évènement qui perturbe l'ordre du monde. Cette atteinte n'est pas acceptable pour le lecteur, qui va attendre sa résolution, c'est-à-dire l'identification du ou des coupables. Pour cela, son protagoniste principal (policier, détective, journaliste ou simple quidam) applique une méthodologie immuable, une « procédure » inspirée de la démarche policière, basée sur une successions de rencontres et d'échanges verbaux et de collecte de données.
Cette identification est participative : le lecteur essaye de désigner le coupable en même temps que l'enquêteur, voire avant celui-ci (le fameux : « ah, je le savais »), ce qui explique la popularité de ce type de roman, qu'on pourrait qualifier « d'interactif ». Si le récit conclut en désignant X comme « l'Ennemi » - d'après des observations concrètes, des témoignages recevables et des preuves matérielles - le lecteur adhère à cette conclusion puisqu'il y a lui même participé.
La fonction du roman policier est de proposer au lecteur un exercice de désignation participative d'un ennemi commun. Désigner l'ennemi, soit le fondement de toute démarche politique. Cette fonction permet d'expliquer la dimension dite fallacieusement « sociale » du genre. Certains ont en effet eu tout intérêt à remplacer le politique par le « social », le terme n'étant qu'un mot creux approprié par la novlangue d'ingénierie humaine des dominants qui souhaitent conserver un visage humain.
Le thriller
Dans ce genre littéraire, « l'Enigme » est souvent multiple. Si meurtre il y a, celui-ci n'est qu'un sous-ensemble inaugural. L'ordre des choses a été bousculé mais sa perturbation inacceptable n'a pas encore été commise. Elle arrive par la suite et le lecteur ne peut concevoir qu'elle puisse se produire tant elle est terrifiante : ce sont les fondations mêmes des rapports de force qui sont menacées. Le monde du personnage est en péril face à « l'Enigme » protéiforme qui se concrétise alors dans une machination ourdie par un groupe d'ennemis, vite identifiés (soit par une désignation antérieure au récit via l'actualité - par exemple le terrorisme, soit par désignation rapide dans le récit lorsque le héros met à jour un complot mené par des ennemis déjà connus : les gouvernements, les militaires, les lobbys pharmaceutiques ou industriels, etc.).
Il s'agit alors d'empêcher que leurs plans ne se réalisent, de contrer leur attaque - dont on découvre peu à peu l'ampleur et la dangerosité. C'est cette course contre la montre face aux plans de « l'Ennemi » qui va caractériser la procédure narrative du thriller. Le protagoniste va devoir réagir en deux temps : survivre à la menace dans un premier temps, avant de la contrer pour sauver « son » monde.
La fonction du thriller est donc d'entretenir la peur de « l'Ennemi » en jouant sur les dimensions imminentes et paranoïaques de sa dangerosité. Cette fonction n'est ni moins politique, ni moins essentielle que celle du roman policier, comme l'ont démontré les « armes de destructions massives » de Saddam Hussein en Irak, les stocks d'armes chimiques de Bachar-El-Assad en Syrie ou la bombe atomique qu'on nous promet depuis plusieurs années aux mains de l'Iran.
Cette distinction éclaire les raisons pour lesquelles le polar a connu un essor dans les années trente, puis un renouveau dans les années soixante-dix, phases d'intenses questionnements politiques où les choix étaient multiples ; et pourquoi le thriller est revenu en force depuis la fin des années quatre-vingt, où l'effondrement terminal du bloc soviétique a proclamé une fin temporaire de l'histoire politique pour entrer dans une phase de globalisation marchande. Une post-modernité où la peur est l'un des principaux ressorts de l'acte d'achat chez les classes populaires, et où la peur est donc devenue nécessaire aux dominants pour un bon fonctionnement de la société mondiale.
L’âge d’or du polar, avatar de la société bourgeoise
Pour expliquer le lent déclin du roman policier en termes de ventes, certains ont tenté d'évoquer la lassitude du lectorat, explication vite démentie par le nombre ahurissant de séries policières qui existent aujourd'hui sur des dizaines de chaînes de télévision, ou la lente érosion de la lecture chez les classes populaires face à la dite télévision.
Pourtant, le roman érotique Cinquante Nuances de Gray de E.L. James s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires, le thriller ésotérique Da Vinci Code de Dan Brown s'est vendu à près de 90 millions d'exemplaires et le roman fantastique Harry Potter de J.K. Rowling à plus de 400 millions d'exemplaires. Ces trois romans sont des succès de « littérature populaire », preuves que les classes laborieuses ou moyennes lisent encore (et dans des proportions désormais globalisées).
Le déclin du polar s'explique surtout par le changement d'époque. L'après-guerre est une époque de confort matériel marquée par l'affrontement de deux blocs idéologiques antagonistes, où les jeunes lecteurs ressentent le besoin qu'on leur explique quel camp choisir, et leurs parents qu'on leur confirme qu'ils ont fait le bon choix. Dans un contexte de société bourgeoise où la famille est encore une valeur de référence, la désignation de « l'Ennemi » est primordial pour le confort intellectuel de tous.
L'âge d'or du roman policier d'après-guerre, d'origine américaine, correspond à celui du maccarthysme, à un besoin des classes moyennes d'identifier les criminels et les dissidents pour qu'à chaque fin de roman on puisse restaurer l'ordre traditionnel. Une époque où les illustrateurs de collection poche, tels James Avati aux USA ou Michel Gourdon en France, créent des couvertures flamboyantes où se mêlent les délinquants juvéniles, les épouses infidèles, les strip-teaseuses, les mauvais garçons, et tous les archétypes possibles de la Tentation et de la Chute pour l'honnête homme d'alors.
L’impasse du polar français : le néo-polar
A partir de la fin des années soixante, les jeunes auteurs français de roman policier sont presque tous issus du gauchisme politique. Cette génération intègre deux héritages : les « vieilles » Série Noire des années cinquante et l'expérience de mai 68, ce qui lui permet de réaliser un hold-up idéologique en convaincant les lecteurs, les éditeurs et les attachés de presse que le roman policier est un genre forcément « social ». Ce glissement sémantique était nécessaire pour asseoir leur domination idéologique. Le terme « politique » laissait encore trop de champ libre aux potentiels empêcheurs de collectiviser en rond , il fallait un terme tout aussi parlant mais beaucoup plus réducteur, qui permette une association d'idée immédiate et obligatoire avec le marxisme, d'où la trouvaille du roman « d'intervention sociale » de Jean-Patrick Manchette. Il n'y croira pas très longtemps, mais ses adeptes en feront une véritable religion. Derrière l'agit' propagande, cette jeune génération gauchiste avait parfaitement compris que la fonction du roman policier était de désigner « l'Ennemi », et elle n'allait pas s'en priver. Inversant sans vergogne les codes du roman policier classique, elle a systématiquement mis en valeur les exclus, les marginaux, les délinquants, non plus pour servir d'épouvantails sur les couvertures, mais afin de mener « la révolte des masses contre l'ordre établi et l'oppression fasciste ».
Le néo-polar ne fut donc qu'un mouvement littéraire révolutionnaire, sans approche esthétique particulière ou novatrice (si ce n'est un « comportementalisme » hideux emprunté aux auteurs américains et venu du journalisme), et qui fut avant tout un cache misère pour beaucoup d'auteurs médiocres, dénués de style ou de puissance d'évocation, et dont le but était d'écrire des tracts politiques via le biais de fictions criminelles où « l'Ennemi » est toujours le même.
En l'espace de quelques années, le filon est épuisé et le genre finit par se caricaturer, avant de sombrer dans le totalitarisme. Il ne pouvait en être autrement : l'idéologie avait confisqué la fonction première du genre. Avec le néo-polar, le lecteur n'est plus « convaincu », il est sommé de « croire », sous peine d'être dénoncé comme « complice de l'Ennemi ». Le néo-polar cessa d'être populaire (les pauvres n'aimant bizarrement pas payer pour se faire insulter) pour devenir la propriété d'une classe aisée de fonctionnaires et d'universitaires, qui eurent alors beau jeu de fustiger la télévision pour tenter d'explication son abandon par les classes laborieuses.
Au maccarthysme littéraire du polar des années 50 à destination du père de famille, le néo-polar français répondit par une crise d'adolescence à destination du fils rebelle. En l'absence de nouvelle vision de la structure narrative ou de nouveaux ressorts de l'intrigue, le néo-polar se condamne à n'être qu'une transition, pour ne pas dire un effet de mode. La littérature étant un art, la vraie révolution ne pouvait se faire qu'en matière esthétique. Les auteurs de néo-polars ne l'ont jamais compris, aveuglés par l'idéologie, ou n'en ont jamais eu les moyens littéraires, le néo-polar ayant surtout créé des vocations chez des esprits militants et non chez des esprits créatifs.
Le nouveau règne du thriller
La fin des années quatre-vingt marque le début du règne sans partage du thriller, forme régénérée du « roman de suspense ». L'instant historique de sa réapparition n'est pas anodin. Lorsque sortent en 1990 puis en 1991 deux adaptations cinématographiques à succès de thrillers américains ( A la poursuite d'Octobre Rouge », d'après un roman de Tom Clancy de 1984, et le « Silence des Agneaux » d'après une oeuvre de Thomas Harris écrite en 1988), les spectateurs ne savent pas qu'ils viennent d'assister à une passation de pouvoir narratif au sein de la fiction populaire.
Dans le premier, suspense classique sur fond militaro-politique, « l'Ennemi » est encore le bloc soviétique, c'est à dire un adversaire idéologique des américains. Dans le second, aux allures de polar mais devant tout au thriller, « l'Ennemi » est désormais une figure archétypale qui va s'imposer dans la majorité des fictions criminelles : celle du tueur en série. A l'aube de l'effondrement du communisme soviétique d'état, le Silence des Agneaux est un roman précurseur qui s'inscrit dans son époque charnière.
C'est le roman de la post-modernité politique, où la Russie se rallie à l'idéologie de marché la plus mafieuse, où la Chine prépare son nouveau règne industriel ultra-libéral. Puisque la guerre froide est désormais obsolète, puisque règne partout l'idéologie de la marchandise, voici venue l'ère des adversaires indistincts et anonymes, psychopathes tuant au hasard selon des logiques incompréhensibles. Le nouvel « Ennemi » de la fiction populaire est à l'image de son époque : absurde et hyperviolent. Sans ennemi extérieur, la société est condamnée à se dévorer elle-même, d'où la figure du personnage anthropophage, « Hannibal le cannibale », pour incarner ce symbolisme.
Le ressort fondamental de l'identification conjointe du coupable entre lecteur et auteur s'efface pour laisser la place au seul suspense de l'ultime rebondissement. La démonstration rationnelle de la culpabilité est obsolète dans une société privée de toute possibilité de faire de la politique - puisqu'il n'y a plus qu'un modèle possible. Reste alors aux auteurs de fiction criminelle populaire la seule possibilité de jouer sur la peur de « l'Ennemi », qui est la fonction du thriller.
C'est de ce changement majeur dans l'appréhension du monde que va venir la contamination progressive du roman policier par les codes du thriller, parce que ceux-ci sont désormais les seuls à parler et intéresser les lecteurs, ils sont les seuls à bien se vendre, et vont entraîner de fait les éditeurs à vouloir « thrilleriser » leurs fictions policières à grand renfort de tueurs en série, de rebondissements et d'hémoglobine, tous les ressorts de la mise en scène de la peur, et non outils de déduction rationnelle.
En France, les mêmes qui n'admettent pas la fin du communisme d'état vont alors être ceux qui n'admettent pas le déclin du roman policier et du néo-polar. Face à la montée inexorable du thriller, ils ne pourront que se réfugier dans un élitisme pourtant aux antipodes de leurs soit disantes convictions (qu'on pourrait traduire par : « au peuple le thriller, à l'élite le Roman Noir »).
Le thriller s'est imposé parce qu'il correspond au nouvel ordre mondial, au nihilisme grandissant. Le thriller, par sa fonction et ses ressorts « spectaculaires » est la littérature parfaite du « sentiment imminent de la catastrophe générale » qui s'est emparé de beaucoup de populations mondiales, pas dupes du règne du « divertissement/abrutissement ».
N'importe quel thriller correctement écrit dépeint désormais bien mieux le monde qui nous entoure et ses principaux enjeux que les sempiternelles enquêtes policières ou journalistique dont les modèles narratifs sont dépassés face à la dictature de l'image, de la mise en réseau, de la violence relationnelle, de la compétition permanente, de l'impérieuse nécessité du bruit.
Le pouls du polar bat-il encore ?
Si nous poursuivons dans la voie d'un nihilisme croissant, celui-ci entraînera la dilution terminale du roman policier originel dans le thriller, le polar à l'ancienne se contentant d'une survivance sous perfusion via un marché de niche, en attendant peut-être la fin de la littérature elle-même dans l'indifférence et le bruit du spectacle permanent.
Si nous estimons que le retour d'un questionnement politique, ou au moins la remise en cause du libéralisme comme modèle unique, est le prélude d'évènements qui annoncent une rupture et un monde nouveau, à l'image des années trente (le roman policier américain moderne a émergé de la crise de 1929, de l'exode rural massif, et a bénéficié de la seconde guerre mondiale pour s'imposer en Europe), il reste des raisons de croire encore à cette forme d'expression populaire. Un retour du politique, de la possibilité réaffirmée de faire des choix réels, réactiverait le besoin de désigner des ennemis propres (et non plus imposés par le marché), et donc un retour de la fonction première du roman policier.
Quelles formes esthétiques prendrait alors ce roman policier de demain ? C'est tout l'intérêt des prochaines années qui sont devant nous.
Pierric Guittaut (Fin de chasse, 30 juillet 2014)