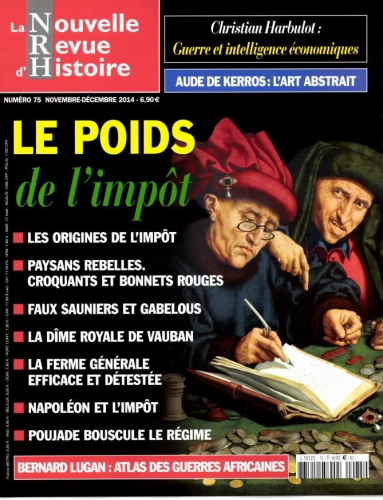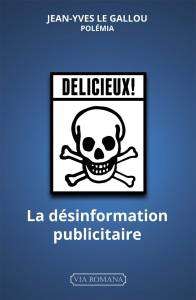Nous reproduisons ci-dessous un entretien avec Jean-Pierre Le Goff, cueilli sur le site du Figaro et consacré aux pathologies de notre société...
Jean-Pierre Le Goff est sociologue et a publié de nombreux essais, dont La gauche à l'épreuve 1968 - 2011 (Tempus, 2012) et La fin du village (Gallimard, 2012).

Clowns violents, McCarthy, télé-réalité : de la société du spectacle à la société du cirque
FIGAROVOX: Comment expliquez-vous les agressions menées par des individus déguisés en clown? Ne sont-elles pas une manifestation de la dégradation de l'état des mœurs dans notre société?
Jean-Pierre le Goff: Ces phénomènes s'enracinent dans une culture adolescente et post-adolescente qui se nourrit de séries américaines mettant en scène des clowns maléfiques, de vidéos où des individus déguisés en clown font semblant d'agresser des enfants, mais aussi des films d'horreur avec leurs zombies, leurs démons, leurs vampires, leurs fantômes… Le film «Annabelle», qui met en scène une poupée tueuse et un jeune couple attaqué par les membres d'une secte satanique, a dû être déprogrammé dans certaines salles suite au déchaînement d'adolescents surexcités... Dans le Pas de Calais, certains individus déguisés en clown ont brandi des tronçonneuses devant une école, en écho au film d'horreur à succès des années 1970, «Massacre à la tronçonneuse» qui sort à nouveau dans les salles. Face à ces phénomènes, la société et ses experts cherchent à se rassurer: il s'agit d'une catharsis nécessaire, une sorte de passage obligé pour les adolescents qui se libèrent ainsi de leur angoisse, satisfont un désir de transgression propre à leur âge. Si ces aspects existent bien, nombre d'agressions auxquelles on assiste débordent ce cadre et l'on ne saurait en rester à une fausse évidence répétée à satiété: ces phénomènes ont toujours existé.
Face aux «clowns agresseurs», une partie de la société est déconcertée et hésite sur le type de réponse à donner: où met-on la limite? Ne risque-t-on pas de faire preuve d'intolérance vis-à-vis de la jeunesse? Mais, à vrai dire, le sujet paraît plus délicat: comment remettre en cause une culture adolescente faite de dérision et de provocation qui, depuis des années, s'affiche dans les médias et s'est érigée en une sorte de nouveau modèle de comportement? Le jeunisme et sa cohorte d'adultes qui ont de plus en plus de mal à assumer leur âge et leur position d'autorité vis-à-vis des jeunes, pèsent de tout leur poids. Le gauchisme culturel et ses journalistes bien pensants sont là pour dénier la réalité et développer la mauvaise conscience: «Attention à ne pas retourner à un ordre moral dépassé, à ne pas être ou devenir des conservateurs ou des réactionnaires…» Ces pressions n'empêchent pas une majorité de citoyens de considérer que nous avons affaire à quelque chose de nouveau et d'inquiétant qu'ils relient au développement des incivilités et des passages à l'acte.
Le phénomène des «clowns agresseurs» tend à effacer les frontières entre la farce et l'agression, ce qui permet à des voyous et des voleurs de brouiller leurs forfaits. On est loin des blagues de potaches d'antan, des émissions de télévision comme «La caméra invisible» ou «Surprise surprise» auxquelles ont succédé des «caméras cachées» menées par des animateurs ou de nouveaux «comiques» qui, protégés par leur statut d'intouchable télévisuel, provoquent méchamment leurs victimes jusqu'à la limite de l'exaspération. Filmer des agressions ou des méfaits sur son portable est une pratique qui s'est répandue chez les adolescents. La transgression s'est banalisée dans le monde spectaculaire des médias et des réseaux sociaux. Elle ne se vit plus comme une transgression - qui implique précisément la conscience de la norme, des risques et du prix à payer pour l'individu ; elle est devenue un jeu, une manière d'être et de se distinguer, dans une recherche éperdue de visibilité, comme pour mieux se sentir exister.
Les agressions d'individus déguisés en clown renvoient à une déstructuration anthropologique et sociale de catégories d'adolescents et d'adultes désocialisés, psychiquement fragiles, nourris d'une sous-culture audiovisuelle et de jeux vidéos, en situation d'errance dans les réseaux sociaux, pour qui les frontières entre l'imaginaire, les fantasmes et la réalité tendent à s'estomper. Une telle situation amène à s'interroger sur les conditions psychologiques, sociales et culturelles qui ont rendu possible une telle situation. Dans cette optique, les bouleversements familiaux et éducatifs qui se sont opérés depuis près d'un demi-siècle ont joué un rôle important. Il en va de même du nouveau statut de l'adolescence qui déborde cette période transitoire de la vie pour devenir, sous le double effet du jeunisme et du non-travail, un mode de vie et de comportement qui s'est répandu sans la société . Il est temps d'en prendre conscience, d'assumer l'autorité et d'expliciter clairement les limites et les interdits, si l'on ne veut pas voir se perpétuer des générations d'individus égocentrés, immatures et fragiles, avec leur lot de pathologies et des faits divers en série.
Quel est le rôle joué notamment par les nouveaux instruments de communications? Internet et les grands médias audiovisuels alimentent-ils ce show perpétuel?
Elles font écho à un individualisme autocentré et en même temps assoiffé de visibilité, mais elles ne le créent pas. Ce type d'individu a constamment besoin de vivre sous le regard des autres pour se sentir exister. Internet et les nouveaux moyens de communication lui offrent des moyens inédits pour ce faire, avec l'illusion que chacun peut désormais accéder à quelques instants de gloire. Ces derniers sont rapidement oubliés dans le flux continu de la communication et des images, mais ils sont recherchés à nouveau dans une course sans fin où l'individu vit à la surface de lui-même et peut finir par perdre le sens du réel et l'estime de soi, pour autant que ces notions aient encore une signification pour les plus «accros». Ces usages n'épuisent pas évidemment les rapports des individus à Internet et aux médias qui demeurent des outils de communication et d'information - sur ce point l'éducation première, l'environnement familial, social et culturel jouent un rôle clé -, mais ils n'en constituent pas moins leur versant pathologique. L'égocentrisme et le voyeurisme se mêlent au militantisme branché quand les Femen montrent leur seins, quand on manifeste dans la rue dans le plus simple accoutrement, quand on se met à nu pour de multiples raisons: pour défendre l'école, l'écologie, les causes caritatives…, ou plus simplement, quand des pompiers ou des commerçants font la même chose pour promouvoir la vente de leur calendrier, en cherchant à avoir le plus d'écho sur Internet et dans les médias.
Sans en arriver là, on pourrait penser que le nombre des «m'as-tu vu» qui «font l'important» s'est accru - ceux qui veulent à tout prix «en être» en s'identifiant tant bien que mal aux «people» de la télévision, ceux qui se mettent à parler la nouvelle langue de bois du «politiquement correct» de certains médias, ceux qui ne veulent pas ou ne tiennent pas à s'opposer aux journalistes militants, ou au contraire ceux qui dénoncent le système médiatique tout en étant fasciné par lui et en y participant… Ceux-là sont nombreux sur les «réseaux sociaux» où ils peuvent s'exposer et «se lâcher» sans grande retenue en se croyant, suprême ruse de la «société du spectacle», d'authentiques rebelles et de vrais anticonformistes. On ne saurait pour autant confondre cette exposition «communicationnelle» et médiatique avec la réalité des rapports sociaux et la vie de la majorité de nos compatriotes qui ont d'autres soucis en tête, qui se trouvent confrontés à l'épreuve du réel dans leur travail et leurs activités. En ce sens, les grands médias audio-visuels, Internet et les nouveaux moyens de communication ont un aspect de «miroir aux alouettes» et de prisme déformant de l'état réel de la société.
Existe-t-il encore des frontières entre spectacle et politique? N'est-on pas amené à en douter quand une émission de télévision met en scène des politiques déguisés pour mieux vivre et connaître la réalité quotidienne des Français?
Cette émission n'a pas encore été diffusée mais elle a déjà produit ses effets d'annonce… J'avoue que j'ai eu du mal à croire à ce nouvel «événement» médiatique: comment des politiques, dont certains ont occupé de hautes fonctions comme celles de Président de l'Assemblée nationale, ou de ministre de l'Intérieur et de la Défense, ont-ils pu accepter de se prêter à un tel spectacle télévisuel au moment même où le désespoir social gagne du terrain et où le Front national ne cesse de dénoncer la classe politique? Peuvent-ils croire sérieusement qu'une telle émission va contribuer à les rapprocher des Français et à mieux connaître la réalité? Quelle idée se font-ils de leur mission? J'entends déjà les commentaires qui diront que cela ne peut pas faire de mal, que cela peut aider à mieux comprendre les problèmes des français, qu'il faut s'adapter à la «modernité» et tenir compte de l'importance des médias, qu'on ne peut pas aller contre son temps…
C'est toujours la même logique de justification, celle de la «bonne intention» ou de la fin noble qui justifie les moyens qui le sont moins, agrémentée d'une adaptation de bon ton à la modernité, sauf que le moyen en question est une formidable machinerie du spectaculaire et que prétendre de la sorte comprendre les préoccupations des citoyens ordinaires est un aveu et une confirmation des plus flagrantes de la coupure existante entre le peuple et une partie de la classe politique. En fonction des informations dont je dispose sur cette nouvelle affaire médiatique, il y a fort à parier qu'elle va donner encore du grain à moudre au Front national et qu'elle risque de creuser un peu plus le divorce avec les Français qui, même s'ils sont nombreux à regarder cette émission, ne confondent pas pour autant le spectacle télévisuel avec la réalité.
Je ne suis pas un puriste dans l'usage des médias, mais il y a un seuil à ne pas dépasser, sous peine de verser dans le pathétique et l'insignifiance. Je ne peux m'empêcher de considérer cette nouvelle affaire médiatique comme déshonorante pour la représentation nationale et la fonction politique. C'est un pas de plus, et non des moindres, dans un processus de désinstitutionnalisation et de dévalorisation de la représentation politique auquel les hommes politiques ont participé en voulant donner à tout prix une image d'eux-mêmes qui soit celle de tout un chacun . J'espère qu'au sein du monde politique, des personnalités se feront entendre pour désavouer de telles expériences télévisuelles au nom d'une certaine idée de la dignité du politique.
Existe-t-il encore des frontières entre spectacle et politique, entre dérision et sérieux, entre le réel et le virtuel?
Oui, fort heureusement, pour la majorité de la population. Mais j'ajouterai que ces frontières sont plus ou moins nettes selon les situations et les activités particulières des individus. Au sein du milieu de l'audiovisuel comme dans certains milieux de la finance, il existe une tendance à se considérer comme les nouveaux maîtres du monde en n'hésitant pas à donner des leçons sur tout et n'importe quoi. L'humilité est sans doute une vertu devenue rare dans les univers de l'image, de la communication et de la finance qui ont acquis une importance démesurée. En l'affaire, tout dépend de l'éthique personnelle et de la déontologie professionnelle de chacun. Mais il n'est pas moins significatif que l'animateur, le journaliste intervieweur, à la fois rebelle, décontracté et redresseur de tort, soit devenu une figure centrale du présent, une sorte de nouveau héros des temps modernes qui s'affiche comme tel dans de grands encarts publicitaires dans les journaux, à la télévision ou sur les panneaux d'affichage.
Le rôle de «médiateur» à tendance à s'effacer derrière le culte de l'ego. Le fossé est là aussi manifeste avec la majorité de la population. Comme le montre de nombreux sondages, les Français font de moins confiance aux médias et les journalistes ont tendance à être considérés comme des gens à qui on ne peut pas faire confiance, quand ils ne sont pas accusés de mensonges et de manipulation. Quant aux traders qui se considéraient omnipotents, ils ont connu quelques déboires. Jérôme Kerviel, après avoir été considéré comme l'exemple type de l'«ennemi» qu'était supposé être la finance, a été promu victime et héros de l'anticapitalisme par Jean-Luc Mélenchon. Tout peut-être dit et son contraire, on peut vite passer de la gloire à la déchéance au royaume de la communication et des médias.
La fracture n'est pas seulement sociale, elle est aussi culturelle. Cette fracture se retrouve avec ceux que j'appelle les «cultureux» qui ont tendance à confondre la création artistique avec l'expression débridée de leur subjectivité. Un des paradigmes de l'art contemporain consiste à ériger l'acte provocateur au statut d'œuvre, devant lequel chacun est sommé de s'extasier sous peine d'être soupçonné d'être un réactionnaire qui souhaite le «retour d'une définition officielle de l'art dégénéré», comme l'a déclaré la ministre de la culture, à propos du «plug anal» gonflable de Paul McCarthy, délicatement posé sur la colonne Vendôme avant d'être dégonflé par un opposant. Tout cela n'a guère d'emprise sur la grande masse des citoyens, mais n'entretient pas moins un monde à part, survalorisé par les grands medias audiovisuels et les animateurs des réseaux sociaux, en complet décalage avec le «sens commun». Les citoyens ordinaires attendent des réponses crédibles et concrètes à leurs préoccupations qui ont trait à l'emploi, au pouvoir d'achat, à l'éducation des jeunes, à l'immigration, à la sécurité…
Les politiques férus de modernisme à tout prix, comme nombre d'intellectuels et de journalistes, ont-ils la volonté de rompre clairement avec ce règne de l'insignifiance, des jeux de rôle et des faux semblants, pour redonner le goût du politique et de l'affrontement avec les défis du présent? En tout cas, le pays est en attente d'une parole forte et de projets clairs qui rompent avec cette période délétère et permettent de renouer le fil de notre histoire, pour retrouver la confiance en nous-mêmes au sein de l'Union européenne et dans le monde.
Jean-Pierre Le Goff (Figarovox, 1er novembre 2014)