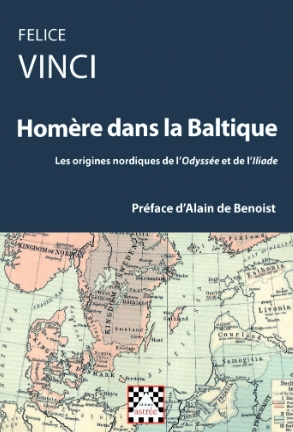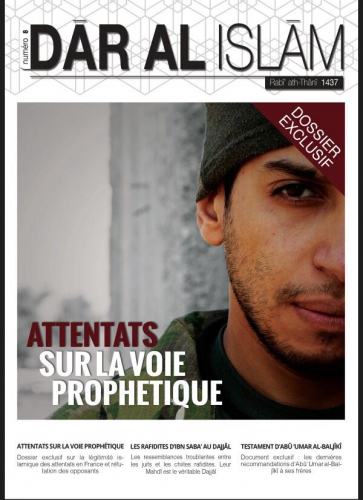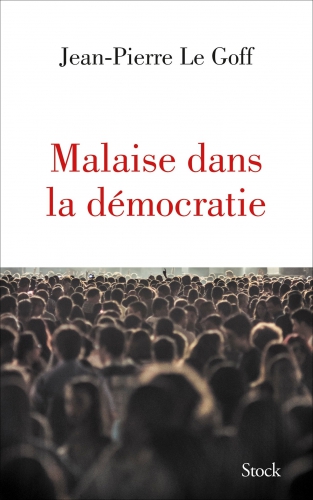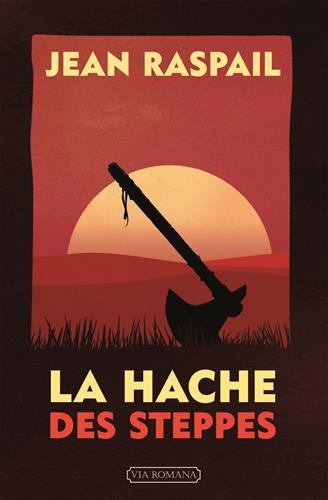Quand les élites bradent l’industrie française
Pour l'auteur du livre "Alstom, scandale d’Etat", nos dirigeants, politiques comme hauts fonctionnaires, ont une responsabilité majeure dans le déclin de l'industrie française. Il en veut pour preuve les cas Alstom, Vallourec ou bien encore ST Microelectronics.
Eléonore de Vulpillières : Areva, Alstom, Alcatel mais aussi Vallourec ou STMicroelectronics sont en difficulté. Quels sont les points communs et les différences qui existent ?
Jean-Michel Quatrepoint : La France avait autrefois le triple A de l’excellence industrielle avec Areva, Alstom et Alcatel. Il s’est désormais mué en un triple zéro. La partie énergie d’Alstom a été vendue à General Electric. Alcatel avait déjà été fusionnée avec le groupe américain Lucent. A l’intérieur du groupe fusionné, les Américains ont pris le pouvoir et ont appliqué leurs normes, leur façon de voir, y compris au profit de services américains. Alcatel étant devenue l’ombre d’elle-même, elle a été rachetée par Nokia. Elle était pourtant l’un des leaders mondiaux des équipements de télécommunications au début des années 1990, et même numéro un avec 13,5% de la part de marché des télécoms. Aujourd’hui, la France est sortie de ce marché.
Areva était le géant de la filière nucléaire, aussi bien pour le traitement et l’enrichissement d’uranium, le traitement des déchets avec l’usine de La Hague, et toute la partie de construction des centrales nucléaires. Aujourd’hui, Areva est au bord de la faillite. On oblige EDF à reprendre en catastrophe une partie de ses activités, alors même que la santé d’EDF est médiocre.
Alstom était un des quatre grands fabricants mondiaux de turbines servant à équiper les centrales. Il a été bradé à General Electric. Ce qui est commun à tous ces dossiers, c’est la faillite du management. Une génération de nos hyper diplômés a mal géré l’évolution de l’industrie. On pourra toujours évoquer la crise ou les aléas économiques. Mais la responsabilité des dirigeants et celle de l’Etat sont écrasantes.
Tous ces cas particuliers témoignent-ils de la faillite de l’industrie française ?
L’industrie française est, à de rares exceptions près, sur le déclin. Prenons l’exemple de Sanofi, qui a vendu Merial, la pépite vétérinaire du groupe à l’Allemand Boehringer. Désormais, la France, pays dont l’agriculture est un secteur stratégique, n’est plus en pointe sur le secteur des produits vétérinaires. Or, quand on veut conserver une grande agriculture, il faut préserver un laboratoire capable de développer et d’innover dans le secteur vétérinaire. Le nouveau PDG de Sanofi, Olivier Brandicourt, est arrivé avec un golden hello, une prime d’embauche, alors même que le groupe licencie 600 personnes et sabre dans sa recherche. Pour obéir à une vision financière et court-termiste des marchés il vend Merial pour en retirer 4,7 milliards d’euros et devenir le leader mondial du médicament sans ordonnance. Merial était la part la plus rentable du groupe : on vend ce qui rapporte et ce qui est stratégique pour l’agriculture de demain, et ce, dans le seul but de financer un plan de rachat d’actions. BlackRock, patron du plus gros gestionnaire d’actifs au monde a dénoncé cette vision court-termiste de la gouvernance d’entreprise. Les plans de rachat d’actions sont une aberration industrielle. C’est une destruction de valeur et de capital : le « capitalisme autophage ». Quand on a du cash, on investit.
Dans votre livre, Alstom, scandale d’Etat, vous dénonciez la cession de la branche énergie d’Alstom à General Electric. Un plan de licenciements massifs est en préparation. Que pensez-vous de l’évolution du dossier ?
Sur le dossier Alstom, j’ai rarement vu des gens mentir avec autant d’effronterie. M. Immelt avait promis la création de 1 000 emplois industriels en trois ans. Le 24 septembre 2015, à Belfort, il avait même parlé de 1 500 emplois. C’était la contrepartie pour obtenir la garantie de la Coface pour des contrats en Arabie saoudite et au Brésil. Une fois la fusion entérinée le 2 novembre 2015, on a annoncé un plan de suppression de 6 500 emplois en Europe, soit 20% des effectifs d’Alstom-Energie. Nos autorités se gargarisent en estimant que nous sommes moins touchés que les autres, avec une suppression de 831 postes en France. Nos amis allemands, dont deux usines sont très touchées, apprécieront ce relativisme… On nous avait expliqué que l’alliance avec Siemens serait un bain de sang social. Or, le bain de sang social il est avec GE.
Les emplois supprimés ne concernent pas seulement les fonctions support (200 seulement) mais des emplois industriels dans la partie nucléaire et les installations de Massy et Levallois. En fait Immelt s’est engagé auprès de ses actionnaires et des marchés à atteindre un taux de retour sur investissement de 16% (ce qui est très élevé). Pour atteindre ce pourcentage, il faut faire 3 milliards de synergies. En fait 3 milliards d’économies. D’où les licenciements. D’où également le rabais de 300 millions sur le prix de vente, consenti subrepticement cet été par Patrick Kron. Quant aux promesses des emplois créés, elles n’ont engagé que ceux qui voulaient y croire. Le temps passe et les promesses s’oublient. GE ne respectera pas ses engagements de création d’emploi. Il n’y aura plus de garant français de cette promesse. Mme Gaymard vient d’être remerciée de son poste de directrice de GE France, après avoir bien servi les intérêts du groupe américain. Patrick Kron est parti avec armes et bonus. Tout comme Grégoire Poux-Guillaume, qui avait initié la négociation avec GE parti en novembre pour prendre la direction de Sulzer. On dénonce souvent le discours anti-élites qui ferait le jeu des populismes. Mais quand les élites se comportent de cette façon, difficile de ne pas les dénigrer !
Comment s’articule cette double responsabilité – que vous imputez aux dirigeants des grands groupes et à l’Etat – du déclin de l’industrie française ?
M. Kron a fourgué Alstom à GE. M. Tchuruk a d’abord fourgué Alcatel à Lucent, puis ses successeurs ont laissé un Alcatel moribond être repris par Nokia. Quant à Areva, Mme Lauvergeon a fragilisé son entreprise ; les autres patrons de la filière énergétique, Alstom et EDF, n’ont pas su coopérer avec elle. Les querelles d’ego de cet establishment français ont coûté cher au pays.
Le cas de Vallourec est également significatif. Son PDG, Philippe Crouzet, énarque, n’a pas su anticiper les évolutions du marché, n’a pas pris les bonnes décisions au bon moment, a minimisé l’ampleur des bouleversements apportés par les gaz de schiste. Il se tourne alors vers l’Etat pour renflouer l’entreprise. En toute logique, avec un tel bilan, l’Etat aurait dû exiger son départ, avant de mettre la main à la poche. Il n’en a rien été. Il a été reconduit à la tête du directoire. Serait-ce parce qu’il est le mari de Sylvie Hubac (ENA promotion Voltaire) qui fut trois ans directrice du cabinet de François Hollande ?
Il n y a pas que Vallourec, mais aussi ST Microelectronics qui connaît de grandes difficultés !
STMicroelectronics est une société franco-italienne créée en 1987 qui fabrique des composants électroniques. L’entreprise a reçu beaucoup d’argent public, semble-t-il mal employé. Elle est aujourd’hui en grande difficulté. Son patron, Carlo Bezotti a pris de mauvaises décisions mais les deux Etats actionnaires (à 13,5 %chacun) n’ont pas joué leur rôle de garant des intérêts collectifs, et de stratège. Sans doute parce qu’en France, les mentalités de la haute fonction publique ont évolué. Il y a toujours autant d’énarques. Ils sont toujours arrogants mais, hier, ils étaient un peu plus compétents. Et surtout il y avait dans les autres ministères des hauts fonctionnaires, des techniciens qui savaient ce qu’était une industrie, qui connaissaient les filières, les produits. Depuis que le ministère de l’Industrie a été absorbé par Bercy, l’Etat s’est transformé en banquier d’affaires avec une vision purement financière des entreprises. En outre l’Etat n’a plus les moyens d’anticiper. Il n’agit plus qu’en pompier avec une approche comptable et politicienne de l’industrie.
La direction de ST Micro va supprimer sa division DPG qui fabriquait des puces. Plus de 1 500 licenciements dont près de 500 en France et l’usine Crooles II de Grenoble est menacée. L’ancien maire socialiste de Grenoble, Michel Destot, ainsi qu’une partie des élus locaux s’en étaient inquiétés auprès de François Hollande qui leur avait répondu… que le dossier resterait suspendu jusqu’aux régionales. Celles-ci passées… on ferme et Bercy a refusé d’examiner des solutions alternatives pour préserver l’activité de cette division qui est pourtant hautement stratégique. Altis avait pourtant proposé de reprendre une partie des activités menacées pour créer un pôle de composants souverains.
L’indépendance de la France se joue-t-elle aussi sur le plan industriel ?
Nous sommes de plus en plus dépendants en matière de composants électroniques dits de souveraineté. A chaque fois que nous vendons un Rafale à l’exportation, nous sommes obligés d’envoyer une délégation aux services de défense américains pour obtenir l’autorisation. Il y a en effet quelques composants du Rafale fabriqués par les Américains. Ils se sont arrogé le pouvoir de délivrer ou non cette autorisation, au nom des normes ITAR. Ainsi, ils ont bloqué l’exportation de satellites français à la Chine. Il serait impératif que la France reconstitue une capacité de fabrication des composants de souveraineté, notamment ceux qui équipent nos systèmes d’armements. On pouvait le faire à partir de STM. Le ministère de la Défense y était favorable. Mais comme Bercy a refusé d’étudier le dossier, rien n’a été fait.
Cette nouvelle génération de hauts fonctionnaires et d’énarques ne s’intéresse pas à la politique industrielle. Ils n’ont aucune idée de la notion d’intérêt national. Ils ont été biberonnés au lait de l’atlantisme. Pourquoi vouloir l’indépendance en matière de haute technologie ? Autant s’en remettre aux Américains…
Dans une interview du 3 février au Figaro, le ministre de l’Economie a pourtant plaidé pour un Etat stratège…
Emmanuel Macron définit l’Etat comme ne devant être ni « un actionnaire imprévisible et arbitraire, ni un actionnaire interventionniste et brutal, ni un actionnaire complaisant dont le rôle se bornerait à nommer des copains à la tête des entreprises. » Mais que ne l’a-t-il fait quand il s’est agit de reconduire Philippe Crouzet à la tête de Vallourec… Que ne l’a t-il fait sur le dossier Alstom ? Que ne le fait-il sur le dossier ST Microelectronics ? Vanter les mérites du numérique et des start-ups est bien. Faire en sorte que nos savoir-faire, nos brevets, nos hommes, qui ont permis à notre pays d’être leader dans bien des technologies, ne soient pas bradés, serait encore mieux.
Toutes ces erreurs de management, cette absence de vision stratégique par l’Etat se sont traduits par des centaines de milliers de suppressions d’emplois qualifiés, par des déficits commerciaux abyssaux, par une perte de substance de notre pays.
S’imaginer que l’on va s’en sortir et résorber le chômage de masse grâce aux emplois aidés, au tourisme (en recul avec les attentats) et aux services aux personnes est une vue de l’esprit. A moins que ces élites n’aient intériorisé notre déclin.
Jean-Michel Quatrepoint, propos recueillis par Eléonore de Vulpillières (Causeur, 9 février 2016)