Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Michel Leblay cueilli sur Polémia et consacré au refus des consultations référendaires du peuple par les élites du système.
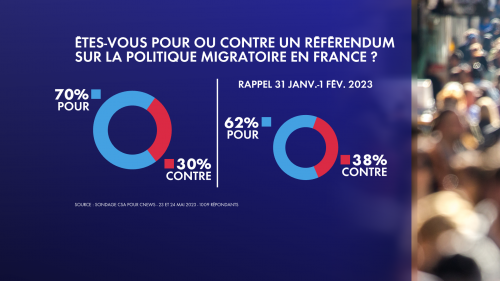
Référendum sur l’immigration : la méfiance des élites envers la souveraineté populaire
Le site Télos a publié le 27 mai dernier un article de Messieurs Elie Cohen, Gérard Grunberg et Pasquale Pasquino intitulé Le choix inquiétant des Républicains. Il s’agit d’une critique de l’annonce dans Le journal du dimanche du 21 mai 2023 par Eric Ciotti, Olivier Marleix et Bruno Retailleau de deux propositions de loi sur l’immigration. La première proposition vise à permettre la tenue d’un référendum sur l’immigration et la seconde a pour objet l’adoption de mesures restrictives sur l’immigration. Face à ces deux propositions, les auteurs de l’article marquent leur opposition avec les intentions formulées par les trois élus Républicains qu’ils résument en trois mesures : une réforme constitutionnelle pour élargir l’objet du referendum à la politique de l’immigration ; une remise en cause de la primauté de la norme juridique européenne sur la norme nationale ; et une primauté de la décision politique sur son interprétation juridique.
Une conception de la démocratie
Ce qui retient d’abord l’attention c’est la conception avancée par les trois auteurs de ce que doit être une démocratie et leur considération pour la souveraineté populaire. C’est certainement à ce titre que l’article doit être relevé en premier lieu. Deux phrases extraites de celui-ci en traduit l’esprit : LR remet à l’honneur la pratique du référendum, partageant ainsi la tendance antiparlementaire de la droite et de la gauche radicales et rompant avec le ralliement des gaullistes au parlementarisme rationalisé opéré après le départ du général de Gaulle. Cette évolution est dangereuse. La présidence du Général De Gaulle et le recours par celui-ci au suffrage populaire pour les questions qu’il estimait essentielles pour le pays apparait de ce point de vue comme une regrettable parenthèse. En fait, ce qui est défini comme le parlementarisme rationalisé est à l’essence de la Ve République puisque la Constitution de celle-ci, approuvée par le suffrage universel le 28 septembre 1958, a bordé l’action du Parlement. D’une part, aux termes des articles 34 et 37 de la Constitution le domaine de la loi est strictement défini, les « matières autres » ayant un caractère réglementaire. D’autre part, cette Constitution offre au gouvernement des moyens constitutionnels, en premier lieu l’article 49.3, pour faire adopter des textes malgré l’absence de majorité pour les voter. En parallèle, le recours au référendum est explicitement prévu aux termes des articles 11 et 89 de la Constitution. Il est vrai que l’article 89 apporte une limite fondamentale puisque toute réforme de la Constitution proposée au référendum doit au préalable être approuvée dans les mêmes termes par les deux assemblées. Le Général De Gaulle dû regretter cette disposition puisqu’il l’enfreint lors de la réforme constitutionnelle de 1962. Il recourut à l’article 11 comme dans le cas de l’autre projet de réforme constitutionnelle de 1969. Dans ces deux circonstances, le fondateur de la Ve République paraissait opposer une légitimité populaire à une légitimité parlementaire. Pour autant, il n’y eut aucun caractère systématique dans cette opposition. Notamment, renonçant à son projet de référendum annoncé le 24 mai 1968, c’est bien par le recours à des élections législatives qu’il a résolu politiquement la crise née des évènements de mai-juin 1968.
Sans que la proposition soit détaillée, la réforme constitutionnelle envisagée par les trois élus Républicains devrait toucher l’article 89, permettant au Président de la République de soumettre directement au référendum un projet qui comporterait une modification de dispositions constitutionnelles.
Une telle option ne remet pas en cause le parlementarisme rationalisé. Elle vise sur des sujets considérés comme essentiels à recueillir l’approbation du suffrage universel. Toute autre serait l’introduction du « référendum d’initiative citoyenne ».
En fait, les auteurs expriment la plus grande méfiance à l’encontre de la souveraineté populaire, expression de la souveraineté nationale. C’est l’idée même qu’un peuple puisse par son suffrage fixé son destin qui est en cause, la mythologie juridique de la souveraineté populaire, selon leur expression à propos du référendum. L’élément fondamental de leur raisonnement est la soumission de l’action politique au contrôle du juge : … cette source (les règles en termes d’immigration) réside dans un ordre juridique fondé sur des droits universels garantis par des conventions européennes et sur le pouvoir d’interprétation et de sanction du juge. Ils ajoutent, par rapport à ces propositions des élus Républicains, qu’il s’agit d’une remise en cause de la primauté de la norme juridique européenne sur la norme nationale ; et une primauté de la décision politique sur son interprétation juridique… En précisant que : La supériorité de la norme juridique européenne sur la norme nationale est constitutive du projet européen et ne saurait être écartée au nom d’intérêts dont la définition serait laissée à la discrétion de chaque nation.
Or, s’il peut être admis que le juge censure le vote du législateur, à l’évidence, réprouver l’expression populaire manifesterait un déni de démocratie. La promotion des valeurs et, en premier lieu, la démocratie se trouverait fortement mise à mal.
En la circonstance, le sujet de l’immigration tel qu’il se présente pose le problème du devenir de la Nation au regard de l’arrivée de populations, de plus en plus nombreuses avec le temps, venues d’autres aires de civilisation ; sans compter les questions immédiates liées à la sécurité quotidienne.
Le rejet du référendum et de la souveraineté populaire
Ainsi, il ressort du propos trois éléments : des droits universels garantis ; des nations enserrées dans des règles supranationales ; in fine, le pouvoir de décision revient au juge. Comme il est souligné, La France ne peut pas plus que l’Italie (pour la politique migratoire) s’opposer à l’Union européenne. Ce qu’il manque, assurément, partant de ces observations, c’est une définition de la démocratie et de la souveraineté d’un peuple. Néanmoins, il est possible de relever dans l’article quelques indices. Ainsi, s’agissant du référendum de 2005, ils (les électeurs) se décident plutôt en fonction de leur relation à l’acteur politique qui propose le référendum que sur le contenu de la proposition – comme on l’a bien vu dans le cas du référendum sur le traité constitutionnel de l’Union Européenne en 2005. Le gouvernement par référendum signerait en réalité la mort du régime représentatif rationalisé. Outre que les raisons invoquées pour lesquelles les électeurs se prononceraient relèvent d’une simple affirmation, non d’une démonstration, il apparait que par la référence au régime représentatif rationalisé détourne ce concept de son sens. Le régime représentatif rationalisé ne saurait exclure le recours au référendum sauf à considérer que le concept supposerait des choix politiques déterminés. Les élections, dans ces conditions, ne constitueraient alors qu’un simple habillage démocratique. En effet, les élus, au-delà du vote de leurs électeurs, seraient soumis à l’injonction d’une rationalité spécifique. Celle-ci serait comprise comme « une vérité » sur l’ordonnancement du monde ni contestable, ni négociable, ni amendable à laquelle n’accéderait qu’une « élite » dirigeante.
La condamnation de l’assimilation
Parmi les items de cette « vérité » figure l’immigration et la manière dont elle doit être conçue. A cet égard, le propos tenu sur l’assimilation est éloquent quant à l’idéologie qui sous-tend la vision exprimée par les trois auteurs : À cela s’ajoute la proposition réactionnaire et dangereuse de révision de la Constitution consistant à compléter son article 3 en proclamant que « nul ne peut devenir français s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française ». Cette vieille notion, particulièrement floue, que l’on croyait abandonnée, peut être entendue de toutes les façons y compris les plus restrictives. Non seulement l’immigration est vue comme une obligation mais elle doit se concevoir dans le cadre d’une société multiculturelle, c’est-à-dire le rassemblement d’individus à un moment donné sur un territoire donné, la cohabitation par nature ne devant être qu’harmonieuse, chacun ayant pour seul devoir de respecter l’autre. Tout cela relève du mirage de la construction de l’homme nouveau dans la société nouvelle. Mais les faits sont là ; l’histoire nous l’enseigne au travers des siècles et des millénaires.
La représentation démocratique subordonnée au juge
Ce parlementarisme rationalisé tel qu’il est invoqué dans le propos, placé sous le contrôle du juge national et international, dans le contexte de la pensée dominante présente, n’est donc pas un principe de gouvernement ouvert à tous les choix politiques, il est l’outil au service d’une idéologie et le seul moyen pour l’imposer. Les peuples d’Occident se montrant rétifs à un cosmopolitisme effaçant les cultures et les traditions propres à chacun, émiettant leurs sociétés, désagrégeant leurs économies par le jeu de concurrences insoutenables, octroyant des droits à tous d’où qu’ils viennent, la solution se trouve donc dans l’instauration de sociétés purement normatives au sein desquelles le juge devient le décideur suprême. Ce système voulu par une structure dirigeante, appuyée par une classe intellectuelle et médiatique rêvant de cet univers où l’individu évoluerait au gré de son désir est en marche. Pour autant, les résistances sont fortes, en témoigne là et ailleurs la voie des urnes. Il est encore loin de son accomplissement.
L’exclusion de l’Union européenne, une menace illusoire
Quant à la relation avec l’Union européenne, l’argument d’une exclusion de la France par celle-ci pour le non-respect des règles en matière d’immigration est vain. Sans la France, pays fondateur de la Communauté Économique Européenne, seconde puissance économique de l’Union, cette dernière perdrait son sens. Compte-tenu des intérêts économiques et monétaires en jeu, de la menace qui pèserait sur les budgets européens et, dans le domaine particulier de l’immigration, des préoccupations sinon des rejets exprimés par de plus en plus de peuples européens, assurément un accord serait trouvé.
Michel Leblay (Polémia, 24 juillet 2023)

