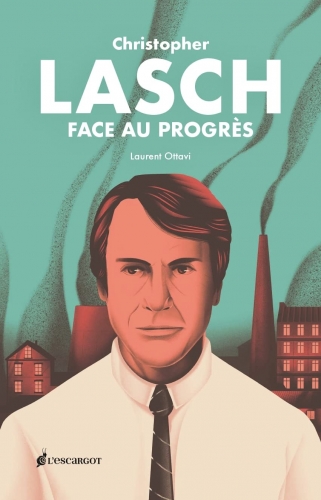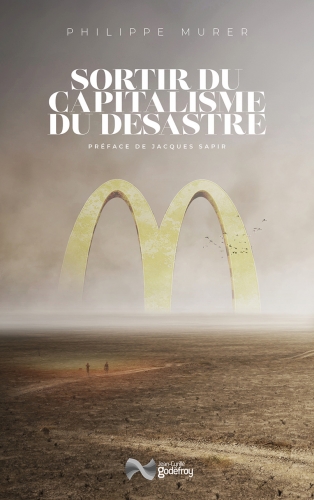Vous pouvez découvrir ci-dessous un nouveau numéro de l'émission I-Média sur TV libertés consacrée au décryptage des médias et animée par Jean-Yves Le Gallou, président de la fondation Polémia, et Lucas Chancerelle.
Au sommaire cette semaine :
L'image de la semaine : le clip de rap ultraviolent contre le RN promu par les médias.
Dossier du jour : l’alliance du système allant de l’extrême gauche à l’extrême centre pour empêcher Jordan Bardella d’être premier ministre.
‐-‐-----------
Pastilles de l’info :
1) Macron, Baffie et L'agence tous risques !
2) Débat Trump-Biden : le fiasco démocrate
3) Un journaliste de beIN Sports licencié après avoir insulté les électeurs RN ?
4) Un nouveau Crépol occulté ?
5) Hollande et la gauche caviar
‐-‐-----------
Portrait piquant (en partenariat avec l’OJIM) : Julian Assange, le courageux lanceur d’alerte qui vient d'être libéré !