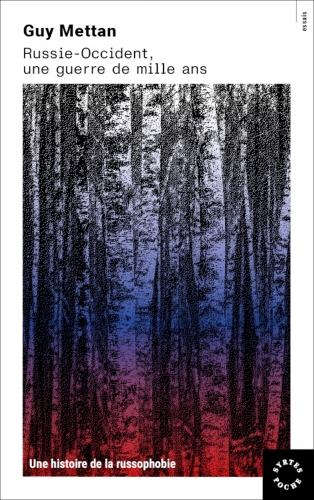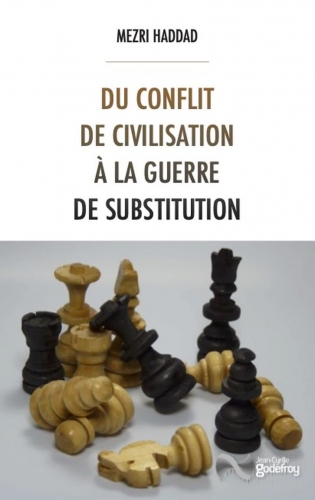En Ukraine, l’inaudible réalisme
Avec d’infinies nuances, deux politiques s’opposent grossièrement depuis 1991 au sein du bloc occidental à l’endroit de Moscou. La première consistait à voir dans la Russie post-soviétique une menace persistante, qu’il fallait continuer d’endiguer et de contenir, et ce dès la fin de la Guerre froide. Non pas qu’elle constituait alors un péril, mais parce qu’il fallait anticiper le retour, dans un avenir proche, d’une puissance toujours tentée par la forme impériale, par le primat de la force sur le droit, par un révisionnisme mâtiné d’idéologie et par une jalousie séculaire vis-à-vis de son Ouest. Cette politique a globalement été celle de l’Alliance atlantique, des Etats-Unis et des pays d’Europe de l’Est, trop heureux de s’être séparés du communisme et de la tentation envahissante historique de la Russie. A grands traits, l’on pourrait résumer cette première position par la formule latine : «si vis pacem para bellum». Un exemple jusqu’au-boutiste de cette logique est l’appel de Lech Walesa, l’ancien président polonais, à «ramener la Russie à moins de cinquante millions d’habitants» (contre 144 aujourd’hui) en la «décolonisant». «Même si l’Ukraine va gagner cette guerre, dans cinq ans nous allons avoir la même chose, dans dix ans on verra un autre Poutine surgir», a asséné le fondateur du mouvement Solidarnosc.
La seconde, qui a longtemps été dominante en France et qui a également existé sous une forme plus géoéconomique outre-Rhin, plaidait pour un rapprochement progressif avec la Russie, par russophilie parfois, par anti-américanisme souvent, mais plus fondamentalement pour éviter le piège circulaire de la violence qui engendre la violence ad libitum. Il ne s’agissait pas de rejeter en bloc la formule «si vis pacem para bellum», mais de faire assaut de prudence car, à trop préparer la guerre, celle-ci éclate nécessairement, par un terrible jeu de miroirs qui fait que chacun voit luire dans le regard de l’autre l’éclat guerrier redouté. En un sens, si tu veux la paix, il faut certes préparer la guerre, mais il faut aussi, en parallèle, préparer bel et bien la paix elle-même, et ce pour couper court à toute prophétie de malheur autoréalisatrice.
Mort-née, l’initiative de la «confédération européenne» proposée par François Mitterrand dès 1988 et qui devait, en réponse au projet de «maison commune» de Gorbatchev, s’étendre à l’URSS incluse, fut l’incarnation la plus pure de cet esprit qui revenait, d’une autre manière, à contenir la violence, mais sans endiguer la Russie elle-même. Cette position, dont les tenants se qualifient de «réalistes» et qui s’inspirent de la théorie des relations internationales du même nom, est toujours défendue mordicus par de grands noms de l’histoire politique française récente comme Jean-Pierre Chevènement, Hubert Védrine ou Dominique de Villepin. Leur idée n’est pas d’absoudre la Russie qui a envahi un pays, mais de se demander si le bloc de l’ouest, en maintenant une logique de Guerre froide à l’issue de celle-ci, n’a pas co-construit ce que, précisément, elle voulait éviter, et qui s’étend désormais sous nos yeux. «Le Poutine de 2022 est largement le résultat, tel un monstre à la Frankenstein, des errements, de la désinvolture et des erreurs occidentales», résumait ainsi Hubert Védrine dans Le Figaro.
C’est aussi le discours d’un autre diplomate français, Maurice Gourdault-Montagne, conseiller diplomatique de Jacques Chirac, qui rappelle dans ses mémoires, publiées en novembre 2022, cet autre projet français avorté : «Nous fîmes, à l’initiative du président Chirac, une tentative, vite mort-née, pour proposer une solution concernant la sécurité de l’Ukraine. Chirac m’envoya en novembre 2006 […] tester auprès des Russes la proposition suivante : ‘Pourquoi ne pas donner à l’Ukraine une protection croisée assurée par l’Otan et la Russie ? Le Conseil Otan-Russie en assurerait la surveillance’». Mais voilà, une telle proposition ne pouvait trouver grâce aux Etats-Unis, qui ont torpillé l’initiative, raconte l’ancien secrétaire général du Quai.
Depuis le 24 février, ce discours réaliste, régulièrement qualifié d’esprit de Munich, apparaît comme largement inaudible. Il l’est d’autant plus depuis trois mois que ce sont désormais les Ukrainiens qui sont à la manœuvre militaire et que la Russie s’empêtre face à un adversaire dont elle a sous-estimé la force. Dès le mois d’avril, l’armée russe a dû se replier de la région de Kiev, face à l’impossibilité de prendre ou même d’assiéger la capitale ukrainienne. Puis, en septembre, les Ukrainiens ont repoussé de la région de Kharkiv – deuxième ville du pays – les Russes, qui n’ont certes guère résisté, mais qui ont bien été obligé, là encore, de plier bagage face à la contre-attaque. Et une troisième fois, en novembre, les Russes ont dû se replier sur la rive gauche du Dniepr après avoir abandonné Kherson, perdant au passage tout espoir de transformer leur tête de pont de l’autre côté du grand fleuve ukrainien. En procédant à une mobilisation partielle de 300.000 hommes, les Russes vont peut-être réussir à conserver le reste de leurs gains territoriaux et même à grappiller quelques territoires dans l’oblast de Donetsk autour de Bakhmut, mais même cela n’est pas sûr. Les Ukrainiens pourraient tenter une nouvelle poussée dans l’oblast de Lougansk, voire lancer une contre-offensive dans la région de Zaporijjia ou le sud du Donetsk. En pareil cas, la Crimée pourrait être derechef coupée du reste du territoire russe, ce corridor terrestre le long des rives de la mer d’Azov étant le principal – voire le seul – gain stratégique russe réalisé depuis le 24 février. En Russie, l’on commence déjà à évoquer l’hypothèse du lancement, d’ici quelques mois, d’une nouvelle vague de mobilisation.
Ceux qui voulaient à tout prix préparer la guerre face à la Russie triomphent. Non seulement ils ont eu raison sur la menace que représentait Vladimir Poutine, mais, en plus, contre tous les sceptiques, l’Ukraine parvient à renverser la vapeur. Et eux, à l’adresse des réalistes, de reprendre en cœur les mots que Winston Churchill n’a en réalité jamais lancés à Neville Chamberlain, premier ministre, après la signature des accords de Munich en 1938 : «Le gouvernement avait le choix entre la guerre et le déshonneur ; il a choisi le déshonneur et il aura la guerre». En apparence, le réel semble en effet leur donner raison.
Et, pourtant, aussi difficilement entendable que cela puisse paraître, la logique des réalistes n’a pas été prise en défaut par la guerre en Ukraine, bien au contraire, mais si elle laisse apparaître des faiblesses intrinsèques. La première considération est la suivante : le réel donnerait aujourd’hui raison à ceux qui prophétisaient que la Russie était une menace. D’un point de vue logique, cet auto-satisfecit de ceux qui criaient au loup ne tient pas. Car le discours que l’on tient sur l’avenir a un impact causal sur l’avenir lui-même : la Russie aurait-elle envahi l’Ukraine en 2022 si la solution mise en avant par Maurice Gourdault-Montagne en 2006, celle de garanties de sécurité otano-russes croisées, avait été suivie, s’il avait été clairement décidé que l’Ukraine n’intégrerait pas l’Alliance atlantique, plus largement si une autre politique, plus proche de celle défendue par François Mitterrand, avait été mise en œuvre dès 1991 ? En toute logique, rien ne permet de l’affirmer. Quand Lech Walesa appelle à réduire la Russie à moins de cinquante millions d’habitants pour se prémunir d’un conflit à venir dans cinq, dix ou quinze ans, ne le prépare-t-il pas en disant cela ? Le drame est que nous n’aurons jamais le contre-factuel : il n’est pas possible de réécrire l’histoire et de savoir ce qui aurait été si ces erreurs occidentales n’avaient pas été commises. Et c’est en même temps la grande faiblesse du discours des réalistes aujourd’hui : les faits semblent les condamner, et ils ne peuvent se raccrocher qu’à des «et si…» dont l’empreinte existentielle est par nature bien légère face au réel.
Cette première faiblesse est d’ordre épistémique. Mais il en est une seconde, d’ordre pratique. Les réalistes voulaient éviter la guerre en faisant en sorte que les conditions qui la produiraient ne soient pas réunies. C’était vertueux… mais, une fois que celles-ci le sont et que celle-là a éclaté, que faire ? Le prophète de malheur – le vrai, celui qui annonce une catastrophe à venir de telle sorte qu’elle ne se produise pas, en évitant le piège de la prophétie auto-réalisatrice – est utile tant que la catastrophe n’a pas eu lieu. Il fallait ainsi éviter la guerre en adoptant collectivement une attitude qui n’augmente pas les risques de son déclenchement. Mais une fois qu’elle est là face à nous ? Les faits ont donné raison au prophète de malheur, et c’est bien là son problème : par là même, il a échoué dans son office.
Reste que la guerre n’est pas terminée, loin de là. Ceux qui croient que les forces de Kiev auront repris militairement le Donbass et la Crimée dans quelques mois pèchent probablement par zèle ukrainien, et ceux qui s’attendent à une grande offensive de Moscou par zèle russe. L’on ne peut bien sûr exclure une victoire militaire décisive d’un côté ou de l’autre, mais, à en écouter même les Américains, cette hypothèse paraît aujourd’hui la moins probable. L’issue, bien sûr dépendante du rapport de force militaire sur le terrain, sera donc politique. Et la même question se posera comme après chaque guerre : cette issue politique préparera-t-elle les guerres de demain ? Ou une sortie par le haut sera-t-elle possible ? Dans un cas, un mur s’érigera quelque part dans l’est de l’Ukraine, solide un temps, mais constituera le ferment de conflits futurs. Dans l’autre, peut-être finira-t-on par remettre sur le tapis, sous une forme renouvelée, l’idée française de « garanties de sécurité croisées » enterrée en 2006. Elle finirait par aboutir, mais au prix d’une guerre qui aura fait des centaines de milliers de morts. Qui a donc dit que les réalistes avaient eu tort ?
Alexis Feertchak (Geopragma, 5 décembre 2022)