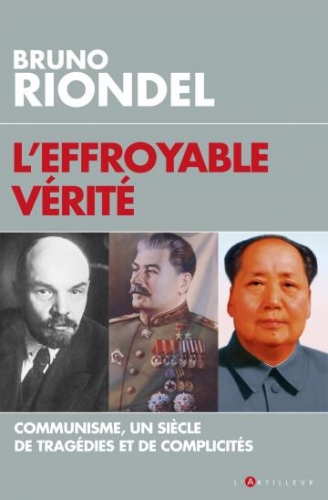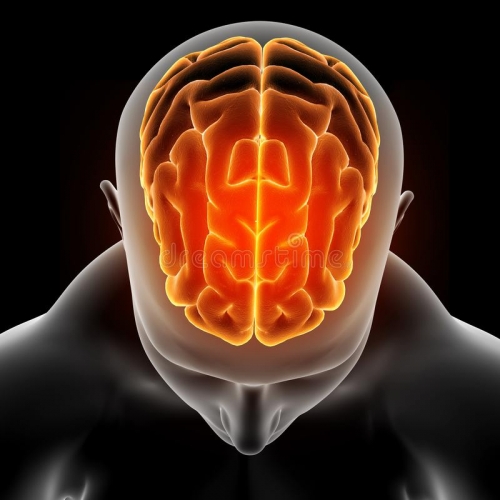Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Michel Maffesoli, cueilli sur Figaro vox et consacré à l'ébranlement que provoque dans notre société la pandémie de coronavirus. Penseur de la post-modernité, Michel Maffesoli a publié récemment Les nouveaux bien-pensants (Editions du Moment, 2014) , Être postmoderne (Cerf, 2018), La force de l'imaginaire - Contre les bien-pensants (Liber, 2019) ou, dernièrement, La faillite des élites (Lexio, 2019).

Michel Maffesoli: «La crise du Coronavirus ou le grand retour du tragique»
Sans craindre les foudres d’une intelligentsia apeurée, on ne dira jamais assez que nous assistons à la décadence inéluctable de la modernité. Fin d’un monde se manifestant, au quotidien, dans une dégénérescence intellectuelle, politique, sociale dont les symptômes sont de plus en plus évidents.
Dégénérescence de quoi, sinon du mythe progressiste? Corrélativement à l’idéologie du service public, ce progressisme s’employait à justifier la domination sur la nature, à négliger les lois primordiales de celle-ci et à construire une société selon les seuls principes d’un rationalisme abstrait dont l’aspect morbide apparaît de plus en plus évident. Les réformes dites «sociétales» (mariage pour tous, PMA-GPA, etc.) en étant les formes caricaturales.
Le point nodal de l’idéologie progressiste, c’est l’ambition voire la prétention de tout résoudre, de tout améliorer afin d’aboutir à une société parfaite et à un homme potentiellement immortel.
Qu’on le sache ou non, la dialectique: thèse, antithèse, synthèse est le mécanisme intellectuel dominant. Le concept hégélien de «dépassement» (Aufhebung), est le maître mot de la mythologie progressiste. C’est stricto sensu, une conception du monde «dramatique», c’est-à-dire reposant sur la capacité à trouver une solution, une résolution permettant d’accéder à la perfection à venir.
Il est une formule de K. Marx qui résume bien une telle mythologie: «L’humanité ne se pose jamais que les problèmes qu’elle peut résoudre.» Ambition, prétention de tout maîtriser. Et que l’on veuille ou non le reconnaître, il existe, gauche et droite confondues, une véritable «marxisation» des esprits. L’élite moderne: politiques, journalistes et divers experts, est contaminée par cette prétention quelque peu paranoïaque. Dans un avenir, plus ou moins proche, l’on arrivera à réaliser une société parfaite!
C’est bien cette conception dramatique, donc optimiste qui est en train de s’achever. Et, dans le balancement inexorable des histoires humaines, c’est le sentiment du tragique de la vie qui, à nouveau, tend à prévaloir. Le dramatique, je l’ai dit, est résolument optimiste. Le tragique est aporique, c’est-à-dire sans solution. La vie est ce qu’elle est.
Plutôt que de vouloir dominer la nature, on s’accorde à elle. Selon l’adage populaire, «on ne commande bien la nature qu’en lui obéissant.» La mort, dès lors, n’est plus ce que l’on pourra dépasser. Mais ce avec quoi il convient de s’accorder.
Voilà ce que rappelle, en majeur, la «crise sanitaire». La mort pandémique est le symbole de la fin de l’optimisme propre au progressisme moderne. On peut le considérer comme une expression du pressentiment, quelque peu spirituel, que la fin d’une civilisation peut être une délivrance et, en son sens fort, l’indice d’une renaissance. Indice, «index», ce qui pointe la continuité d’un vitalisme essentiel!
La mort possible, menace vécue quotidiennement, réalité que l’on ne peut pas nier, que l’on ne peut plus dénier, la mort qu’inexorablement l’on est obligé de comptabiliser, cette mort, omniprésente, rappelle dans sa concrétude que c’est un ordre des choses qui est en train de s’achever.
Ce qui est concret, je le rappelle: cum crescere, c’est ce qui «croît avec», avec un réel irréfragable. Et ce réel c’est la mort de cet «ordre des choses» ayant constitué le monde moderne!
Mort de l’économicisme dominant, de cette prévalence de l’infrastructure économique cause et effet d’un matérialisme à courte vue.
Mort d’une conception purement individualiste de l’existence. Certes, les élites déphasées continuent à émettre des poncifs du type «compte tenu de l’individualisme contemporain», et autres sornettes de la même eau. Mais l’angoisse de la finitude, finitude dont on ne peut plus cacher la réalité, incite, tout au contraire, à rechercher l’entraide, le partage, l’échange, le bénévolat et autres valeurs du même acabit que le matérialisme moderne avait cru dépasser.
Encore plus flagrant, la crise sanitaire signe la mort de la mondialisation, valeur dominante d’une élite obnubilée par un marché sans limites, sans frontières où, là encore, l’objet prévaut sur le sujet, le matériel sur le spirituel.
Souvenons-nous de la judicieuse expression du philosophe Georg Simmel, rappelant que le bon équilibre de toute vie sociale est l’accord devant exister entre le «pont et la porte». Le pont nécessaire à la relation, et la porte relativisant cette relation afin d’accéder à une harmonie bénéfique pour tout un chacun.
C’est ce que j’ai appelé «Écosophie», sagesse de la maison commune. En termes plus familiers, il s’agit de reconnaître que «le lieu fait lien». Toutes choses rappelant qu’à l’encontre du leitmotiv marxiste: «l’air de la ville rend libre», formule archétypale du déracinement, la glèbe natale retrouve une force et vigueur indéniables.
Enracinement dynamique rappelant que, comme toute plante, la plante humaine a besoin de racines pour pouvoir croître, avec force, justesse et beauté! Ainsi face à la mort on ne peut plus présente, est rappelée la nécessité de la solidarité propre à un «idéal communautaire» que certains continuent à stigmatiser en le taxant, sottement, de communautarisme.
La mort de la civilisation utilitariste où le lien social est à dominante mécanique, permet de repérer la réémergence d’une solidarité organique. Organicité que la pensée ésotérique nomme «synarchie». Ce qu’avait également bien analysé Georges Dumézil en rappelant l’interaction et l’équilibre existant, à certains moments, entre les «trois fonctions sociales».
La fonction spirituelle, fondant le politique, le militaire, le juridique et aboutissant à la solidarité sociétale. Ainsi, au-delà d’une suradministration déconnectée du Réel, c’est bien un tel holisme que l’on voit resurgir de nos jours.
Mais la prise en compte d’une telle synarchie organique nécessite que l’on sache le dire avec les mots étant le plus en pertinence avec le temps. Il est amusant, il vaudrait mieux dire désolant, de lire sous la plume de la plupart des observateurs sociaux que la situation est dramatique et quelques lignes plus loin parler de son aspect tragique. Ce qui montre bien que la formule de Platon est toujours d’actualité: «la perversion de la cité commence par la fraude des mots!»
La conception «dramatique» est le propre d’une élite croyant trouver à tout une solution opportune. Le «tragique», bien au contraire, s’accorde à la mort. Il sait, d’un savoir incorporé, savoir propre à la sagesse populaire, vivre la mort de tous les jours.
Voilà en quoi la crise sanitaire porteuse de mort individuelle est l’indice d’une crise civilisationnelle, celle de la mort d’un paradigme progressiste ayant fait son temps. Peut-être est-ce cela qui fait que le tragique ambiant, vécu au quotidien, est loin d’être morose, conscient qu’il est d’une résurrection en cours. Celle où dans l’être-ensemble, dans l’être- avec, dans le visible social, l’invisible spirituel occupera une place de choix.
Michel Maffesoli (Figaro Vox, 23 mars 2020)