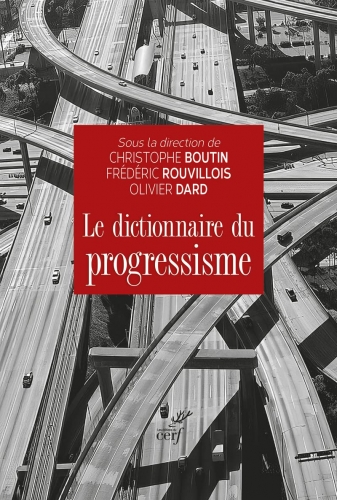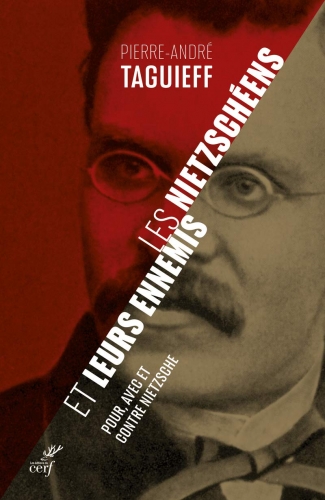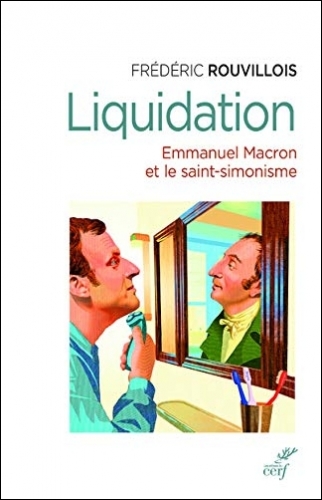Les éditions du Cerf viennent de publier un essai de Pierre-André Taguieff intitulé Les nietzschéens et leurs ennemis - Pour, avec et contre Nietzsche.
Philosophe, politologue et historien des idées, Pierre-André Taguieff est l’auteur d'essais importants qui ont contribué à mettre à mal la pensée unique comme La Force du préjugé - Essai sur le racisme et ses doubles (La découverte, 1988), Résister au bougisme (Mille et une Nuits, 2001), Les Contre-réactionnaires : le progressisme entre illusion et imposture (Denoël, 2007), Julien Freund, au cœur du politique (La Table ronde, 2008) ou Du diable en politique - Réflexions sur l'antilepénisme ordinaire (CNRS, 2014). On retrouvera ici l'auteur qui avait signé voilà trente ans une contribution dans l'ouvrage collectif Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens (Grasset, 1991).
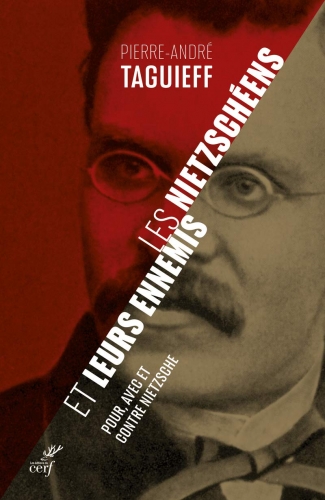
"La pensée du philosophe, le style du pamphlétaire : c'est à la manière de Nietzsche que Taguieff dénonce ses héritiers de droite et de gauche, modernes et postmodernes, totalitaires ou libertaires. Un festival de lucidité, une relecture de 150 ans de fictions qui se sont voulues des rêves et qui ont tourné au cauchemar.
Nietzsche aura été le philosophe du siècle. Parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. Retournant contre le prophète de Dionysos le marteau philosophique que lui-même employait pour ébranler les idoles, Pierre-André Taguieff livre avec acuité, verve et élégance une relecture inédite, iconoclaste et critique de l'histoire de la pensée contemporaine, de ses incohérences et de ses abîmes. Il explore le vaste continent des écrits nietzschéens et antinietzschéens qui continuent d'inspirer et de diviser les philosophes, les écrivains et les artistes, notamment face à la question de la décadence et à celle du nihilisme.
Comment comprendre la fascination récurrente exercée par Nietzsche et sa pensée ? Qu'ont en commun les nietzschéens de droite et les nietzschéens de gauche ? Pourquoi puisent-ils au même fond de métaphores, de paraboles, d'images survoltées pour les surinterpréter ? Comment comprendre cette bataille d'appropriations qui semblent contradictoires mais qui se rejoignent souvent dans le même culte de la force et de la destruction ?
Cet essai est déterminant pour lever nos cécités sur le plus enthousiasmant et le plus aveuglant des philosophes. Un exercice de lucidité qui marque un tournant dans la pensée française et européenne."