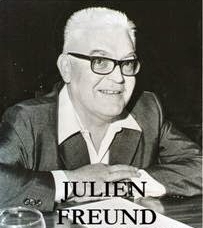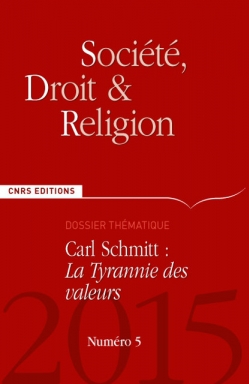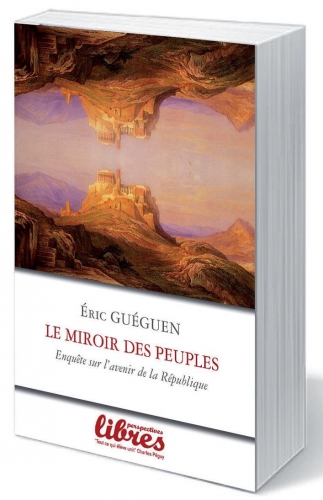Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Olivier Rey au Figaro Vox. Mathématicien et philosophe, chercheur au CNRS et enseignant en faculté, Olivier Rey est l'auteur de deux essais importants intitulés pour l'un Une folle solitude - Le fantasme de l'homme auto-construit (Seuil, 2006) et pour l'autre Une question de taille (Stock, 2014), et consacrés à la question du progrès et de la technique dans nos sociétés.

Entretien avec Olivier Rey
FIGAROVOX. - Quand Élisabeth Guigou défendait le PACS, elle jurait que celui-ci n'ouvrirait pas la voie au mariage et à l'adoption des couples homosexuels. Or, récemment, la ministre de la Famille a décidé d'abroger une circulaire qui interdisait aux gynécologues de conseiller à leurs patientes une insémination à l'étranger. Pensez-vous que le mariage pour tous engendrera mécaniquement la PMA et la GPA?
Olivier REY. - Concernant Élisabeth Guigou, il est difficile de savoir à quoi s'en tenir: elle a dit qu'elle était sincère au moment du PACS, avant d'évoluer en faveur du mariage. D'autres déclarations de sa part laissent cependant entendre que sa position en 1999 était essentiellement tactique. Les mêmes incertitudes se retrouvent aujourd'hui envers ceux qui ont affirmé que la loi Taubira n'impliquait rien concernant la PMA «pour toutes» ou la GPA. Ce qui est certain, c'est que les plus ardents promoteurs de cette loi visaient, à travers elle, un changement du droit de la famille et de la filiation. De ce point de vue, la Manif pour tous a eu un effet: par son ampleur elle a empêché, au moins provisoirement, la mise à feu du deuxième étage de la fusée.
Pour l'heure, la démarche pour contourner les obstacles consiste à pratiquer le law shopping, c'est-à-dire à se rendre dans certains pays qui permettent ce qui est interdit ici, puis à réclamer de retour en France une régularisation de la situation. Si le phénomène prend de l'importance, on accusera le droit français d'hypocrisie, et on le sommera d'autoriser ce que de toute façon il entérine après coup. On pourra même invoquer le principe d'égalité, en dénonçant un «droit à l'enfant» à deux vitesses, entre ceux qui ont les moyens de recourir au «tourisme procréatif» et les autres.
La plupart des acteurs politiques qui souhaitaient revenir sur le mariage pour tous ont fait machine arrière. Diriez-vous que les lois sociétales sont irréversibles?
Cela dépend de l'échelle de temps à laquelle on se place. À court terme, le mouvement semble irréversible. À plus long terme, il est difficile de se prononcer. Depuis plusieurs décennies, nous surchargeons l'édifice social et juridique de tourelles postmodernes par ci, d'encorbellements rococos par là, sans nous préoccuper des murs porteurs qui n'ont pas été prévus pour ce genre de superstructures, et qui donnent d'inquiétant signes de faiblesse. Si les murs finissent par s'ébouler, toutes ces «avancées» dont on s'enchante aujourd'hui s'écrouleront.
Nous sommes entrés dans une période de grandes turbulences, dont nous ne vivons pour l'instant que les prodromes. Nous aurons à faire face au cours de ce siècle à de gigantesques difficultés - écologiques, économiques, migratoires. Le «jour du dépassement», c'est-à-dire le jour où les ressources renouvelables de la terre pour l'année en cours ont été consommées, arrive toujours plus tôt - en 2016, dans la première quinzaine d'août. Autrement dit, notre richesse actuelle est fictive, elle est celle d'un surendetté avant la banqueroute. Lorsque les diversions ne seront plus possibles, nous nous rappellerons avec incrédulité que dans les années 2010, la grande urgence était le mariage pour tous. Cela paraîtra emblématique de l'irresponsabilité de ce temps. En fait, la polarisation sur les questions «sociétales» est une façon de fuir la réalité: se battre pour la PMA pour toutes ou la GPA, c'est aussi éviter de penser à ce à quoi nous avons à faire face.
N'est-on pas aujourd'hui dans une extension infinie des «droits à» comme le «droit à l'enfant»? Cela ne risque-t-il pas d'enfreindre des libertés fondamentales comme les «droits de l'enfant»?
Le discours des droits est devenu fou. Historiquement, l'élaboration de la notion de droits de l'homme est liée au développement des doctrines de contrat social, selon lesquelles, dans un «état de nature», les humains vivaient isolés, avant que les uns et les autres ne passent contrat pour former une société. Dans l'opération, les individus ont beaucoup à gagner: tout ce que l'union des forces et des talents permet. Ils ont aussi à perdre: ils doivent abdiquer une partie de leur liberté pour se plier aux règles communes. Qu'est-ce que les droits de l'homme? Les garanties que prennent les individus vis-à-vis de la société pour être assurés de ne pas trop perdre de cette liberté. Garanties d'autant plus nécessaires que les pouvoirs anciens, aussi impérieux fussent-ils, étaient plus ou moins tenus de respecter les principes religieux ou traditionnels dont ils tiraient leur légitimité. À partir du moment où l'ordre social se trouve délié de tels principes, il n'y a potentiellement plus de limites à l'exercice du pouvoir: à moins, précisément, qu'un certain nombre de droits fondamentaux soient réputés inaliénables. Comme l'a dit Bergson, chaque phrase de la Déclaration des droits de l'homme est là pour prévenir un abus de pouvoir.
Depuis, la situation a connu un retournement spectaculaire. Les droits de l'homme, de cadre institutionnel et de sauvegarde des libertés individuelles face à d'éventuels empiètements de l'État, sont devenus sources d'une multitude de revendications adressées par les citoyens à la puissance publique, mise en demeure de les satisfaire. La Déclaration d'indépendance américaine cite trois droits fondamentaux: le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à poursuivre le bonheur. Mais aujourd'hui, ce dernier droit est compris par certains comme droit au bonheur. Dès lors, si quelqu'un, par exemple, estime indispensable à son bonheur d'avoir un enfant, alors avoir un enfant devient à son tour un droit, et tout doit être mis en œuvre pour y répondre.
Au point où nous en sommes, la seule limite à laquelle se heurte l'inflation des droits tient aux conflits que leur multiplication entraîne. Par exemple: l'antagonisme entre le droit à l'enfant et les droits de l'enfant. C'est ainsi qu'au Royaume-Uni, il n'y a plus d'anonymat du donneur masculin pour les PMA, parce que les moyens mis en œuvre pour l'exercice du droit à l'enfant doivent respecter le droit de l'enfant à connaître ses origines. C'est la bataille des droits.
Comment définir la limite entre le droit de poursuivre le bonheur et celui de l'avoir, entre les actions individuelles et l'intervention de la société et de l'État?
Prenons l'exemple du droit qu'il y aurait, pour une femme seule ou pour deux femmes, d'aller à l'hôpital pour concevoir par PMA. Il ne s'agit pas d'obtenir de l'État la levée d'un interdit (la loi n'interdit à personne d'avoir un enfant), mais d'exiger de lui qu'il fournisse gratuitement à toute femme qui en fera la demande une semence masculine, qu'il se sera préalablement chargé de collecter en vérifiant sa qualité, et dont il aura effacé la provenance. Pourquoi fournirait-il un tel service? Pourquoi se substituerait-il à l'homme manquant? Pour des raisons médicales - comme le M de PMA le laisse entendre? Mais où est l'infirmité à pallier, la maladie à soigner?
Ce mésusage du mot «médical» va de pair avec les emballements qu'on observe dans le discours des droits. Dans le préambule à sa Constitution, adoptée en 1946, l'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme «un état de complet bien-être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité». Comme de plus «la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain», on voit qu'une infinité de droits peuvent se réclamer d'un droit à la santé ainsi compris. En particulier, un droit à tout type d'«augmentation» et de procréation, dès lors que quiconque estime cette augmentation ou ce type de procréation nécessaires à son bien-être.
À propos de la procréation techniquement assistée, il faut aussi tenir compte d'un fait: cette intervention technique autorise les diagnostics pré-implantatoires et rend envisageable la sélection d'un nombre croissant de caractères, qu'on voit mal certaines cliniques privées, dans des États accueillants, se priver de proposer. Dès lors, ceux qui conçoivent des enfants à l'ancienne pourront se sentir désavantagés par rapport à ceux qui recourent à ces procédés, et seront tentés eux-mêmes de les adopter. On voit le paradoxe: la modernité était habitée par un idéal de liberté de la personne. Mais la liberté devient un leurre quand chaque fonction vitale suppose, pour être remplie, l'allégeance à un système économico-technique hégémonique. C'est au tour de la procréation, demeurée scandaleusement sexuelle et artisanale jusqu'à aujourd'hui, d'être prise dans le mouvement.
Il est possible d'acheter des enfants sur catalogue dans certains États en choisissant leurs prédispositions génétiques, comme la couleur de leurs yeux. En matière de progrès technique et sociétal, diriez-vous comme Einstein qu'il y a «profusion des moyens et confusion des fins»?
Je pense à une chanson des Sex Pistols, ce groupe de punk anglais des années 1970. Dans Anarchy in the UK, le chanteur Johnny Rotten hurlait: «I don't know what I want, but I know how to get it» («Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais comment l'obtenir»). Ça me semble emblématique de notre époque. Nous ne cessons de multiplier et de perfectionner les moyens mais, en cours de route, nous perdons de vue les fins qui mériteraient d'être poursuivies. Comme le dit le pape dans sa dernière encyclique, «nous possédons trop de moyens pour des fins limitées et rachitiques».
Cette absorption des fins dans le déploiement des moyens des fins est favorisée par l'esprit technicien, qui cherche à perfectionner les dispositifs pour eux-mêmes, quels que soient leurs usages, une division du travail poussée à l'extrême, qui permet d'augmenter la productivité, et le règne de l'argent, qui fournit un équivalent universel et permet de tout échanger. Plus le travail est divisé, plus le lien entre ce travail et la satisfaction des besoins de la personne qui l'accomplit se distend. On ne travaille plus tant pour se nourrir, se loger, élever ses enfants etc. que pour gagner de l'argent. Cet argent permet certes ensuite d'obtenir nourriture, logement etc., mais, en lui-même, il est sans finalité spécifiée. C'est pourquoi, au fur et à mesure que la place de l'argent s'accroît, on désapprend à réfléchir sur les fins: «Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais comment l'obtenir» - par de l'argent.
Il ne s'agit pas de critiquer la technique, la division du travail ou l'argent en tant que tels, mais de se rendre compte qu'il existe des seuils, au-delà desquels les moyens qui servaient l'épanouissement et la fructification des êtres humains se mettent à leur nuire, en rétrécissant l'horizon qu'ils étaient censés agrandir.
Le langage commun dit «on n'arrête pas le progrès». Est-ce vrai?
Ce que désigne ici le mot progrès est le développement technique. Dans un régime capitaliste et libéral, orienté vers le profit, l'appât du gain ne cesse de stimuler ce développement, qu'on appelle désormais «innovation». Réciproquement, toute technique susceptible de rapporter de l'argent sera mise en œuvre.
On pourrait penser que les comités d'éthique contrecarrent le mouvement. Tel n'est pas le cas. Jacques Testart (biologiste ayant permis la naissance du premier «bébé éprouvette» en France, en 1982, et devenu depuis «critique de science», ndlr) considère que «la fonction de l'éthique institutionnelle est d'habituer les gens aux développements technologiques pour les amener à désirer bientôt ce dont ils ont peur aujourd'hui». Ces comités sont là pour persuader l'opinion que les «responsables» se soucient d'éthique, et ainsi désarmer ses préventions. Quand une nouvelle technique transgressive se présente, le comité s'y oppose mais, en contrepartie, avalise d'autres techniques un tout petit peu moins nouvelles ou un tout petit peu moins transgressives. Finalement, les comités d'éthique n'arrêtent pratiquement rien, ils se contentent de mettre un peu de viscosité dans les rouages. Ils ont un rôle de temporisation et d'acclimatation.
Dans le domaine environnemental, il y a aujourd'hui une certaine prise de conscience. Pourquoi cette prise de conscience dans le domaine écologique n'est-elle pas étendue au domaine sociétal?
Le lien entre la destruction des milieux naturels et certaines actions humaines est flagrant, ou à tout le moins facile à établir. En ce qui concerne la vie sociale, beaucoup s'accorderont à penser que la situation se dégrade, mais les causes de cette dégradation sont multiples et les démêler les unes des autres est une entreprise ardue. Les initiatives «sociétales» jouent certainement un rôle, mais compliqué à évaluer, d'autant plus que leurs conséquences peuvent s'amplifier au fil des générations et, de ce fait, demander du temps pour se manifester pleinement. Dans ces conditions, il est difficile de prouver les effets néfastes d'une loi et, y parviendrait-on, difficile également de faire machine arrière alors que les mœurs ont changé.
En matière d'environnement, la France a inscrit dans sa constitution un principe de précaution: lorsqu'un dommage, quoique incertain dans l'état des connaissances, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités doivent évaluer les risques et prendre des mesures pour prévenir ce dommage. Ce principe, sitôt adopté, a été détourné de son sens: on l'invoque à tort et à travers pour de simples mesures de prudence - ce qui permet de ne pas l'appliquer là où il devrait l'être. (On parle du principe de précaution pour recommander l'installation d'une alarme sur les piscines privées, mais on oublie son existence au moment de légiférer sur les pesticides ou les perturbateurs endocriniens qui dérèglent et stérilisent la nature.) L'expression «principe de précaution» mériterait de voir son usage restreint aux cas qui le méritent vraiment. En même temps, cet usage devrait être étendu aux mesures «sociétales», dont les effets sur le milieu humain peuvent être graves et irréversibles. La charge de la preuve doit incomber à ceux qui veulent le changement, non à ceux qui s'en inquiètent.
On parle de plus en plus souvent du clivage entre le «peuple» et les «élites». Qui est à l'origine des lois sociétales? Est-ce la société dans son ensemble, le droit ne faisant que s'adapter, ou sont-ce au contraire les «élites» qui tentent de changer celle-ci par le truchement du droit?
Je suis réservé à l'égard des partages binaires de l'humanité. Par ailleurs, il me semble que le problème central aujourd'hui tient moins à l'existence d'élites qu'au fait que les prétendues élites n'en sont pas. Je veux dire que certaines personnes occupent des places en vue ou privilégiées. Mais il suffit de les écouter parler ou d'observer leur comportement pour comprendre qu'elles constituent peut-être une caste, mais certainement pas une élite! Le risque aussi, à opposer frontalement «peuple» et «élites», est d'exonérer trop vite le peuple de maux auquel il collabore. Par exemple, les électeurs s'indignent à juste titre que ceux qu'ils élisent trahissent leurs promesses. Mais quelqu'un qui serait à la fois sensé et sincère serait-il élu?
La vérité est que nous sommes tous engagés dans un gigantesque processus de planétarisation (je préfère ce terme à celui de mondialisation, car ce vers quoi nous allons n'a aucune des qualités d'ordre et d'harmonie que les Romains reconnaissait au mundus, traduction latine du grec cosmos). S'il y avait un partage pertinent de la population à opérer, ce serait peut-être celui-ci: d'un côté les ravis de la planétarisation - en partie pour le bénéfice qu'ils en tirent à court terme, en partie par aveuglement ; de l'autre les détracteurs de la planétarisation - en partie parce qu'ils en font les frais, en partie parce qu'ils voudraient que la possibilité de mener une vie authentiquement humaine sur cette terre soit sauvegardée.
Il est indéniable que ce qu'on appelle aujourd'hui l'élite compte presque exclusivement des ravis de la planétarisation. Cela étant, ces soi-disant dirigeants dirigent très peu: leur rôle est d'accompagner le mouvement, de le favoriser, d'y adapter la société. C'est le sens, par exemple, du «En Marche!» d'Emmanuel Macron. En marche vers quoi? Peu importe, l'important est d'«aller de l'avant», même si cela suppose d'accentuer encore les ravages. Les lois sociétales participent de ce «marchisme». Par exemple, la famille à l'ancienne est un des derniers lieux de résistance au mouvement de contractualisation généralisée. Tout ce qui peut la démantibuler est donc bon à prendre, «va dans le bon sens».
D'où est venu ce processus? Pourrait-il s'arrêter un jour?
On décrit souvent la modernité comme un passage de l'hétéronomie - les hommes se placent sous l'autorité de la religion et de la tradition -, à l'autonomie - les hommes se reconnaissent au présent comme les seuls maîtres à bord. Un espace infini semble alors s'ouvrir aux initiatives humaines, tant collectives qu'individuelles. Mais libérer l'individu de ses anciennes tutelles, cela signifie libérer tous les individus, et l'amalgame de cette multitude de libertés compose un monde dont personne ne contrôle l'évolution, et qui s'impose à chacun. Comme le dit l'homme du souterrain de Dostoïevski, dans une formule géniale: «Moi, je suis seul, et eux, ils sont tous». L'individu est libre mais, à son échelle, complètement démuni face au devenir du monde. Le tragique est que c'est précisément la liberté de tous qui contribue, dans une certaine mesure, à l'impuissance de chacun. La politique se dissout dans un processus économique sans sujet. Comme l'a écrit Heidegger, nous vivons à une époque où la puissance est seule à être puissante. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde soit logé à la même enseigne: il y a ceux qui se débrouillent pour surfer sur la vague, beaucoup d'autres qui sont roulés dessous.
Ce processus est-il maîtrisable par une restauration politique?
Politique vient de polis qui, en grec, désignait la cité. Pour les Grecs, les Perses étaient des barbares non parce qu'ils auraient été ethniquement inférieurs, mais parce qu'ils vivaient dans un empire. La politique ne s'épanouit qu'à des échelles limitées, au-delà desquelles elle dépérit. C'est pourquoi le grand argument qui a été seriné aux Européens, que leurs nations étaient trop petites pour exister encore politiquement et devaient transférer leur souveraineté à une entité continentale, où la politique retrouverait ses droits, a été une pure escroquerie. La politique n'a pas été transférée des nations à l'Union européenne, elle s'est simplement évaporée - à vrai dire tel était, sous les «éléments de langage» destinés à le masquer, le but recherché.
La nation mérite d'être défendue parce que c'est la seule échelle où une vie politique existe encore un peu. En même temps, des nations comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni sont déjà trop grandes pour que la politique y joue pleinement son rôle. Dans les années 1850, Auguste Comte déplorait l'unification italienne comme un mouvement rétrograde, et pensait qu'à l'inverse, c'était la France qui aurait dû se diviser en dix-sept petites républiques (soixante-dix en Europe). Selon lui, c'était seulement après s'être ancrées dans une vie à cette dimension que les petites patries auraient été à même de se réunir de façon féconde, afin de traiter ensemble les questions qui outrepassent leur échelle.
Aujourd'hui la Suisse, avec ses huit millions d'habitants et sa vie cantonale, est l'État européen où la démocratie est la plus vivace. Et historiquement, les cités de la Grèce classique, entre le VIe et le IVe siècle avant notre ère, ainsi que les cités-États italiennes de la Renaissance (Florence comptait moins de 100 000 habitants du temps de sa splendeur) constituent des réussites inégalées, qui montrent qu'en étant ouvertes sur le monde, des patries de petite taille sont capables de resplendir dans tous les domaines.
Le problème est que même si beaucoup de petits États sont préférable à quelques gros, un gros État dispose d'un avantage: il est en mesure d'écraser un voisin plus petit. De là la tendance à la croissance en taille, quand bien même tout le monde, au bout du compte, devrait y perdre.
Le processus inverse est-il possible? Peut-on imaginer que la petitesse devienne la norme?
L'Autrichien Leopold Kohr (lauréat du prix Nobel alternatif en 1983) demeure malheureusement très méconnu. En 1957, dans son livre The Breakdown of Nations, il écrivait: «Il n'y a pas de détresse sur terre qui puisse être soulagée, sauf à petite échelle. […] C'est pourquoi par l'union ou par l'unification, qui augmente la taille, la masse et la puissance, rien ne peut être résolu. Au contraire, la possibilité de trouver des solutions diminue au fur et à mesure que le processus d'union avance. Pourtant, tous nos efforts collectivisés et collectivisants semblent précisément dirigés vers ce but fantastique - l'unification. Qui, bien sûr, est aussi une solution. La solution de l'effondrement spontané».
Les choses étant ce qu'elles sont, je crains qu'il ne faille en passer par de tels effondrements. Quand je dis cela, je me fais traiter de Cassandre. Je rappellerai toutefois que dans la mythologie grecque, les mises en garde de Cassandre étaient toujours fondées, le problème étant que personne ne la croyait. Ainsi, malgré ses avertissements, les Troyens firent-ils entrer le cheval de bois dans leur ville. On ne peut pas dire que cela leur ait réussi. Par ailleurs, si les effondrements qui se préparent ont de quoi faire peur, car ils engendreront de nombreuses souffrances, la perspective n'est pas seulement négative: ils peuvent aussi être l'occasion pour les peuples d'échapper aux fatalités présentes, et de revenir à la vie.
Olivier Rey, propos recueillis par Alexis Feertchak et Vincent Tremolet de Villers (Figaro Vox, 5 août 2016)