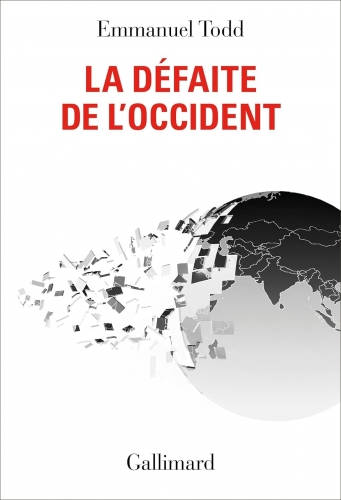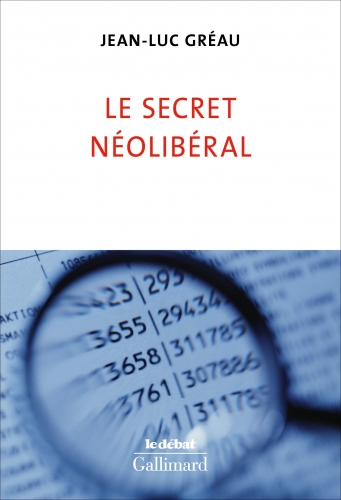Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Diego Fusaro, cueilli sur Euro-Synergies et consacré au capitalisme financiarisé. Élève de Costanzo Preve, philosophe et essayiste, Diego Fusaro est une des figure intellectuelle de la mouvance populiste italienne.

Prisons intelligentes. La caverne de cristal à l'ère numérique
Bien que modulée selon des figures différenciées et de manière faussement polyphonique, la rengaine ininterrompue que la société du spectacle répète à travers ses réseaux unifiés – « la société existante est la seule possible, comme elle l'a toujours été et comme elle le sera toujours » – finit par priver de fondement, au niveau de l'imaginaire collectif, la critique théorique et, avec elle, la possibilité d'un renversement pratique. Elle nous persuade de l'inexistence de quoi que ce soit en dehors de la caverne et, en fin de compte, de l'inévitabilité de la caverne elle-même qui nous transforme en internés à l'échelle mondiale. Dans chacune de ses représentations, le spectacle cherche une transformation : d'une part, celle de l'espace de la caverne en une cage de fer avec des barreaux inoxydables et une sortie interdite pour éviter d'éventuelles fuites ; et d'autre part, celle des prisonniers, potentiellement en quête de leur propre libération, en simples spectateurs passifs et, de plus, en dévots inconscients de leurs propres chaînes. C'est la condition qui prévaut à l'époque triste de Facebook, Twitter et toutes les autres ego-sphères postmodernes, variations numériques et rigoureusement solitaires de la caverne de Platon.
Ce modèle semble pouvoir être ramené à la « caverne parfaite » des solitudes numériques de la civilisation technomorphe et du nouveau « capitalisme de surveillance » (surveillance capitalism) avec l'esclavage intelligent (Smart) auquel il condamne quotidiennement ses heureux serviteurs. Les systèmes totalitaires du « siècle court » opprimaient la liberté, là où le néolibéralisme de la surveillance l'exploite et la soumet à un régime de profit, apparaissant ainsi comme le premier régime cool. Les deux figures hégéliennes opposées du Serviteur et du Seigneur, du Maître et de l'Esclave, se rejoignent en une seule figure, celle de l'homo neoliberalis qui, en tant qu'« entrepreneur de soi », s'exploite sans relâche pour être le plus performant possible. Chacun, en tant que maître, exige de lui-même, en tant qu'esclave, une productivité maximale, portant l'exploitation capitaliste à son niveau hyperbolique.
L'homo digitalis prend de plus en plus l'apparence d'un sujet de « l'empire cybernétique » en pleine technicisation, peuplé de vagues océaniques faites de solitudes connectées via Internet, vouées au langage post-humain des « émoticônes » de la société des likes. Le socialisme, forme politique centrée sur la dyade liberté et égalité, tombe au rang de simple activité individuelle sur les réseaux sociaux. Plus précisément, le socialisme réel est défenestré par le « socialisme numérique » des réseaux sociaux et des plateformes cybernétiques, nouvelles prisons intelligentes qui piègent le sujet dans les mécanismes de la solitude connectée et de la valorisation ininterrompue de la valeur.
L'espace numérisé, lisse et apparemment libre, ressemble de plus en plus à un immense camp de concentration intelligent, une communauté non communautaire dans laquelle les sujets sont contrôlés et suivis, exploités et trompés, illusionnés par des expériences ludiques et divertissantes alors qu'en réalité, ils travaillent sans relâche – et sans échange d'équivalents – pour l'ordre néolibéral. Dans la bulle numérique, où la connexion remplace le contact et où la solitude des réseaux sociaux remplace la sociabilité, on est seul et surveillé, car presque chaque geste, en plus de générer des profits pour le capital, est surveillé et suivi de manière panoptique. La ludification, rendue possible par les émoticônes persuasives et la spirale des likes, cache le fait que l'utilisateur inconscient des plateformes sociales, se trompant en pensant qu'il communique et s'amuse, travaille pour le capital sans contrepartie et donc dans la forme maximale d'exploitation.
La numérisation et l'infosphère contribuent non seulement au déclin du monde objectuel (produisant ainsi le paradoxe d'une société hyper-matérialiste dans un ordre des choses de plus en plus dématérialisé), mais elles promettent également une croissance exponentielle de la liberté qui se transforme rapidement en un régime de surveillance totale, en une prison intelligente dont les barreaux invisibles sont faits du même matériau que les applications de suivi et de collecte de données disséminées dans nos appareils techniques. Prenons le cas emblématique du smartphone, « le camp de travail mobile dans lequel nous nous emprisonnons de notre plein gré », comme l'a défini Byung-Chul Han : il déréalise le monde et, en même temps, sous la forme d'un hublot sur le réel, il se présente comme un informateur qui surveille implacablement son propriétaire, contrôlé et heureux de l'être grâce à la cession volontaire de données et d'informations sur presque tous les domaines de sa vie.
Dans l'histoire sub specie speleologica de l'humanité, la dernière caverne – en attendant d'autres qui viendront peut-être – est en verre.
Les nouvelles prisons numériques et intelligentes de la civilisation technomorphe sont transparentes et vitrées, à l'image du flagship store d'Apple à New York, évoqué par Byung-Chul Han: un cube de verre, véritable temple de la transparence, qui rend les êtres humains – rectius, les consommateurs – entièrement transparents et visibles, supprimant toute zone d'ombre et tout angle soustrait à la vue. Tout doit être vu et exposé, et les sujets ne doivent rien désirer d'autre que leur exposition spectaculaire ininterrompue sous forme de marchandise.
L'esclave idéal de la caverne vitrée – réduit à un profil sans aucune identité – communique et partage sans cesse des données et des informations, occupant chaque espace de sa présence et travaillant à tout moment pour le capitalisme informationnel. Le nouveau « capitalisme de surveillance », royaume de l'infocratie et du « dataïsme », exploite non seulement les corps et les énergies, mais aussi, dans une mesure non négligeable, les informations et les données: grâce à la transparence totale de la nouvelle caverne de verre, l'accès aux informations permet de les utiliser à des fins de surveillance psycho-politique et de contrôle biopolitique, mais aussi pour prédire les comportements et générer des profits.
Comme le personnage de Platon, le prisonnier ignorant de la caverne Smart de cristal se considère libre et créatif dans son geste, systématiquement stimulé, de performance constante et d'ostentation ininterrompue de lui-même dans les vitrines de cette communauté virtuelle qui, habitée uniquement par des consommateurs, n'est rien d'autre que la version commercialisée de la communauté. Plus les sujets numériques génèrent de données et plus ils communiquent activement leurs goûts et leurs activités, leurs passions et leurs occupations, plus la surveillance devient efficace, de sorte que le smartphone lui-même apparaît comme une prison intelligente, voire comme un appareil de surveillance et de soumission qui ne réprime pas la liberté, mais l'exploite implacablement dans le double but du contrôle et du profit.
Byung-Chul Han a écrit que l'histoire de la domination peut également être décrite comme la domination de divers écrans. Chez Platon et dans la caverne qu'il a imaginée, nous trouvons le prototype de tous les écrans: l'écran archaïque du mur qui met en scène les ombres échangées et confondues avec la réalité. Dans 1984 d'Orwell, nous rencontrons un écran plus évolué, appelé le "télécran", sur lequel sont diffusées sans cesse des émissions de propagande et grâce auquel tout ce que les sujets disent et pensent chez eux est scrupuleusement enregistré. Aujourd'hui, la dernière figure de la domination par l'écran semble se mettre en place avec l'écran tactile des téléphones portables: le smartphone devient le nouveau média de la soumission, la caverne individualisée et vitrée dans laquelle les êtres humains ne sont plus des spectateurs passifs, mais deviennent tous des émetteurs actifs, qui produisent et consomment de l'information en continu. Ils ne sont pas obligés de rester silencieux et de ne pas communiquer, mais au contraire son invités à parler sans arrêt et à transmettre sans relâche, tout en « vendant » pour le compte du capital leurs propres histoires et leurs propres vies, leurs propres données et leurs propres attitudes comportementales (le storytelling se transforme en storyselling). En résumé, la communication n'est pas interdite, comme dans les anciennes cavernes, mais elle est encouragée et stimulée, à condition qu'elle soit fonctionnelle au capital et à sa valorisation, à sa conservation et à son progrès.
Dans les anciennes cavernes – de Platon au panoptique de Bentham et de Foucault –, les pensionnaires étaient surveillés et punis ; dans la nouvelle caverne vitrée aux murs tactiles de l'ère numérique, ils sont motivés et performants, encouragés à s'exhiber et à communiquer. Il suffit de penser au paradigme postmoderne de la maison intelligente (smart house), hautement technicisée, avec des dispositifs sophistiqués – jalousement installés par le propriétaire lui-même – qui transforment l'appartement en une prison numérique, où chaque action et chaque discours sont minutieusement contrôlés et transcrits. Le contrôle, la surveillance et le suivi sont ainsi perçus et vécus comme un confort et comme des expressions de la coolness du monde technicisé, et non, au contraire, comme des outils et, en même temps, des expressions de la captivité confortable, agréable et douce de l'homo globalis. La caverne parfaite est vitrée non seulement pour que son prisonnier soit observé à tout moment et jusque dans les moindres recoins de sa conscience, mais aussi pour que ses murs ne soient pas visibles et que, par conséquent, on ne puisse en aucun cas être conscient de son existence.
Sur cette base, il faudrait repenser le récit, si cher aux chantres de l'ordre discursif néolibéral, qui présente toujours l'Allemagne de l'Est et l'Union soviétique comme des empires gris ayant contrôlé la « vie des autres », comme le dit le titre d'un film à succès sur le sujet; dans le but, cela va sans dire, d'opposer à ces empires du contrôle total leur propre idéal resplendissant de liberté sous forme de marchandise. Il est bien sûr vrai que dans le Berlin d'avant le Mur ou dans le Moscou soviétique, les citoyens étaient espionnés et surveillés en permanence (nous ne savons pas, en vérité, dans quelle mesure et de quelle manière ils étaient espionnés en Allemagne de l'Ouest ou aux États-Unis par la CIA, pour la simple raison que tous deux ont survécu à la chute du Mur et à l'extinction ignominieuse de l'URSS). Mais il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui, l'habitant de la caverne de verre sans frontières est espionné, suivi et surveillé de manière incomparablement supérieure, grâce aux progrès technoscientifiques qui, comme cela devrait être clair, tendent à coïncider avec les progrès de la soumission de l'homme à l'appareil techno-capitaliste. La Stasi de la RDA apparaît, à tous égards, archaïque et marquée d'amateurisme par rapport à Alexa, l'« assistante virtuelle » et « enceinte intelligente » des nouvelles maisons connectées. Prisonnier de la énième manifestation de la fausse conscience nécessaire, l'homo neoliberalis condamne comme une surveillance oppressive, en Allemagne de l'Est et dans le Moscou du socialisme réel, cette même domination qu'il subit quotidiennement sous des formes incroyablement plus radicales et plus invasives, la vivant au contraire, avec une joie insensée, comme un « confort » et un « progrès ».
On retrouve, mutatis mutandis, un modèle remis en question par la modernité et désormais actualisé sous forme numérique. La nouvelle figure de la caverne parfaite correspond à celle où les prisonniers sont totalement contrôlés et – c'est là la nouveauté décisive à l'ère des masses techno-narcotisées – sont heureux de l'être, collaborant activement à leur propre incarcération. C'est le paradigme développé à l'origine par Jeremy Bentham dans la prison idéale qu'il a conçue en 1791, le Panopticon comme caverne de haute surveillance, qui isole et contrôle totalement. La surveillance parfaite, propre à la forteresse idéale dont il est impossible de s'échapper, est confiée à un seul gardien : caché dans la tour centrale, entourée d'une construction circulaire où sont disposées les cellules des prisonniers, éclairées de l'extérieur et séparées par d'épais murs, le gardien mystérieux, que personne ne peut voir, observe tout et tout le monde (c'est ce à quoi fait allusion la synthèse entre πᾶν et ὀπτικός) sans permettre aux détenus de savoir si, à un moment donné, ils sont réellement observés. Les détenus sont potentiellement contrôlés à chaque instant, car ils ne peuvent jamais voir le contrôleur: le regard est en effet à sens unique, puisque l'observateur n'est pas observé et que les observés ne sont pas des observateurs.
Cette relation asymétrique, dans laquelle se cristallise le lien de domination et de servitude dans la « caverne » de Bentham, admirablement analysée en 1975 par Foucault dans Surveiller et punir, oblige les prisonniers à se comporter comme s'ils étaient surveillés en permanence, sans nécessairement l'être concrètement: la tour pourrait en effet être dépourvue de gardien, mais les prisonniers, ne pouvant le savoir, devraient continuer à se comporter comme s'il était à son poste de contrôle. En fait, ils devraient adopter des comportements disciplinés et presque automatiques, comme s'ils étaient réellement surveillés de manière totale. Ce paradigme, repris par Bentham, avait déjà été esquissé par le sophiste Critias – l'un des Trente Tyrans – lorsqu'il en était arrivé à soutenir que l'invention même des dieux « qui voient tout » était fonctionnelle au comportement moral des individus, lesquels sont dès lors potentiellement toujours observés d'en haut.
À l'ère du nouvel ordre technomorphe, le contrôle est total sans que, en général, le caractère problématique de sa présence soit même remarqué, ce qui est ainsi recherché et souhaité par les nouvelles subjectivités techno-narcotisées. Une fois de plus, selon le théorème d'Adorno, la toute-puissance de la répression et son invisibilité s'inversent l'une dans l'autre. Dans le panoptique de verre de l'ère numérique, les internés ne savent pas qu'ils sont internés et sont incités à communiquer sans retenue sur tout ce qui les concerne: dans aucune des cavernes précédentes de l'aventure historique, il n'était arrivé que ce soient les sujets eux-mêmes qui s'enregistrent avec enthousiasme et fournissent au pouvoir toutes sortes d'informations sur eux-mêmes et sur leur propre vie.
Diego Fusaro (Euro-Synergies, 31 mai 2025)