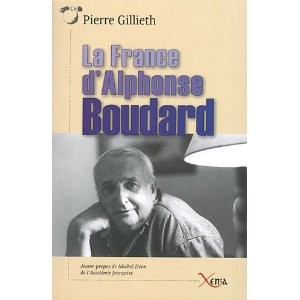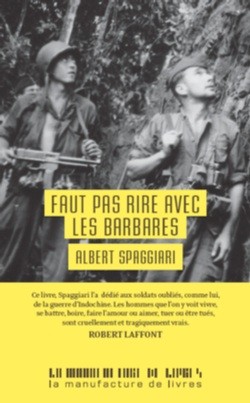11 novembre : la mémoire de la France est davantage à Verdun qu'à Auschwitz
Le ministre de l’Education nationale a choisi symboliquement le jour de la rentrée scolaire, le 1er septembre 2011, pour recevoir Richard Prasquier, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), et le cinéaste Claude Lanzmann, auteur du film Shoah. Luc Chatel leur a redit solennellement l’importance primordiale qu’il accordait à l’enseignement de la « Shoah », une importance telle qu’elle justifie d’ailleurs l’existence d’un site officiel dédié sur le portail de l’Education nationale.
La persécution dont les juifs ont été victimes durant la seconde guerre mondiale est naturellement un élément central de la mémoire juive. Et les souffrances des juifs français sont bien évidemment un élément important de la mémoire française. Nul ne peut oublier le souvenir de nos 25.000 compatriotes juifs français (et des 50.000 juifs étrangers présents en France) déportés dans les camps de concentration dont bien peu eurent, comme Simone Veil, la chance de revenir en France.
Hypermnésie de certaines souffrances, amnésie des autres
Mais ces souffrances-là ne doivent pas conduire à nier ou à minimiser les autres drames français. Or, l’hypermnésie de la souffrance des uns conduit souvent à l’amnésie de la souffrance des autres. A-t-on le droit d’oublier (chiffres donnés par Jacques Dupâquier dans Histoire de la population française) :
- - les 123.000 militaires tués en 1939/1940 ; dans la bataille de France, en ce printemps 1940, c’est 3.000 hommes qui sont tombés chaque jour, le plus souvent en combattant, à l’instar des Cadets de Saumur ; - les 45.000 prisonniers de guerre qui ne revinrent jamais ;
- - les 20.000 tués des FFI et des FFL ;
- - les 27.000 résistants morts en déportation ;
- - les 43.000 morts de l’armée de la Libération ;
- - les 40.000 requis morts en Allemagne ;
- - les 125.000 victimes des bombardements aériens (pas toujours justifiés militairement) et terrestres.
Oublier ces victimes, ce n’est pas seulement un déni de compassion, c’est les tuer une deuxième fois ; c’est aussi trahir la vérité historique.
Ce qui compte dans la mémoire d’un peuple c’est ce que ses ancêtres ont charnellement vécu
Et pourtant ces victimes furent honorées dans l’immédiat après–guerre : par les timbres-postes, les noms de rue, les livres, les films, les disques, et ce jusqu’au début des années 1970, avant de disparaître dans l’obligation de repentance et l’oubli officiel. Pourtant ces victimes-là sont encore très présentes dans la mémoire française : parce que, les événements qui ont provoqué leur mort, ceux qui ont survécu les ont aussi connus et pas seulement au… cinéma. Or ce qui se transmet dans la mémoire des familles et des lignées, c’est ce que les ancêtres ont vécu. La patrie, c’est la terre des pères.
Français de souche ? Avoir son patronyme inscrit sur un monument aux morts
C’est pourquoi dans chaque famille française la mémoire de 1914 est si vive. Chaque famille conserve le souvenir des 1.400.000 morts de la Grande Ordalie : 1.000 morts par jour pendant quatre longues années. Et les Français vivants ont tous un père, un grand-père, un arrière-grand-père ou un trisaïeul qui a combattu à Verdun. Dans cette guerre civile européenne, c’est le sang gaulois qui a coulé. La présence dans nos villes et nos villages des monuments aux morts est infiniment poignante.
Réfléchissons un instant à ce qu’est un Français de souche : un Français de souche, c’est un Français dont le patronyme est inscrit sur l’un de nos monuments aux morts.
Un Français de souche, c’est un Français qui a dans ses archives familiales les lettres ou les carnets d’un ancêtre qui raconte avec des mots simples le quotidien de la Grande Guerre. Alors qu’approche le centenaire du 2 août 1914, ces écrits simples, précis et sans emphase, trouvent le chemin de l’édition : pieuses autoéditions familiales ou publication chez de grands éditeurs comme le carnet de route du sous-lieutenant Porchon (*). N’oublions pas non plus le succès du Monument, livre de Claude Duneton, qui raconte la vie des hommes dont les noms sont inscrits sur le monument aux morts d’un village du Limousin. Comme le dit un lecteur sur le site d’Amazon : « Vous ne traverserez plus jamais un petit village de France sans chercher des yeux son monument aux morts et avoir une pensée émue pour ces hommes dont le nom est gravé. Quels auraient été leurs destins et celui de leurs villages sans cette guerre ? Un livre à lire et à faire lire pour ne pas oublier. »
Reprendre le fil du temps dans la fidélité à la longue mémoire
Le siècle de 1914 s’achève : après avoir vu disparaître le fascisme, le national-socialisme, le communisme, c’est le libre-échangisme mondialiste qui s’effondre sous nos yeux. Le centenaire de 1914 approche, et il sera, n’en doutons pas, profondément commémoré. Pour la France et l’Europe le moment est venu de reprendre le fil du temps et de la tradition. Un fil du temps interrompu il y a un siècle. Un fil du temps à reprendre dans la fidélité à la longue mémoire.
Jean-Yves Le Gallou (Polémia, 7 novembre 2011)
(*) La précision de ces textes est admirable. J’ai eu la surprise de lire la narration des mêmes événements – attaques et contre-attaques aux Eparges en janvier/février 1915 – dans trois textes différents :
- Carnet de route du sous-lieutenant Porchon, saint-cyrien, chef de section, tué au combat, commandant la section voisine de celle du sous-lieutenant Genevoix ;
- Ceux de 14, admirable somme de Maurice Genevoix, blessé au combat ;
- Mémoires d’Auguste Finet, mon grand-père, simple soldat, sorti de l’école à onze ans et écrivant bien le français, blessé au combat.
Ce sont les mêmes faits qui sont précisément décrits, presque avec les mêmes mots. A cet égard la belle reconstruction littéraire de Maurice Genevoix est d’une fidélité parfaite aux événements.