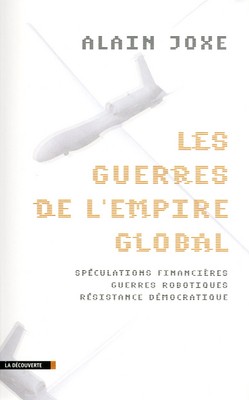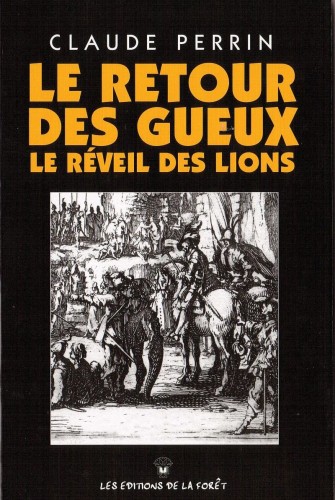On pourrait rédiger une longue étude sur cette puissance formatrice de la formation littéraire classique, mise au sommet de notre éducation au moment précis de la déthéologisation révolutionnaire. Pour instaurer l’école laïque, on introduisit l’enseignement philosophique comme une rhétorique moralisatrice qui prétendait se substituer à la religion. Une éloquence conceptuelle supplanta l’éloquence jésuitique devenue trop littéraire et latine. Les professeurs de philosophie endossèrent alors sans le dire le manteau des grands prédicateurs et des grands prêcheurs pour éduquer et moraliser les apprentis citoyens.
Pourtant, face à face, sur l’échiquier de la vie et au fond de la classe, on retrouvait, souvent, côte à côte le voyou et le futur légionnaire. Le voyou se plonge dans le refus et la négation parce qu’en réalité, il n’acquiesce qu’à lui-même. Le légionnaire se sacrifie, il passe Noël loin des siens et même pour certains, - requiescat in pace, pax animae suae - ne finissent pas l’année parce qu’ils obéissent sur le front en se refusant à eux-mêmes. Le voyou et le légionnaire posent le plus fort des dilemmes qui se pose à un homme : devons- nous supporter ou nous surmonter et comment ? Par les sens, ou par la transcendance ? En fait, nous n’avons rien d’autre à tester que cette double possibilité : peser et penser par les sens ou par la transcendance ! Supporter ou se surmonter comme méthodologie de la liberté, doigt militarisé sur la couture du pantalon avec le sens canaille de la magnanimité et de la gâchette ou l’esprit rebelle du règlement de compte au pied d’une barre d’immeuble désaffecté de Marseille.
Le travail philosophique est artisanal. Il n’a rien du professionnalisme des armées. Pour le voyou, la philosophie n’apporte rien d’autre que l’art de retrouver la bonne voie, la rectitude c’est-à-dire la joie même du refus initial. Cette notion de liberté fondamentale qu’est la liberté de vouloir est le plus souvent un mot galvaudé. Généralement pour l’homme non-philosophe, la « vraie » liberté, celle qui a un sens, c’est l’ensemble des libertés d’agir. Et, l’éducation n’est devenue justement que cela, une somme de libertés d’agir, de revendications stridentes, de droits affichés au détriment des devoirs, des politiques éthiques construites au gré de lois mémorielles qui muent les oublis en délits véritables ? Quand allons-nous enfin nous « surmonter », apprendre à chevaucher des cavales rétives et des étalons sauvages, réentendre le bruit de sabots d’une horde de chevaux qu’on rentre au haras, après un pari européen victorieux ?
Dans ses Principes de la Guerre, le maréchal Foch écrivait qu’"être discipliné ne veut pas dire encore se taire, s’abstenir ou ne faire que ce que l’on croit pouvoir entreprendre sans se compromettre, l’art d’éviter les responsabilités, mais bien agir dans le sens des ordres reçus, et pour cela trouver dans son esprit, par la recherche, par la réflexion, la possibilité de réaliser ces ordres ; dans son caractère, l’énergie d’assurer les risques qu’en comporte l’exécution" (1).
Le voyou, la caillera qui fuit la peur au ventre avec son scooter dans les parkings de la cité pour échapper aux flics après un larcin, le militaire engoncé dans son char ou son matériel sur une route cabossée et poussiéreuse de Kapisa, connaissent quelque chose de la vie, cette correspondance si étroite entre le corps et l’âme, ce mariage si problématique qu’on ne saurait sous la peau distinguer l’un de l’autre puisqu’il faut bien, au final, ramener l’âme au corps comme on ramène à la caserne son camarade blessé pour lui sauver la peau, oui, et, risquer sa peau. Dans la peur, le jugement se perfectionne et l’âme se raffermit. Quand le choc des armes brise le corps et paralyse les membres, la raison chancelle, l’esprit et la langue s’embarrassent. Tout s’affaisse à la fois et manque sa cible.
La philosophie n’enseignerait que la force du refus et mesurerait par cette force de résistance aux penchants du corps les degrés variables de la qualité des âmes. C’est l’image d’Alexandre le Grand : à la traversée d’un désert, l’empereur macédonien, mourant de soif reçoit un casque plein d’eau. Boire, tremper ses lèvres, avaler une gorgée, tel est le désir d’Alexandre le plus naturel et le plus pressant. Or, Alexandre ne boit pas, ne boira pas. Il n’aura pas l’indécence d’étancher sa soif devant son armée, tout autant assoiffée que lui. Il est empereur et seul peut être autorisé à gouverner celui qui se gouverne lui-même. Ce fut d’ailleurs la leçon indirecte de l’affaire DSK : la providence écarte naturellement l’homme injuste. Alexandre s’interdit de boire car il sait qu’on ne peut pas légitimement demander aux autres plus qu’on ne se demande à soi-même. Ainsi, Alexandre, formé par Aristote, peut-il être conducteur d’hommes, ainsi pourra-t-il obtenir d’eux le courage de marcher malgré les affres de la soif et de la chaleur, des vapeurs et des mirages du désert. Le geste d’Alexandre force l’estime des soldats mais aussi l’estime qu’Alexandre peut avoir pour lui-même. Dans ce déploiement de la force d’âme formée philosophiquement, l’empereur fait resplendir les valeurs morales au nom desquelles s’effectue la vertu. Alexandre, c’est la vertu du légionnaire.
Reste la racaille, la "caillera", la petite frappe, le bouffon. Il se laisse aller, il n’est heureux ou malheureux que selon que les choses qui lui surviennent, selon qu’elles sont, pour lui, agréables ou déplaisantes. Il a l’esprit du système du corps pas celui de corps. Finalement, il est conformiste dans l’art du consommable malgré la force de refus que nous avions cru pouvoir déceler en lui un peu plus tôt, au début, lorsqu’il se mettait au fond de la classe. On comprend que tous les hommes ont cette force de refus mais que tous n’ont pas le même courage et n’en font pas du tout le même usage. Il y a ceux qui l’exercent avec droiture et ceux qui, par lâcheté ou pour n’avoir pas reçu d’enseignement philosophique, manquent d’âme. On n’a pas par nature une âme de lâche ou de courageux mais on fait preuve dans l’acte de courage ou de lâcheté. Et cela ne va pas sans une éducation nécessaire de la volonté, sans l’apprentissage par des exercices spirituels et moraux. La volonté n’est pas un effet de mère nature mais elle est une conquête de la volonté raisonnable et réfléchie, une conquête intellectuelle par l’action et pour l’action. En ce sens, la formation philosophique de l’âme est pragmatique et non pas imaginaire, comme si elle aurait pu être, telle la position critique et bien naïve des déconstructeurs postmodernes, qu’un rapport imaginaire à soi-même, l’effet d’affects morbides ou le résultat de stratégies sociales de pouvoir, acharnées à discipliner et à réprimer l’énergie désirante.
L’expérience du philosophe, du voyou et du légionnaire est une attention équivoque au terrain des expériences de la vie, à toutes ces expériences bigarrées qui ne se vivent que comme un affrontement de tensions contradictoires, de déchirements internes entre des postulations opposées, horizontales ou verticales, descendantes ou ascendantes. Tout homme parce qu’il a forcément, un jour, un peu trop bu, a eu l’expérience de ce genre de débat interne, il a connu les affres du désir et c’est peut-être pour en rendre compte que toute une tradition orale et vivante de la transmission philosophique ne cesse de se dérouler, dans certains cours, à la fois comme une transmission psychique et une tradition somatique. Concevoir le vrai de l’homme dans l’unité de forces physiologiques contradictoires, de dimensions psychiques hétérogènes résumerait alors en soi tout le projet philosophique. Mais alors comment puis-je être à la fois le voyou et le légionnaire, celui qui a soif et celui qui s’interdit de boire, celui qui s’irrite et celui qui garde son sang froid ? Il y a là, pour le philosophe et l’officier commandeur d’hommes, une étrangeté typique de l’humanité. De fait, sous l’empire de la soif, l’animal boit ou meurt ; sous l’empire de la peur, il fuit. Le courageux, au contraire, met en œuvre une force qui domine la peur, contrôle le tremblement nerveux et s’avance fermement au devant du danger, fut-il légal ou illégal.
Finalement, le voyou et la racaille incarne, par son absence de contrôle, la figure déchue du commerçant, le légionnaire, celle noble du guerrier, du templier fondateur d’empires européens. Le philosophe porte trace du clerc célibataire et inutile, dernier témoin de l’école de la discipline civique, bouclier ultime contre la rébellion que la "caillera", au contraire du légionnaire, n’hésitera pas à poignarder, dans une scène hallucinée, comme un pistolet pointé contre tous les manuscrits en menace de l’agonie littéraire. L’agonie, l’agôn, le mot signifie, originellement, lutte et combat. Ce peut être un combat hilarant mais aussi un ring déchirant contre les mots et les choses qui s’enfuient. La leçon du voyou et du légionnaire : il n’y a pas de compréhension possible du monde ; il n’y a qu’un usage sans cesse recommencé et aléatoire du monde. La connexion entre les deux ne tient que de l’antagonisme, dans l’aveuglement du rêve qu’ils poursuivent gaiement.
Le philosophe souffre parfois de terribles maux de têtes. Il ne peut ni dormir ni écrire, expérimentant pendant quelque temps la douleur de l’incompréhension de nombreux textes à déchiffrer. Cette douleur mentale, faite aussi de migraines médicales, lui permet de parvenir à séparer sa tête de soi-même. Platon, Hegel et Marx ont souvent ironisé sur cette tête à l’envers du penseur mais cette douleur devient indissociable de ce qui lui arrive dans la vie comme une sorte d’instinct paranoïaque. Le voyou exhale dans le crime une forme de puissance alors que la meilleure chose à faire est de s’offrir à l’action aussi pure que possible.
Nous ne saurions pardonner à toute la classe politique d’avoir engendré de la boue pour des générations à venir. La rébellion et le sacrifice sont des distorsions mais ils continuent de tenir du beau et du vrai alors que les politiques ne produisent que du chagrin, de la déception, de l’injustice et de la cruauté. En face, la philosophie est militante dans son exigence à la fois héroïque et sacerdotale de poser la destinée humaine comme ouverte et tragique.
Michel LHOMME, professeur de philosophie (Theatrum Belli, 2 janvier 2012)
(1) Maréchal Foch, Des principes de la guerre, Paris, Berger-Levrault et Cie, 1903, p. 94