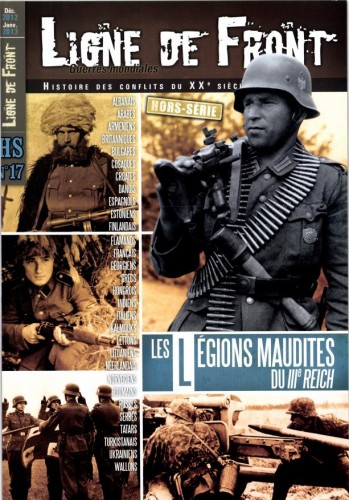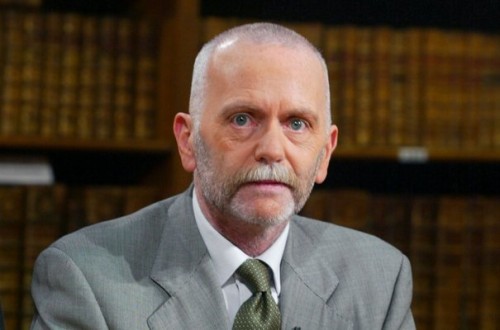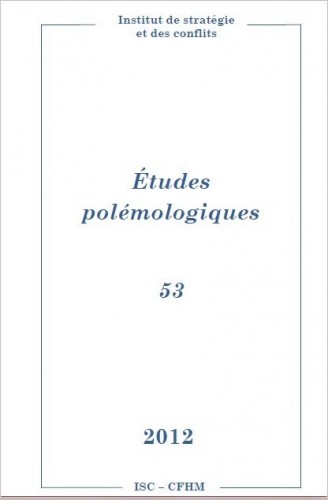Armée française : la ruine en héritage ?
L’Afghanistan a-t-il été le chant du cygne de l’ère des opérations extérieures de l’armée française ? A prendre au mot le concept de « betteravisation » qui fait florès dans nos états-majors (entendre retour au pays et fin de l’époque expéditionnaire), tout connaisseur de la chose militaire est porté à le croire. Coupes continues des crédits, purge massive des effectifs, cession gratuite du patrimoine immobilier, des milliers de militaires qui ne sont plus payés depuis des mois... La situation de la Défense est entrée dans une phase critique qui pourrait déboucher sur une crise sociale, capacitaire, et des vocations sans précédent historique. L’institution militaire sera vraisemblablement la principale victime de la politique ultra-récessive poursuivie par le gouvernement Ayrault, qui, en cela, ne fait que parachever les décisions prises sous le mandat de Nicolas Sarkozy. L’armée de terre sera la plus touchée, mais la Marine et l’armée de l’air auront aussi leurs lots.
L’affaire Louvois
Le volet le plus sensible politiquement et médiatiquement est d’abord celui des soldes non versées, lié aux dysfonctionnements chroniques qui affectent le logiciel bien mal nommé Louvois, du nom de l’énergique ministre de la guerre de Louis XIV. Problème récemment qualifié d’« invraisemblable » par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, lui-même. Dans la continuité de la politique de rationalisation budgétaire actée par la Révision générale des politiques publiques (RGPP), le ministère de la Défense a décidé la mise en place de plusieurs systèmes d’information de « ressources humaines » (SIRH). Dans l’armée de terre, ce système d’information a été baptisé Concerto. Louvois (Logiciel unique à vocation interarmées de soldes) est la déclinaison du volet « salaires » de l’ensemble des SIRH des armées (Rhapsodie pour la Marine, Orchestra pour l’Armée de l’Air, Agorha pour la Gendarmerie). Problème : ce logiciel vendu à prix d’or et dont la maîtrise d'œuvre et la maintenance sont assurées par l’entre- prise Steria, ne fonctionne pas. Depuis le raccordement de Louvois à Concerto et le basculement unilatéral de la gestion des soldes en octobre 2011, les ratés du système perdurent et se multiplient : frais de déménagement non remboursés, indemnités de campagne non perçues, soldes non versées, ou versées avec six mois ou un an de délai, ou alors versées de manière aberrante (seul un cinquième du salaire est perçu), autant d’accrocs dus à la pléiade de bugs qui affectent Louvois. La conséquence directe est une précarisation radicale des familles : une manifestation de femmes de militaires a eu lieu l’année dernière, première du genre, mais le mouvement a vite été étouffé par les pressions exercées sur leurs maris. Résultat : certains militaires, qui attendent le versement de leurs soldes, sont ruinés, interdits bancaires et sont obligés d’emprunter pour rembourser des crédits déjà contractés alors même qu’ils ne sont plus payés ! Dans les cas les plus extrêmes, leurs femmes divorcent pour acquérir un statut de femme seule et toucher des allocations. L’affaire des soldes pourrait, à condition de se cantonner à une lecture de surface, ne relever que d’un simple bug. En réalité, le problème pourrait aller bien au-delà du raté informatique et concerner aussi la trésorerie de l’Etat. Les capacités d’emprunt auprès des marchés s’épuisant avec la crise, la priorité va au paiement des salaires des institutions syndiquées et dotées d’une forte capacité de nuisance médiatique (Education nationale), à l’inverse exact des militaires. Officiellement 10 000 dossiers sont en attente de traitement dans l’armée de terre (chiffre reconnu par le ministère). En réalité l’ensemble de la chaîne des soldes (troupe, sous-officiers et officiers) est impactée (120.000 bulletins de soldes touchés) et le chiffre réel pourrait atteindre 30 % des effectifs totaux. Pire, ces ratés touchent en majorité des militaires qui sont sur le point de partir en opérations ou qui en reviennent (60 % des dossiers). Là encore, impossible de faire la lumière sur le nombre exact de militaires touchés puisque le ministère n’en a aucune idée précise et vient de lancer un appel aux parlementaires pour faire remonter les doléances. Le ministre Le Drian a parfaitement conscience du scandale même s’il feint de le découvrir avec sa prise de fonction, puisqu’il était chargé des questions de défense auprès de François Hollande pendant la campagne présidentielle. Si Bercy ne freinait pas, le ministère aurait évidemment débloqué des fonds spéciaux pour gérer l’urgence, ce qu’il commence à faire. L’annonce récente d’un plan d’urgence et la mise en place d’un numéro vert suffiront-elles ? Les services concernés sont déjà débordés par le flot des plaintes et, faute de compétence technique, n’ont d’autre choix que d’intimer la patience.
Sur le fond, une autre hypothèse – conditionnelle – pourrait être émise : les ratés de Louvois pourraient relever d’une stratégie mise en place par les grandes entreprises de conseil qui ont vendu ces logiciels de gestion intégrée pour démontrer au gouvernement l’incapacité des services de l’Etat à faire fonctionner des systèmes aussi complexes et obtenir une externalisation totale de leur gestion (Louvois est géré en interne par les services de ressources humaines du ministère qui sont épaulés par des équipes de Steria). Paradoxe ? L’Etat envisagerait de confier la totalité de la gestion du parc informatique du ministère à Steria. Aucune sanction financière n’a pour l’heure été prise contre l’entreprise, ce qui ne laisse pas d’interroger, tout comme l’absence de réactivité du contrôle général des armées, pourtant censé superviser et auditer ce type de dossier. Dans un contexte aussi opaque, il est de toute façon impossible de détailler avec exactitude les responsabilités de chacun. Seule une commission d’enquête parlementaire serait en mesure de le faire. On notera que seul l’ex-chef d’état-major de l’armée de l’air, le général Paloméros, constatant ces défaillances à répétition, a eu le courage de refuser le passage à Louvois. Il est depuis parti servir au sein de l’OTAN comme commandant suprême allié à Norfolk.
Le dépérissement des PME de Défense
La situation financière critique du ministère de la Défense recoupe également le problème des délais de paiement (9 à 18 mois en moyenne) aux PME de Défense (qui ont souvent pour seule clientèle l’Etat). La conséquence est que les PME n’ont pas les fonds de roulement nécessaires pour survivre à de tels délais et que la crise faisant, les banques ne prêtent plus. A cela il faut ajouter la perspective d’une contraction inéluctable des commandes de l’Etat liée aux coupes budgétaires dans les équipements. 211 millions d’euros avaient déjà été annulés sur la mission Défense 2011 pour rembourser une partie des 460 millions d’euros dus à Taïwan dans l’affaire des frégates après le rendu de l’arbitrage international. Pour le budget 2013, plus de 1,8 milliard pourraient être annulés ou décalés sur un total de 5,5 milliards. Il est à craindre que le tissu industriel des PME de Défense, déjà précarisé et très faiblement soutenu par l’Etat (à l’inverse de la politique pratiquée en Allemagne), risque à court terme la mort clinique. L’autre incidence de cette rétractation budgétaire est que l’effort de recherche et développement de programmes indispensables à notre autonomie stratégique, comme celui d’une capacité « drone », va être dramatiquement entravé, entraînant l’achat sur étagères de Reaper américains.
Le « dépyramidage » et le gel des avancements
Autre dossier brûlant : le gel de 30 % des avancements. Matignon a enjoint début septembre, via une lettre de cadrage, le ministère de la Défense d’impulser une politique de dépyramidage brutale de la structure de ses effectifs et pour ce faire de réduire du tiers les volumes d’avancement de ses personnels militaires sur les trois prochaines années. C’est l’autre bombe à retardement avec l’affaire des soldes : plus de perspective d’avancement au grade, plus d’augmentation salariale pour un tiers des militaires. Du jamais vu. Une politique de dépyramidage courageuse consisterait à acter une loi de dégagement de cadres (trop de colonels et de généraux en proportion par rapport aux officiers subalternes, sous-officiers et troupe) et à ponctionner dans les avantages du régime spécial de la 2e section (5.500 généraux en retraite dite « active », soit l’équivalent d’une brigade de réserve, pour seulement 95 rappels annuels). Le ministère ne s’y risquera sans doute pas car, contrairement à un sergent ou à un lieutenant, les généraux ont un poids politique (en interne) et une telle option susciterait des mouvements de solidarité redoutables dans un milieu pourtant sociologiquement marqué par l’individualisme.
Au final, on ne peut que constater avec dépit l’inefficacité totale de la politique de rationalisation engagée avec la RGPP de 2008. Au lieu de baisser comme prévu, la masse salariale de la Défense a augmenté : à mesure que le ministère ponctionnait dans les effectifs opérationnels, il a embauché des hauts fonctionnaires civils (+1 438 depuis 2008) comme le rapportait la Cour des comptes en juillet dernier.
Le bradage du patrimoine immobilier
Il faut également ajouter à ce triste constat le dossier du patrimoine immobilier de la Défense. Le gouvernement envisage en effet d’offrir sur un plateau les emprises parisiennes du ministère à la Mairie de Paris via une cession gratuite ou une décote de 100 % (en partie déjà opérée sur le budget 2013) pour y construire des logiciels sociaux et complaire aux demandes de Bertrand Delanoë. Ces recettes extrabudgétaires liées à la vente de l’immobilier (rue Saint-Dominique et autres emprises dans le cadre du transfert vers Balard), qui représenteraient entre 350 et 400 millions d’euros, étaient pourtant censées compenser les coupes dans les crédits d’équipement.
L’empilement des réformes non menées à terme et celles à venir
A ce contexte déjà tendu, il faut ajouter les problèmes liés à l’empilement des réformes depuis 2008. Une réduction de 55.000 personnels de la Défense avait déjà été actée par le Livre blanc passé. La Défense supportera ainsi 60 % des réductions de postes dans la fonction publique pour l’exercice 2013 : 7.234 supprimés sur les 12.298 au total. De surcroît, la refonte de la carte régimentaire (dissolution de dizaines de régiments, parfois décidée en fonction de calculs purement politiciens) qui a abouti à la création des Bases de défense, censées centraliser au niveau régional la gestion logistique et financière des emprises, et qui a été menée en fonction de postulats purement technocratiques, a abouti à créer des usines à gaz et à promouvoir un chaos gestionnaire. Les BdD ne fonctionnent pas et il est également prévu de réduire leur nombre initialement prévu (90).
Sur les difficultés non digérées des réformes passées vont enfin se greffer celles des réformes à venir et qui seront entérinées par le Livre blanc à paraître en février prochain. Si pour l’heure, ces perspectives ne relèvent que des secrets d’alcôve qui agitent les couloirs de la Commission du Livre blanc, elles semblent déjà quasi actées : le gouvernement projetterait de supprimer une annuité budgétaire complète sur la période 2014-2020, c’est-à-dire pas moins de 30 à 40 milliards sur les 220 milliards prévus sur la période par le Livre blanc (1) précédent. Une purge budgétaire qui serait corrélée à un projet de réduction de 30.000 postes opérationnels dans les armées (la quasi-totalité dans l’armée de terre, 3.000 dans la Marine et 2.000 dans l’armée de l’air) (2). Ce qui porterait les effectifs terrestres d’ici peu à un volume équivalent à celui de l’armée de terre britannique (80.000 hommes). Jamais l’armée française n’aura connu un volume de forces aussi faible dans son histoire depuis la Révolution.
Un format d’armée mexicaine
Aucune des lois de programmation militaire décidées par les gouvernements de droite et de gauche, et qui sont pourtant censées fixer le cap stratégique des armées et sanctuariser les investissements budgétaires, si cruciaux pour maintenir un modèle d’armée cohérent, n’ont été respectées depuis la professionnalisation de 1996. L’horizon d’un tel processus est clair : un effondrement radical des moyens humains et matériels (3) de nos forces, un format d’armée mexicaine (l’armée de terre compte actuellement 173 généraux en 1re section pour un effectif de moins de 110-120 000 hommes, là où le Marines Corps n’en recense que 81 pour un effectif quasi double de 220 000) avec une haute hiérarchie civile et militaire à peu près épargnée en raison de considérations politiques (puisque c’est elle qui exécute les réformes), un taux de disponibilité des matériels extrêmement faible, des forces incapables de se projeter hors des frontières et des programmes militaires vitaux qui ne pourront être pleinement financés (drones, renouvellement véhicules terrestres, développement d’une capacité de cyber-défense).
Le décrochage géostratégique de la France
La parade, qui consiste à tout miser sur un modèle d’intervention indirecte (formation à l’arrière de forces étrangères avec l’appui de notre aviation et de petits contingents de forces spéciales, comme ce qui est prévu au Mali et ce qui a été fait en Libye) et le renseignement, ne suffira pas à empêcher le décrochage brutal de notre influence géostratégique. Il se pourrait surtout que le Livre blanc acte définitivement l’idée de smart défense (*) et de mutualisation des capacités nucléaires avec l’Angleterre (qui en tirera tous les bénéfices), achevant de décapiter ce qui restait de souveraineté stratégique à la France après la réintégration dans l’OTAN. La route du désastre est donc parfaitement balisée.
Comment expliquer cette pression extrême sur le budget de la Défense ? Très simplement par le fait que l’armée est la seule institution publique à ne pouvoir compter sur un contrepouvoir syndical et que le politique se sent, en conséquence, autorisé à toutes les oukases. On pense notamment au scandale de la campagne double refusée jusqu’en 2011 aux militaires ayant servi en Afghanistan (4).
Voilà plus de soixante ans, le général De Gaulle avertissait déjà dans un discours fameux : « La Défense ? C’est la première raison d’être de l’Etat. Il ne peut y manquer sans se détruire lui-même ! » Il semble que cette phase d’autodestruction soit désormais irrémédiablement engagée. Si le politique choisit la facilité et s’entête dans ce processus de désossage budgétaire de notre puissance militaire, et si le haut commandement n’y trouve rien à redire, il ne restera bientôt à nos forces, en lieu de drapeau et de fierté, que l’héritage de la ruine. On pourra alors graver au frontispice des régiments les mots de Shelley flétrissant l’orgueil du roi Ozymandias : « Rien à part cela ne reste. Autour des décombres / De ce colossal naufrage, s’étendent dans le lointain / Les sables solitaires et plats, vides jusqu’à l’horizon. »
Georges-Henri Bricet Desvallons (Polémia, 3 novembre 2012)
Notes de l'auteur :
- Le Livre blanc 2008 tablait sur une enveloppe budgétaire de 377 milliards d’euros d’investissement sur la période 2009-2020, avec une progression nette du budget entre 2015 et 2020 (160 milliards ayant été virtuellement consommés sur la tranche 2009-2013).
- Ces 30.000 postes ne pourraient représenter qu’une première tranche et suivis de 30.000 autres sur les dix prochaines années, ce qui rapporterait le volume des forces terrestres à un seuil critique de 60.000 hommes.
- Pour 2013, les programmes touchés sont les suivants : le camion blindé PPT, l’Arme individuelle du futur (remplaçant du Famas), le VLTP (successeur de la P4), le programme-cadre Scorpion de modernisation des forces terrestres et des GTIA.
- Le ministère de la Défense précédent ayant en effet refusé de qualifier l’engagement en Afghanistan de « guerre » jusqu’en 2011, les militaires partis en Opex n’ont pu prétendre aux bénéfices du dispositif de la campagne double. Parmi les régimes d’opérations qui ouvrent un droit à une bonification des cotisations de retraite, on distingue communément la campagne double (6 mois de service valent 18 mois au titre de la pension) de la campagne simple (6 mois valent 12 mois) et de la demi-campagne (6 mois valent 9 mois). Ce n’est ni le lieu ni la durée de l’engagement qui détermine le régime de campagne mais sa « nature ».