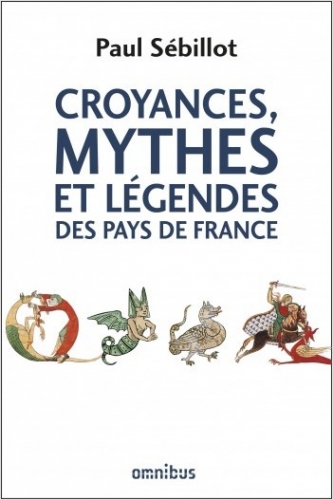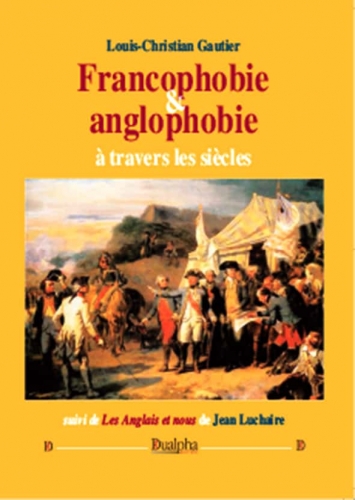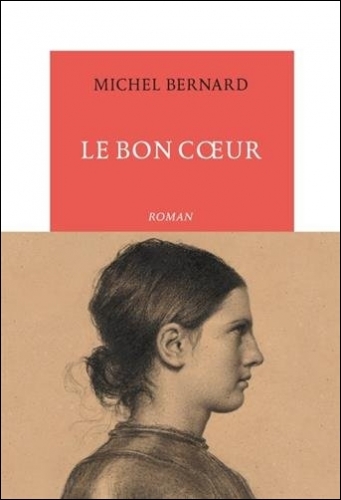France, pays de haute civilisation
Cinq mois après la mise en service de ses vélos, la société chinoise Gobee.bike a décidé de se retirer de France : 1000 vélos volés, 3200 dégradés, non seulement à Paris mais aussi en province (et à Bruxelles, où on imite Paris, dans la délinquance comme dans le jihad). La société Gobee.bike déplore sa décision en un langage typique de notre époque, où il s’agit de dire sans désigner ni « stigmatiser » personne. Elle n’en révèle par moins que ses vélos avaient fini par faire l’objet d’un saccage systématique de la part d’individus dont c’était devenu le passe-temps : les mêmes que ceux qui, pour marquer leur attachement indéfectible à la France, brûlent des voitures par centaines, à la Saint-Sylvestre et au 14 juillet, quand ils ne le font pas pour maquiller leurs méfaits, comme on le voit dans l’affaire du bon Théo, lequel n’a donc pas été violé par la police, la preuve de son mensonge ne mobilisant cependant pas ses « défenseurs » ni la presse qui s’était empressée de dénoncer les « brutalités policières »…
Le « concept » de Gobee.bike était pourtant séduisant : alors que les Vélibs ont besoin de bornes et d’un port d’attache, les vélos de Gobee.bike, eux, nécessitaient simplement, pour débloquer l’antivol, un téléphone et un code à barre ; et le vélo pouvait être laissé là où l’utilisateur avait cessé d’en avoir l’utilité. Un progrès ? Certes ; mais cette liberté d’utilisation s’est heurtée à l’abjection française – à l’archaïsme d’une société ravagée par la délinquance et le désastre migratoire. À l’heure où les femmes balancent leurs porcs, il est impossible de rien réformer en France : ni la SNCF ni l’éducation nationale, encore moins les mœurs qui, elles, se partagent entre le « progrès » du « mariage pour tous », de la GPA, de la PMA, du clonage, du trans-humanisme, et l’accroissement de l’ignorance et de la violence « gratuite » – celle-ci ne se mesurant pas seulement aux agressions physiques mais aussi aux « incivilités », hypocrite euphémisme désignant une délinquance sans limite, car devenue une manière d’être d’une grande partie de la population. On peut le comprendre à partir de l’idée de « gratuité » elle-même, qui a partie liée à l’irresponsabilité, donc à l’impunité : cela va des crachats et déjections canines sur les trottoirs au fait de laisser sur place le relief de ce qu’on a consommé : journaux « gratuits », gobelets de café, canettes de bière, bouteilles d’eau, mégots, chewing gum, emballages de kebab... Après tout, se dit le petit individu post-civilisationnel, il existe des services de ramassage d’ordures comme il existe un Samu social pour les « SDF » et des associations pour défendre les Roms. Le zombi post-moderne, petite monade inculte et sans éducation, mais sûre de ses droits, surtout si elle appartient à une « minorité » étrangère, réalise le programme de Mai 68 : jouir de tout, et tout de suite – sans se préoccuper d’autrui, instaurant donc une forme minimale de guerre de tous contre tous, qui se radicalise avec l’islam et la privatisation de l’espace public. Ainsi le dernier wagon des trains du RER est-il de plus en plus souvent privatisé par des fumeurs de tabac ou de cannabis. Ainsi se croit-on libre d’écouter sa musique non plus avec des écouteurs mais en en faisant profiter tout le monde. Que la plupart de ces propagateurs d’incivilités soient le fait de gens d’origine immigrée doit être bien sûr passé sous silence : il n’y a rien à voir, donc rien à dire.
Les vélos de la société Gobee.bike n’avaient aucune chance de prospérer dans un pays tel que la France, notamment à Paris, ville poubelle où l’individu post-moderne tue le temps comme il peut, en attendant le revenu universel, la libéralisation du cannabis, son clonage narcissique, tout ça sur les ruines d’une langue qui importune plus qu’elle ne sert, puisque ce n’est pas de l’ « américain ».
Certes, l’État compte sur la « compréhension » et la bienveillance de « citoyens » chargés de promouvoir le « vivre ensemble » républicain, c’est-à-dire d’entretenir l’illusion que la France est un pays de civilisation. Il n’est plus, en vérité, qu’une parodie de civilisation, comme tout ce que le « village global » propose au nom même de la « civilisation ».
Richard Millet (Site officiel de Richard Millet, 27 février 2018)