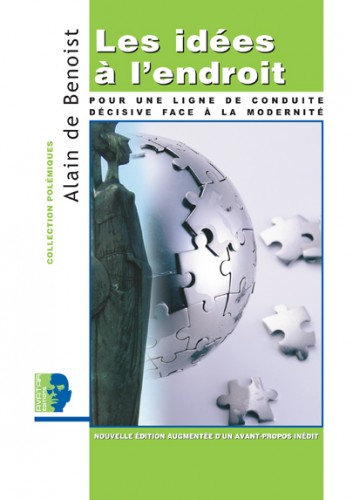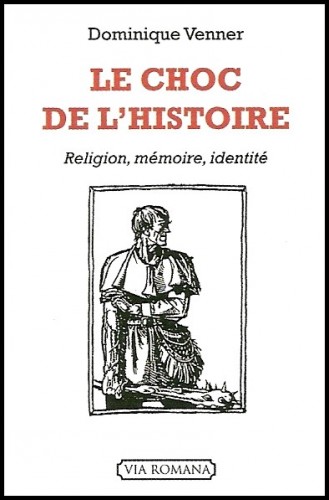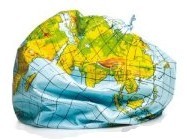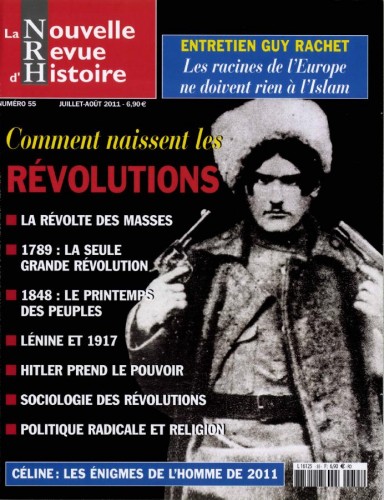Du contrôle des échanges au choix du consommateur
La France est-elle encore une entité stratégique ? L’Union européenne a-t-elle quelques chances d’en constituer une ? Au moment où la multiplication de ses engagements militaires hors frontières pose question à la France, au moment où la perspective de consolidation politique de l’Union européenne semble incertaine, sinon condamnée, la question ne peut plus être évitée. La présentation, jeudi matin 16 juin, à la Maison de l’Amérique latine, d’un sondage réalisé par l’IFOP à l’initiative de Philippe Murer (1), avec notamment Emmanuel Todd, Jacques Sapir et Jean-Luc Gréau, a donné un tour économique et politique précis à la question ; la France, ou l’Europe, sont-elles encore en état de décider de leurs échanges avec l’extérieur ? Si le propre de tout système vivant est bien de gérer ses échanges, c’est-à-dire de prendre de l’extérieur ce qui le nourrit, l’enrichit et le conforte dans son être, de rejeter à l’extérieur ce qui le menace, l’appauvrit ou le contamine, le constat est sévère ; l’Union européenne n’a pas été le moyen pour les peuples européens de s’approprier leur destin, elle a été le moyen de les déposséder, et d’abord en substituant les comités et les experts au débat public et à la volonté collective exprimée par le principe majoritaire. L’histoire du principe de la préférence communautaire, d’abord favorable aux échanges entre pays et régions d’Europe, progressivement vidé de tout sens par la multiplication des accords assurant à des pays extérieurs des conditions analogues d’accès au marché européen, est significative. L’histoire de l’ouverture aux mouvements de capitaux étrangers est tout aussi significative, le sommet étant atteint par la politique de placement des titres de l’Etat français par l’Agence France-Trésor auprès des investisseurs étrangers, aujourd’hui détenteurs de plus de 70 % de la dette publique, ce qui rend la France plus dépendante que toute autre du bon vouloir des agences de notation. L’histoire des abandons successifs qui ont permis d’ouvrir à tout vent l’espace Schengen, les renoncements progressifs au contrôle et à la gestion des populations résidant à l’intérieur de l’Union européenne, écrivent un autre chapitre de la haine des peuples par ceux qui assoient leur pouvoir sur une dissolution des Nations qui rétablit l’esclavage, qui autorise le trafic des êtres humains comme celui des terres ou de la vie, et qui les mettra à l’abri de la justice, de la colère, ou de la vengeance.
Le sondage IFOP publié ce jeudi 16 juin marque un moment majeur de la conscience française ; sera-t-il manqué comme tant d’autres l’ont été ? Successivement, la campagne et le débat sur le traité de Maastricht, le débat et le refus de la Constitution européenne, donnaient au gouvernement de la France la légitimité d’un ressaisissement, et à l’Union européenne, la chance d’un questionnement. La crise des dettes souveraines, dont on ne dira jamais assez combien elle est une opportunité stratégique essentielle pour ceux qui ne veulent pas d’une Europe forte, pour ceux qui veulent laisser l’Europe dans la situation coloniale qui est la sienne depuis 1945, pour ceux qui veulent affermer l’Europe à leurs intérêts et à leurs manœuvres, est une occasion analogue. Si le propre de l’humanité est bien de se constituer en sociétés politiques, singulières, autonomes, diverses, les moyens de cette singularité, de cette autonomie et de cette diversité résident d’abord dans les frontières, matérielles ou morales, qu’elles savent établir et gérer pour s’affirmer dans leur être. Les illusions de la dissolution des entités nationales dans le grand tout mondialisé, et du local dans le marché global, se dissipent à mesure que le spectre de la misère et celui du manque reviennent nous hanter. Et les Français, à plus de 70 %, tous partis et tendances politiques confondus, veulent que s’ouvre le débat sur le protectionnisme. Leur message est clair, il interpelle tous les partis. Pourront-ils s’y dérober, et d’abord ceux qui sont prompts à donner des leçons de démocratie aux autres ? La question à laquelle ils doivent répondre n’est pas celle de la politique idéale des échanges et du commerce extérieur ; la question des Français est celle du moment. Faut-il, alors que tous les pays développés se dirigent vers la croissance zéro, alors que des populations entières vont vivre des baisses de pouvoir d’achat de 10, de 20 ou de 30 % dans les prochaines années, notamment par suppression de services publics qui constituent une part importante du capital collectif européen, alors que les suppressions d’activités industrielles correspondent de plus en plus souvent à la disparition totale du pouvoir faire et du savoir faire, faut-il vraiment aller plus loin dans l’ouverture, dans le désarmement commercial et financier, dans le refus de définir nos intérêts stratégiques et de leur donner la priorité sur tout le reste ? Plus loin dans les mensonges de la concurrence et dans les illusions du sans-frontiérisme ? Plus loin dans la naïveté devant une Chine qui contrôle 75 % de son économie par l’Etat, instrument du parti, devant des Etats-Unis qui n’ont jamais transigé dès que leur intérêt national est en jeu ?
Les fondements du débat sont limpides. Le pouvoir de l’Union européenne est d’abord celui du premier marché du monde ; l’Union sait le faire valoir, par ses normes et ses règles ; le consommateur informé de la provenance des biens et services qu’il achète saura faire valoir sa préférence pour les entreprises qui respectent l’intérêt collectif, européen ou national. Chacun sait, ou devrait savoir, que les modalités du contrôle des échanges de biens, de services et de capitaux sont complexes. Chacun sait que la hausse des tarifs douaniers remettrait en cause la doxa établie, les ayatollahs de l’OMC et leurs complices de la Commission européenne elle-même, sans parler de leurs maîtres de Washington, mais aussi le pouvoir d’achat des Européens. Chacun a bien compris que les maîtres des marchés sauront employer tous les détours de la calomnie, de l’amalgame et de la falsification pour tenter de disqualifier la volonté populaire. Car celle-ci est explicite, et massive, certes pas sur les modalités du contrôle des échanges, certes pas sur son extension et son niveau, mais sur l’urgence du débat à ce sujet. Et ceux qui n’ont à opposer à l’opinion que les dogmes de leurs intérêts doivent y réfléchir ; refuser le débat, c’est le contraindre à se dérouler ailleurs, autrement, et par d’autres moyens. L’extrémisme des libre-échangistes qui font un dogme d’une pratique économique parmi d’autres, est la vraie menace que dénoncent les Français. Souhaitons-leur de pouvoir s’informer, pour comprendre, et pour choisir. Le temps du débat est venu. Honnête, ouvert et libre, il prévient celui de la colère.
Hervé Juvin (Regards sur le renversement du monde, 16 juin 2011)
1 – Le sondage est consultable sur le site de l’IFOP, ou sur www.protectionnisme.eu