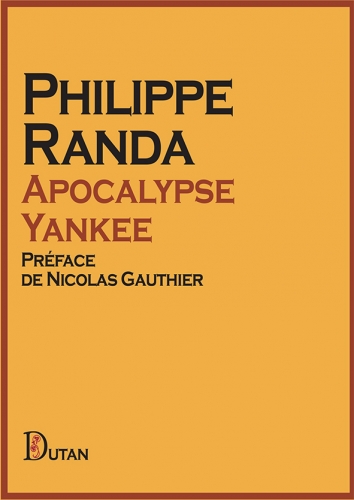Les éditions max Milo viennent de publier un essai de Jacques Baud intitulé Opération Z. Ancien membre du renseignement stratégique suisse et spécialiste des pays de l’Est, il a participé à des négociations militaires de haut niveau avec les forces armées russes. Au sein de l’OTAN, il a suivi la crise ukrainienne de 2014 puis a participé à des programmes d’assistance à l’Ukraine. Il est l'auteur de plusieurs essais dont La guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur (Rocher, 2003), Terrorisme - Mensonges politiques et stratégies fatales de l'Occident (Rocher, 2016) ou Poutine, maître du jeu (Max Milo, 2022).
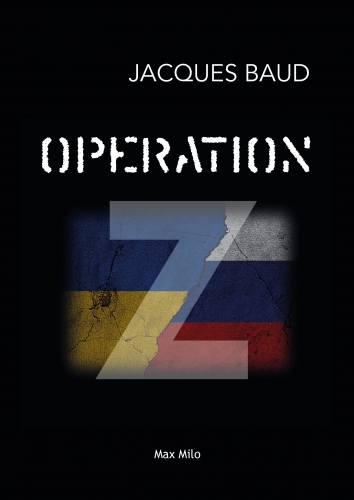
" Pourquoi Poutine a-t-il déclenché l’opération Z en Ukraine ? Les forces ukrainiennes utilisent-elles des volontaires néonazis ? Quelles sont les forces en présence et la réalité du conflit militaire depuis six mois ? Que savons- nous des crimes de guerre comme Boutcha ? Les sanctions économiques occidentales ont-elles fonctionné ? L’envoi massif d’armes par les Occidentaux a-t-il un effet sur le conflit ?
Après le best-seller Poutine: maître du jeu ?, dont le travail d’analyse a été salué dans le monde entier, Jacques Baud revient dans ce livre sur les causes profondes de la guerre en Ukraine et les raisons qui ont poussé Vladimir Poutine à intervenir le 24 février 2022. En s’appuyant sur les informations des services de renseignement et des rapports officiels, il analyse le déroulement des actions militaires et la manière dont elles ont été interprétées en Occident. Il explique le bouleversement de l’ordre mondial sur les plans politique et économique, ainsi que les conséquences à long terme des sanctions occidentales sur notre vie quotidienne. Il révèle comment le conflit aurait pu être évité et quelles pistes ont été volontairement délaissées par les États-Unis et l’Europe. "