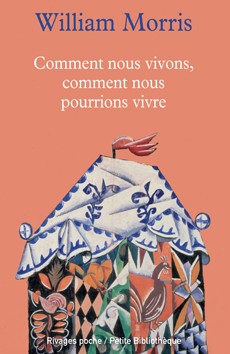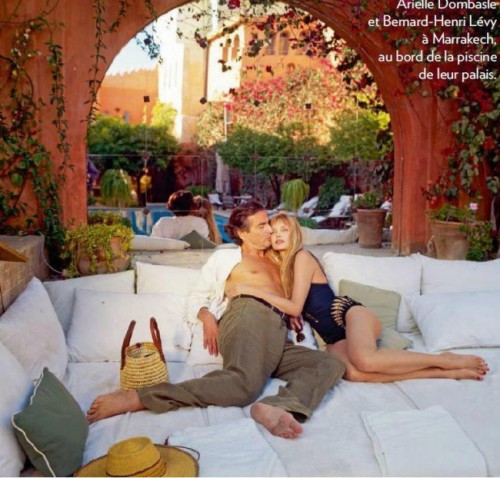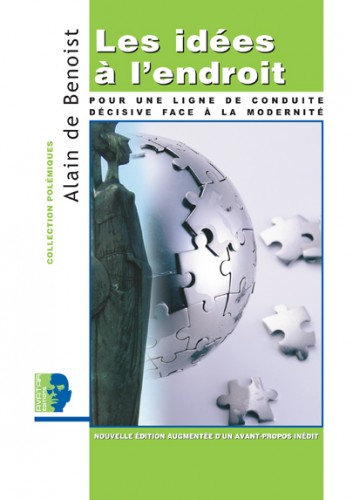L'image du survivaliste
Quand j'ai commencé ce blog il y a plus de deux ans mon idée était simple; déposer sur la toile une vision de la responsabilisation citoyenne, de la préparation et plus largement du survivalisme, au delà de certains clichés, au delà d'une certaine caricature psychologique trop souvent exploitée par la machine médiatique en mal de sensations fortes et de racolages plus ou moins malhonnêtes, et pouvant, a contrario, témoigner d'un survivalisme fondé sur la raison, et non sur l'émotion.
Cependant, comme toujours chez l'humain, et ceci qu'il soit rose ou bleu, fort ou faible, croyant ou dé-croyant, politisé ou polarisé, intelligent ou grossier…son rapport aux choses est souvent limité par le poids conscientisé ou non de son patrimoine génétique, de son éducation, et bien sur et plus généralement de son conditionnement.
Dès lors, le survivalisme est fatalement la construction d'une montagne d'idées plus ou moins cohérentes…d'une montagne de perceptions plus ou moins libres d'une chaine quelconque: conceptuelle, politique, théologique, émotionnelle, culturelle, médiatique, sensuelle, intellectuelle…
Ce qui est intéressant dans ce jeu d'images, c'est que si nous demandions a milles personnes de décrire le survivalisme, nous aurions sans doute milles échos différents tant l'information est ici dénuée de sens commun, et perpétuellement plongée dans un brouillard souvent auto-généré…mais si nous demandions a ces mêmes milles personnes de décrire en quelques mots un survivaliste, nous aurions sans doute ici une ébauche beaucoup plus uniforme, beaucoup plus palpable et dirigée.
Les mots clés de cette direction ?
- Armes
- Fin du monde
- Peur
- Guerre atomique
- Zombies
- Asociale
- Solitaire
- Bunker
- Malade
- Extra terrestre
- Eruption solaire
- Complot
- 2012
- Farfelu
- Paranoïaque
- Masque a gaz
etc.
Malheureusement pour nous, force est de constater qu'il nous est encore impossible d'échapper a ces associations parfois démoralisantes, tant ces trajectoires transpirent encore plus ou moins maladroitement aux travers de survivalistes pour la plupart victimes de leur propres uni-vers…victimes de leurs propres limites intellectuelles, et inévitablement, consciemment ou non, complices du malentendu ambiant.
Car soyons honnête, l'image du survivaliste, et même si soigneusement malaxée et entretenue par la bulle médiatique, est principalement définie par l'émanation que nous, les survivalistes, projetons sur le monde.
C'est donc principalement sur ce champs de bataille souvent abstrait, sur cet échiquier "mentalisé" et imbibé de tendances plus ou moins douteuses, que la totalité de mon travail repose.
Il n'est bien sur pas question pour moi de redéfinir le survivalisme, cette tache ne peut être que collective, mais bien de rendre possible ici l'alchimie du malentendu premier, c'est a dire la transformation des mots clés servant aujourd'hui a définir le survivaliste.
Les nouveaux mots clés ?
- Indépendance
- Résilience
- Autonomie
- Intelligence
- Prévoyance
- Entraide
- Harmonie
- Enracinement
- Adaptation
- Liberté
- Responsabilité
- Cohérence
- Clan
- Durabilité
- Mais aussi "fais pas chier"
Cette transformation des mots clés, des mots gouvernants et fondateurs, est pour moi nécessaire, car le survivaliste d'hier (au sens propre comme au sens figuré), vestige d'une époque et d'un raisonnement précis dans sa manière de vivre le monde, ne peut représenter a lui seul la diversité et la pertinence de notre démarche d'indépendance, d'autonomie et de résilience…
De plus, il me semble important, et surtout dans la jungle actuelle, de réaliser que notre travail de sensibilisation se doit non pas d'être entendu par le plus grand nombre (quantité), mais se doit d'être le plus logique et raisonné possible (qualité).
La bonne nouvelle est que le survivalisme a évolué et évolue encore.
Majoritairement, les survivalistes ne sont plus ces individus en marge perdus au fin fond de l'Idaho Américain, et habités d'une démarche exclusivement axée sur le retranchement bunkarisé, ou encore calculée sur une inévitable apocalypse…non, majoritairement, les survivalistes sont aujourd'hui ces parents par exemple, qui sensibilisés par la santé d'une économie mondiale basée sur la dette, et le risque de plus en plus probable d'une simple perte de l'emploi a la maison ou d'une austérité soudaine, se penchent, entre autre, sur une gestion du foyer nous rappelant celle de nos aïeux, et axée sur le stockage de produits régulièrement consommés, et la consommation de produits régulièrement stockés.
Ce sont aussi ces millions d'individus, de familles et de clans, qui s'investissent dans la production de nourriture, dans la récupération des eaux de pluies, dans le recyclage et la réparation, dans la prise en main intelligente de leur propre sécurité, dans l'indépendance énergétique quelle qu'elle soit, dans l'économie locale et surtout, dans un consumérisme intelligent qui n'est pas celui de "l'objet plaisir", mais bien celui de "l'objet utile", si chère a nos ancêtres.
Les survivalistes, aujourd'hui, sont tout simplement vous et moi.
Ce consumérisme intelligent évoqué plus haut, trop souvent amalgamé par manque de compréhension et de logique a son rejeton modernistique le consumérisme compensatoire (et oui, un poêle a bois est utile, tout comme un jerrican, une trousse de premiers soins, une casserole en fonte ou un bon couteau), est sans aucun doute l'une des pierres fondatrice du malentendu qui sépare le survivaliste de ces concitoyens, et qui vient ajouter a cette image d'un individu ne pouvant être qu'égoïste et sur un axe psychologique névrosé de repli sur soi.
Sans glisser dans le fatalisme ou le catastrophisme, ce qui est loin d'être ma tasse de vin, il me parait évident que nous n'avons plus le luxe ni le temps de prétendre que notre monde est en bonne santé, que nos ressources sont intarissables ou que notre drogue première, le pétrole bon marché, ne peut avoir, a court, moyen ou long terme, un impact décisif sur nos modes de vie si celui-ci venait a manquer.
Cette santé globale, tant écologique qu'économique, tant politique que sociale, pour la moins fragile et ceci depuis des décennies, est peut être la source même d'une multitude de comportements pouvant paraître plus ou moins radicaux et farfelus selon notre niveau de tolérance…et en ce sens, il est difficile de vraiment savoir si la démarche intériorisée par ce que nous nommons librement ici "le survivaliste", vient de son propre univers interne, ou si elle n'est pas simplement le reflet et l'ébauche d'une réponse plus ou moins adaptée a une réalité difficilement dissimulable aujourd'hui.
Quelle que soit la source du malaise ambiant, interne, externe ou les deux, il me semble important de garder a l'esprit que même si certains survivalistes cultivent et s'obstinent a vendre une image complice du racolage médiatique ambiant: fin du monde, apocalypse, 2012, complotisme etc…l'énorme majorité des survivalistes / preppers, c'est a dire des millions d'individus de tout horizons sociaux, culturels et économiques, de tout âge et de tout sexe, de toutes philosophies, sont simplement des gens a l'écoute des problématiques globales aujourd'hui évidentes, et travaillant a des solutions de plus en plus locales, de plus en plus primordiales, et de ce fait se donnant les moyens d'influencer leur niveau d'indépendance, d'autonomie et de résilience face a une "machine" de plus en plus instable et incertaine.
Nous sommes ici très loin de ce survivaliste "camouflé", sa boite de quenelles sous l'épaule, armé de son fusil, de son Berger Allemand et prêt a devenir le sauveur-vérité d'une humanité séquestrée dans le gouffre de sa déchéance moralisatrice…nous ne pouvons raisonnablement pas avoir cette prétention, mais cet axe est pourtant sous-jacent chez quelques survivalistes en mal d'attention…et au passage, ce sont souvent ces mêmes individus qui sont toujours les premiers a entraver, refuser ou rejeter l'un des piliers fondamental de la survie qu'est le lien social et l'idée de réseau.
Soyons tranchant. C'est la totalité de ces frustrations incomprises et ce syndromes du "Je suis une légende", chère a la machine hollywoodienne, qu'il nous faut ici combattre…et il me parait évident qu'une grande partit de cette caricature découle invariablement d'un manque de maturité intrinsèque chez certains.
On me contacte souvent pour justement raconter et définir ce survivaliste "légende"…comme si ma démarche pouvait objectivement être associée a la quelconque gourmandise d'un pouvoir ou d'une attention préméditée, a la quelconque gourmandise d'un trône unique.
Comme si ma philosophie tendait a redécouvrir et bourgeoisement m'amuser de quelques gestes anciens pour combler une peur systémique de ne pouvoir être a la hauteur de ma virilité dans un futur ou mon rang social, ma profession, mon compte en banque, mes rentes ou la marque de ma voiture n'aurait plus aucun poids, plus aucune valeur.
Le problème de l'image du survivaliste est simplement que celle-ci est systématiquement construite et maintenue en place par l'utilisation d'individus type ne pouvant rien offrir d'autre qu'un "témoignage reflet" des mots clés désignés par la stupidité ambiante comme étant la nature même du survivalisme et de la responsabilisation individuelle, familiale, clanique mais aussi collective.
On ne me demande jamais par exemple de parler de l'organisation prévoyante et assurément survivaliste des écoles américaines, qui dans leurs cours d'écoles ou leurs caves stockent des provisions, de l'eau, des couvertures et de l'équipement dans des conteneurs maritimes pour assurer leurs enfants a charge une certaine autonomie dans le cadre d'un événement dramatique.
On ne me demande jamais de parler de la campagne de sensibilisation de la croix rouge, avec a sa tête l'actrice Jamie Lee Curtis, pour encourager le publique a préparer un kit de survie familiale, en mettant en place un plan (et donc en formulant certaines préoccupations), en stockant de l'eau, de la nourriture, des médicaments et de l'énergie…car exposer ne serait-ce que l'idée d'une responsabilité individuelle qui n'est pas systématiquement liée a l'apocalypse, et donc prenant sa source dans la raison et non l'émotion, dans la logique et non l'imaginaire complexé, pourrait sous-entendre que le citoyen est, au final, foncièrement responsable de sa propre vie, de son propre destin, et non l'Etat ou le voisin.
Notre responsabilité doit être totale et résolue.
Totale dans la gestion de votre cercle d'influence immédiat, car vous seul êtes aux premières lignes, et résolue car personne au monde ne va considérer votre vie ou la vie de vos proches comme vous allez la considérer…et c'est sur cette intime et humble compréhension que l'image du survivaliste devrait se construire, et non sur les ruines d'un monde post-apocalyptique.
Volwest (Le survivaliste, 26 septembre 2012)