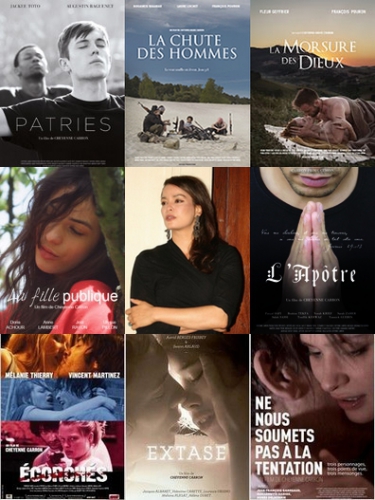Le clivage droite/gauche est-il mort ?
Emmanuel Macron a présenté sa démission à François Hollande, qui l'a acceptée. L'ancien ministre de l'économie va se consacrer à son mouvement «En marche» et préparer une éventuelle candidature à la présidentielle. Il entend dépasser le clivage droite/gauche. Est-ce le début de la fin de ce que vous appelez une «mystification antidémocratique»?
À l'évidence Monsieur Macron a des atouts dans son jeu. Il est jeune, intelligent, il apprend vite et il n'est pas dépourvu de charisme et de charme. Il a en outre eu la bonne idée de créer une petite structure, En Marche ce que n'avait pas pu, su, ou voulu faire en son temps Dominique de Villepin. Mais si un «mouvement» ou -pour être plus exact - une simple association de notables peut jouer un rôle de parti charnière, et in fine obtenir un ou deux portefeuilles ministériels, je ne crois pas qu'elle puisse suffire pour positionner sérieusement un leader comme candidat crédible à la présidentielle de 2017. Sous la Ve République, seuls les chefs de grands partis, ceux qui en contrôlent les rouages, ont des chances de succès. On voit mal comment dans un parti socialiste aux mains de vieux éléphants un consensus pourrait se dégager spontanément autour de quelqu'un dont le style et les idées ne sont appréciés ni des barons, ni de la majorité des militants. Mais en politique il ne faut exclure aucune hypothèse. Macron est un politicien, sinon chevronné, du moins déjà expérimenté. Il connaît très bien la magie des mots. Il a dit et laisser dire qu'il souhaitait dépasser le clivage droite/gauche et qu'il n'était pas socialiste (après tout il semble qu'il ne l'ait été, comme membre du Parti socialiste, que de 2006 à 2009… à l'époque où il était encore banquier d'affaires). Il s'est réclamé récemment de Jeanne d'Arc flattant à peu de frais un certain électorat de droite toujours sensible aux envolées lyriques devant un des symboles de la nation. Le jour de sa démission, il a précisé qu'il n'avait jamais dit qu'il était «ni de droite, ni de gauche», ce qui d'ailleurs ne lui a rien coûté car cette double négation ne veut pas dire grand-chose. Sans doute eût-il été plus honnête et plus correct d'affirmer devant les français: «je ne suis pas simultanément de droite et de gauche». Cela dit, il s'est aussi déclaré dans le camp des progressistes contre celui des conservateurs. J'imagine sans peine que forcé de nous expliquer ce que sont pour lui les progressistes et les conservateurs, il ne manquerait pas de nous asséner quelques lieux-communs sur les prétendus partisans du progrès, de la raison, de la science, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité face aux immobilistes, aux réactionnaires et aux populistes. Je dirai que Macron est un énième remake de Tony Blair, Bill Clinton et Gerhard Schröder. N'oublions pas que ces vedettes politiques de l'époque cherchaient à s'approprier, par-delà les clivages de droite et de gauche, la capacité de mobilisation de la «troisième voie».
Le système des primaires est-il un moyen de faire perdurer cette «mystification»?
Oui! bien évidemment. Il y a en fait une double mystification antidémocratique. Il y a d'abord celle de la division droite / gauche, à laquelle je me réfère dans mon livre. C'est celle que José Ortega y Gasset qualifiait de «formes d'hémiplégie morale» dans La révolte des masses déjà en 1929. C'est aussi celle dont Raymond Aron disait qu'elle reposait sur des «concepts équivoques» dans L'opium des intellectuels en 1955 (Je fais d'ailleurs un clin d'œil admiratif à son œuvre dans l'intitulé de mon livre). Cette dichotomie a été également dénoncée ou critiquée par de nombreuses figures intellectuelles aussi différentes que Simone Weil, Castoriadis, Lasch, Baudrillard ou Gauchet et, elle l'a été plus récemment par une kyrielle d'auteurs. Mais il y a aussi une seconde mystification antidémocratique qui affecte directement les partis politiques. Ce sont les leaders et non les militants qui se disputent le pouvoir. À l'intérieur des partis la démocratie est résiduelle, elle exclut la violence physique mais pas la violence morale, la compétition déloyale, frauduleuse ou restreinte. Il y a bien sûr des partis plus ou moins démocratiques qui parviennent à mitiger et à contrôler les effets de leur oligarchie mais s'ils existaient en France, en ce début du XXIe siècle, je crois que ça se saurait.
L'opposition droite/gauche peut-elle vraiment se résumer à un «mythe incapacitant»? Comme le souligne Denis Tillinac, ces deux courants ne sont-ils pas, malgré tout, irrigués par un imaginaire puissant dans lequel les électeurs se reconnaissent?
Il ne s'agit pas d'essences inaltérables. Je ne crois pas qu'il y ait «des valeurs permanentes de droite» et des «principes immortels de gauche». Il n'y a pas d'opposition intangible entre deux types de tempéraments, de caractères ou de sensibilités. Il n'y a pas de définitions intemporelles de la droite et de la gauche. Denis Tillinac nous parle de deux courants qui seraient «irrigués par un imaginaire puissant». Mais un imaginaire forgé par qui? Par les Hussards noirs de la République et les Congrégations religieuses? Et depuis quand? Depuis 1870, depuis1900 voire depuis 1930 nous répondent les historiens.
Je n'ignore pas bien sûr le point de vue des traditionalistes. Je sais que pour les traditionalistes être de droite ce n'est pas une attitude politique mais une attitude métaphysique. Je sais qu'ils considèrent que la gauche s'acharne à réduire l'homme à sa mesure sociale et économique. Que pour eux la droite et la gauche sont caractérisées par deux positions métaphysiques opposées: la transcendance et l'immanence. Ils sont les défenseurs d'une droite idéale, sublime, transcendantale ou apothéotique, celle que les partisans de la religion républicaine, d'essence totalitaire, Robespierre et Peillon, vouent perpétuellement aux gémonies.
Pour ma part, en me situant sur les plans politique, sociologique et historique, je constate que les chassés croisés idéologiques ont été multiples et permanents. Je peux citer ici le nationalisme, le patriotisme, le colonialisme, l'impérialisme, le racisme, l'antisémitisme, l'antichristianisme, l'antiparlementarisme, l'anticapitalisme, le centralisme, le régionalisme, l'autonomisme, le séparatisme, l'écologisme, l'américanophilie/américanophobie, l'europhilie/europhobie, la critique du modèle occidental, l'alliance avec le tiers-monde et avec la Russie, et bien d'autres exemples marquants, qui tous échappent à l'obsédant débat droite/gauche. Il suffit de s'intéresser un minimum à l'histoire des idées pour se rendre compte très vite que les droites et les gauches ont été tour à tour universalistes ou particularistes, mondialistes ou patriotiques, libre-échangistes ou protectionnistes, capitalistes ou anticapitalistes, centralistes ou fédéralistes, individualistes ou organicistes, positivistes, agnostiques et athées ou théistes et chrétiennes. Un imaginaire puissant dans lequel les électeurs se reconnaissent? Non! je dirais plutôt, avec le marxologue Costanzo Preve, que ce clivage est «une prothèse artificielle».
Selon vous, un nouveau clivage politique oppose désormais le local au mondial, les enracinés aux mondialisés…
J'avoue que la lecture de la philosophe Simone Weil m'a profondément marqué dans ma jeunesse. Elle a su brillamment démontrer que la dyade vecteur du déracinement / soutien de l'enracinement, explique la rencontre durable ou éphémère entre, d'une part, des révolutionnaires, des réformistes et des conservateurs, qui veulent transformer la société de manière que tous ouvriers, agriculteurs, chômeurs et bourgeois puissent y avoir des racines et, d'autre part, des révolutionnaires, des réformistes et des conservateurs qui contribuent à accélérer le processus de désintégration du tissu social. Elle est incontestablement une «précurseuse». Depuis le tournant du XXIe siècle nous assistons en effet à une véritable lutte sans merci entre deux traditions culturelles occidentales: l'une, est celle de l'humanisme civique ou de la République vertueuse ; l'autre, est celle du droit naturel sécularisé de la liberté strictement négative entendue comme le domaine dans lequel l'homme peut agir sans être gêné par les autres. L'une revendique le bien commun, l'enracinement, la cohérence identitaire, la souveraineté populaire, l'émancipation des peuples et la création d'un monde multipolaire ; l'autre célèbre l'humanisme individualiste, l'hédonisme matérialiste, le «bougisme», le changement perpétuel, l'homogénéisation consumériste et mercantiliste, l'État managérial et la gouvernance mondiale sous la bannière du multiculturalisme et du productivisme néocapitaliste.
Le général De Gaulle savait qu'on ne peut pas défendre réellement le bien commun la liberté et l'intérêt du peuple, sans défendre simultanément la souveraineté, l'identité et l'indépendance politique, économique et culturelle. Passion pour la grandeur de la nation, résistance à l'hégémonie américaine, éloge de l'héritage européen, revendication de l'Europe des nations (l'axe Paris-Berlin-Moscou), préoccupation pour la justice sociale, aspiration à l'unité nationale, démocratie directe, antiparlementarisme, national-populisme, ordo-libéralisme, planification indicative, aide au Tiers-monde, telle est l'essence du meilleur gaullisme. Où voyez-vous les gaullistes aujourd'hui? Henri Guaino? qui est peut être l'héritier le plus honnête? Mais combien de couleuvres a déjà avalé l'auteur des principaux discours du quinquennat de «Sarko l'Américain»?
La chute du mur de Berlin a-t-elle mis fin à ce clivage?
Souvenez-vous de ce que disait le philosophe Augusto del Noce peu de temps avant la chute du mur de Berlin: «le marxisme est mort à l'Est parce que d'une certaine façon il s'est réalisé à l'Ouest». Il relevait de troublantes similitudes entre le socialisme marxiste et le néo-libéralisme sous sa double forme sociale-libérale et libérale-sociale, et citait comme traits communs: le matérialisme et l'athéisme radical, qui ne se pose même plus le problème de Dieu, la non-appartenance universelle, le déracinement et l'érosion des identités collectives, le primat de la praxis et la mort de la philosophie, la domination de la production, l'économisme, la manipulation universelle de la nature, l'égalitarisme et la réduction de l'homme au rang de moyen. Pour Del Noce l'Occident avait tout réalisé du marxisme, sauf l'espérance messianique. Il concluait à la fin des années 1990 en disant que ce cycle historique est en voie d'épuisement, que le processus est enfin devenu réversible et qu'il est désormais possible de le combattre efficacement. Je me refuse à croire que la décomposition actuelle nous conduit seulement à la violence nihiliste. Je crois et j'espère qu'elle est le signe avant-coureur du terrible passage qu'il nous faudra traverser avant de sortir de notre dormition.
Arnaud Imatz, propos recueillis par Alexandre Devecchio (Figaro Vox, 4 septembre 2016)