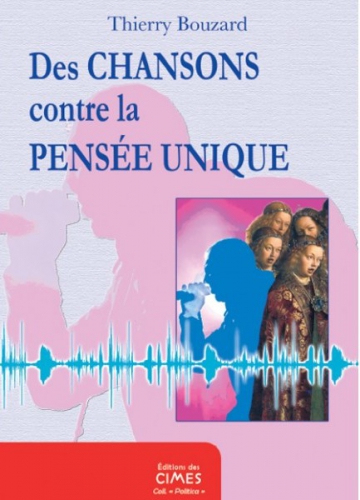Pierre Le Vigan : « La postmodernité, c’est l’excès inverse de la modernité »
PHILITT : Vous avez édité cette année, un ouvrage intitulé Soudain la postmodernité (La Barque d’or). D’où vient ce terme, « postmodernité » ?
Pierre Le Vigan : Je ne connais pas l’origine exacte du terme. Ce qui est certain, c’est que Jean-François Lyotard a beaucoup contribué à diffuser le thème de la postmodernité. La notion de postmodernité désigne ce qui vient après la modernité, donc ce qui vient après le culte du progrès, le culte de l’homogénéité, de l’égalité, du jacobinisme. La postmodernité est ce qui vient après les grands récits historiques, tels le communisme, la social-démocratie, le fascisme, qui n’ont été qu’une brève parenthèse, et d’une manière générale, redisons-le, après la religion du progrès. Il y a bien sûr des éléments de postmodernité dans les temps actuels, mais il y a aussi des éléments qui relèvent en fait de l’intensification de la modernité. Prenons l’exemple de la théorie du genre : en un sens, on peut croire qu’elle valorise les différences entre les sexes en mettant en lumière leur dimension culturelle, en un autre sens, elle les minimise puisque avant d’appartenir à un sexe, nous serions en quelque sorte sans détermination et choisirions « librement » notre genre. Le genre prétendument choisi serait plus important que la sexuation héritée. Sur le fond, en fait, la théorie du genre pousse à l’extrême et jusqu’à l’absurde le constructivisme. Or, le constructivisme est un élément de la modernité. Il est pourtant bien évident que la France déjà moderne des années 1960 était à des années-lumière de la théorie du genre. Tout dépend donc du niveau où l’on situe l’analyse. S’agit-il de l’histoire des idées ? De leur généalogie ? Ou sommes-nous au contraire dans le domaine de la sociologie historique ? Il faut à chaque fois préciser quel est le niveau d’analyse choisi. Ce qui est certain, c’est que, sous couvert d’apologie des différences, nous vivons, comme le voyait déjà Pasolini il y a plus de quarante ans, dans « un monde inexpressif, sans particularismes ni diversités de cultures, un monde parfaitement normalisé et acculturé » (Écrits corsaires).
Comment définir, ou du moins comment situer, la « postmodernité » par rapport à la « prémodernité » et à la « modernité » ?
Votre question me permet de préciser un point. J’ai expliqué que la postmodernité était avant tout la fin des grands récits, et surtout du récit du progrès sous ses différentes formes (qui incluaient par exemple le nazisme, qui était un darwinisme social et racial « progressiste » puisqu’il voulait « améliorer la race »). Sous une autre forme, qui amène à en souligner les aspects néfastes, la postmodernité c’est aussi l’excès inverse de la modernité. C’est le présentisme, c’est la jouissance (je n’ai rien contre, mais elle doit avoir sa place, rien que sa place) contre la raison, c’est le laisser-aller (l’esprit « cool ») contre l’effort, c’est l’informe contre la tenue. Voilà la question que pose la postmodernité : si on ne croit plus au progrès, qu’est ce qui nous fait tenir debout ? Nous : je veux dire nous en tant qu’individus, et il faudrait dire en tant que personne humaine, mais aussi nous en tant que peuple. C’est là qu’intervient la référence à la pré-modernité. Si on prend comme exemple de moment de pré-modernité la période du Moyen Âge, avant le culte du progrès, mais aussi avant le culte de l’homme, et en fait avant le culte de la puissance et surpuissance de l’homme, la pré-modernité faisait se tenir debout les hommes par la religion, et en l’occurrence par le christianisme (je parle bien sûr de l’Europe). Cela amène bien sûr à relever qu’il y eut plusieurs pré-modernités, précédant elles-mêmes plusieurs modernités. Les modernités des pays catholiques et des pays protestants n’ont ainsi pas tout à fait été les mêmes.
Il est certain que la postmodernité ne peut qu’avoir des points communs avec certains aspects de la pré-
modernité. On pourrait espérer, au lieu du culte du présent, une attention au présent, au lieu d’un enlisement dans le présent, la recherche d’une transcendance dans l’immanence. Le dépassement de la modernité a bien des aspects positifs. Qui peut regretter le nationalisme agressif entre peuples européens qui a mené aux guerres du XXème siècle ? Mais qui peut sérieusement penser que ce dépassement d’un certain nationalisme doive amener à nier tous les enracinements, toutes les mémoires historiques ? Il faut redécouvrir toutes les communautés, dont certaines ont été broyées par un nationalisme (plus exactement un stato-nationalisme) niveleur mais il ne faut pas pour autant se défaire des constructions nationales qui figurent parmi les réalisations les plus belles du politique en Europe. Autant, par exemple, je suis pour l’autonomie de la Catalogne, autant je suis hostile à sa sécession d’avec l’Espagne.
Vous écrivez que la seule libre-circulation dont ne veut pas le libéralisme, c’est la libre-circulation des idées (p. 32). Comment expliquer que l’actuel triomphe du libéralisme s’accompagne d’un recours étatique à la censure ?
L’intolérance actuelle du pouvoir, et plus largement du système face à tout ce qui relève de l’indépendance d’esprit et face à tous les propos non consensuels est d’un niveau assez stupéfiant. L’intolérance des hommes du système est, à beaucoup d’égards, proportionnelle à leur inculture. Il y a aussi un formidable formatage des esprits, qui va du plus haut niveau à tous les cadres intermédiaires de la société. Dans les faits, le libéralisme économique se développe sur fond de libéralisme politique. Ce libéralisme politique est une démocratie purement procédurale qui est de moins en moins démocratique. Le peuple ne peut se prononcer sur les sujets importants et, plus encore, quand il se prononce, on ne tient pas compte de son avis. Ce « règne de l’On » est en fait le règne de l’hyperclasse. Cette dernière mène une guerre de classe contre le peuple. En matière de relations internationales, nous sommes face à un système à tuer les peuples, qui s’appuie sur les États-Unis et ses relais, dont malheureusement la France, parfois même à l’avant-garde de l’atlantisme belliciste et déstabilisateur. Au plan intérieur, institutionnel et politique, nous avons un système à tuer le peuple, basé sur le mépris de celui-ci. Ce sont les deux faces d’un même système.
« L’écologie poussée jusqu’au bout amène inévitablement à deux rejets. Rejet du libre-échangisme économique, rejet de l’immigration de masse » (p. 31). N’est-il pas pourtant en vogue, dans le monde de l’entreprise et au sein de la politique française, de parler d’« écologie », de « développement durable » ?
Le développement, c’est une façon de dire « toujours plus ». C’est souvent le cache-sexe de la pure et simple course aux profits. Si on souhaite un développement vraiment durable, il y a des choses à ne pas développer, par exemple le développement de l’automobile. C’est la contradiction du terme « développement durable ». Il faut donc demander aux partisans du développement durable ce qu’ils veulent vraiment développer. S’agit-il des systèmes d’échanges locaux ? Nous serons alors d’accord. S’agit-il des biens collectifs qui échappent à la marchandisation ? Très bien. S’agit-il de développer toujours plus de routes qui éventrent les paysages ? Ou de stupides créations d’aéroports inutiles ? Alors non. Faut-il toujours plus de smartphones ? Toujours plus d’informatisation de tous les processus de décision ? Encore non.
Prenons l’urbanisme comme exemple. Une ville durable, ce n’est pas forcément une ville qui se « développe », ce peut être une ville qui se stabilise, qui améliore ses équilibres. La notion de développement durable est donc ambiguë. Il faut pousser ses partisans dans leurs retranchements et les amener à reconnaître, s’ils sont de bonne foi, qu’il y a des choses à ne pas développer.
Quant à l’écologie, tout le monde est pour. C’est comme la santé et la bonne humeur : comment ne pas être pour ? Mais, concrètement, les gens qui se réclament de l’écologie sont pour l’immigration de masse. Alors, que se passe-t-il ? L’écologie s’appliquerait aux petits oiseaux, mais pas aux hommes ? (La critique de l’immigration qui est la nôtre ne saurait occulter ce que nous pensons être les responsabilités énormes de l’Occident dans le chaos au Proche-Orient et donc dans les flux migratoires vers l’Europe, et cela a commencé dès la première guerre du Golfe déclenchée après le rattachement de la « 19ème province », le Koweït à l’Irak, un piège, sous beaucoup d’aspects, tendu à l’Irak).
Revenons à l’immigration, qui n’est qu’un des aspects des équilibres humains, de l’écologie humaine et de l’éthologie humaine. Le respect des équilibres s’appliquerait à la nature mais pas aux hommes, qui pourtant ne cessent d’agir sur la nature ? L’écologisme des « Verts » n’a ainsi guère de rapport avec l’écologie. La thèse du réchauffement climatique anthropique (dû à l’homme) n’est elle-même pas prouvée. L’écologie officielle sert en fait de nouveau totalitarisme et d’instrument de contrôle social renforcé. Il est pourtant parfaitement exact que l’homme détruit ou abîme son propre environnement mais ce ne sont pas les écologistes, le GIEC ou les gouvernements qui « font de l’écologie » une sauce additionnelle à leur prêchi-prêcha culpabilisateur et moralisateur qui aideront à trouver des solutions. Il leur faudrait d’abord rompre avec le culte du progrès et de la croissance, et avec une vision de l’homme qui est fausse car les écologistes ne croient pas qu’il existe des différences entre les peuples : les écologistes, tout comme nos libéraux et socio-libéraux, pensent que les hommes et les peuples sont parfaitement interchangeables.
Or, avant de vouloir sauver l’homme et la planète, il faudrait commencer par les comprendre. Les écologistes, tout comme nos gouvernements mondialistes, pensent que les hommes sont tous pareils. Leur vision du monde est une vision de touriste. Pourquoi ne peut-on pas s’installer dans n’importe quel pays, de même que quand on part en voyage on regarde le catalogue ou le site adéquat ou autre et on coche la case « soleil », « bain de mer », etc. Croire que les migrations relèvent de la « liberté » est la dernière des imbécillités. Les migrations ont toujours été essentiellement des actes de guerres. Croit-on que les Allemands des Sudètes ont quitté leur pays en 1945 parce que les paysages bavarois sont plus gais, ou que les dancings de Munich sont d’un standing supérieur à ceux de Pilsen ? C’était parce qu’ils avaient le choix entre l’expulsion ou le massacre. Croit-on que les Juifs ont quittés l’Allemagne en 1933 par simple fascination pour l’Amérique ? Ou bien plutôt parce qu’on (les nazis) voulait les réduire à la misère, à l’humiliation, au suicide ou à la déportation ?
Vous écrivez que vous avez souvent été considéré « comme un homme de gauche par les gens de droite et comme un homme de droite par les gens de gauche » (p. 85). Est-ce là pur esprit de contradiction ou bien assiste-t-on à un effacement du clivage gauche-droite ?
Esprit gratuit de contradiction : non. Goût de la complexité, oui. « La complexité est une valeur », écrit Massimo Cacciari. J’aime avant tout les nuances. Quant aux contradictions, il peut être fécond de les creuser si elles permettent d’arriver à une synthèse de plus haut niveau. Je crois au juste milieu non comme médiocre moyenne mais comme médiété. C’est ce qu’Aristote appelait : éviter l’excès et le défaut. Telle est la vertu selon Aristote. Ainsi, le courage n’est ni la témérité (l’excès) ni la lâcheté (le défaut). Mais le stagirite expliquait que l’opposé du courage reste néanmoins la lâcheté – et non la témérité.
Les notions de droite et de gauche n’ont cessé d’évoluer. C’est un clivage qui a toujours été mouvant. Aujourd’hui, ce qui est très clair, c’est que c’est un rideau de fumée. Droite et gauche sont d’accord sur l’essentiel : l’Europe du libre-échange et du dumping social, le partenariat privilégié avec les États-Unis, l’antirussisme primaire, la société de marché, l’idéologie des droits de l’homme contre le droit des peuples et l’immigrationnisme forcené. C’est en fait une fausse droite qui fait face à une fausse gauche. Les deux en sont au degré zéro de la pensée. Fausse droite et fausse gauche partagent la même croyance que l’Occident peut continuer à fabriquer de l’universel seul dans son coin et à l’imposer au reste du monde.
Tous les intellectuels qui pensent vraiment finissent par se fâcher avec le système politico-médiatique. Alors, celui-ci les exclut au motif de pensées « putrides », d’arrières-pensées encore plus « nauséabondes », d’appartenance à la « France moisie », de « relents de pétainisme », de statut d’ « ennemis de l’avenir » (Laurent Joffrin) et autres anathèmes. Michel Onfray, Jean Claude Michéa, Alain Finkielkraut, Alain de Benoist et d’autres sont mis dans le même sac, ce qui dispense de les lire. Or, ces intellectuels sont très différents. Ils ont comme seul point commun d’essayer de penser vraiment les problèmes même s’ils arrivent à des conclusions qui ne sont pas conformes à l’irénisme dominant : les richesses des cultures qui « se fécondent mutuellement » en se mélangeant, les « bienfaits de la diversité », les vertus d’un « vivre-ensemble » toujours plus épanouissant, le bonheur de la société « inclusive », etc. Michel Onfray est ainsi accusé d’avoir « viré à droite ». Cela ne devrait pas être une accusation mais une hypothèse non infamante en soi, relevons-le. Mais, au demeurant, c’est faux. Michel Onfray a toujours été un libertaire et il n’a pas changé. C’est toujours au nom des mêmes idées qu’il se heurte désormais aux esprits étroits du système, notamment depuis qu’il a relevé les responsabilités de Bernard-Henri Lévy dans le désastre libyen dont l’une des conséquences est le déferlement migratoire. Les propos de Michel Onfray sont dans le droit fil de sa conception du rôle de l’intellectuel, conception qu’il a notamment développée dans son livre sur Albert Camus, mais aussi dans nombre de chapitres de sa Contre-histoire de la philosophie.
Plutôt qu’une fausse droite et une fausse gauche, j’aimerais voir une vraie droite et une vraie gauche. Mais je crois aussi que les vraies droites sont toujours quelque peu de gauche à leur façon (voir Bernanos), tandis que les vraies gauches sont en un sens aussi de droite (voir Auguste Blanqui ou Georges Sorel).
Surtout, la vraie question me parait être de sortir de l’abjection anthropologique qu’est la modernité, et sa version récente l’hypermodernité. Le « chacun dans sa bulle », avec son oreillette et son smartphone me parait être un recul formidable de l’humain, la joignabilité tout azimut me parait une horreur. Je dis : abjection des temps modernes. De quoi s’agit-il ? Ce sont les gens qui sont appareillés d’oreillettes dans les transports en commun, qui restent les yeux figés sur leur téléphone cellulaire ou sur leur tablette numérique, ce sont les gens qui filment un drame ou une brutalité sans jamais intervenir, ce sont les gens qui ne proposent jamais à un clochard en perdition de l’aider à se relever, ce sont les gens qui veulent bien être témoin mais à condition de ne rien risquer (« Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger », disait Pascal. On voit que nous en sommes loin). Ce sont les hommes de la société de l’insignifiance. En sweat-shirt du nom d’une compagnie aérienne d’un émirat pétrolier, ou en capuche de survêtement, parlant fort dans les transports en commun pour faire profiter tout le monde de leurs préoccupations égotistes, ils représentent le summum du mauvais goût. C’est le tsunami de l’abjection. Faut-il préciser qu’un Africain en habit traditionnel lisant le Coran ne me fait pas du tout la même impression ? Serait-ce là le dernier refuge de l’humanité ? Ce n’est pas le seul. Reste une évidence : le coefficient de modernité est exactement équivalent au coefficient d’abjection.
Cette question de la modernité, postmodernité par rapport aux années soixante et soixante-dix, ou simple hypermodernité, est très liée aux nouvelles formes du capitalisme, analysées par exemple fort bien par Pierre Dardot et Christian Laval. Sortir de l’hypermodernité, ce sera nécessairement aussi sortir du turbocapitalisme. Or, le dépassement du capitalisme ne se fera par les droites telles qu’on les connaît, mais se fera encore moins par la gauche actuelle. Celle-ci est devenue l’avant-garde du turbocapitalisme, elle déblaie le terrain, elle détruit les enracinements, les industries et la classe ouvrière. Elle a détruit les ethos (manière d’être au sens de demeure anthropologique) ouvriers. Elle est pour cela plus efficace qu’aucune extrême-droite n’aurait pu l’être. L’hypermodernité a permis de comprendre ce qu’était la modernité. Marx écrit « L’anatomie de l’homme est une clef pour l’anatomie du singe. Les virtualités qui annoncent dans les espèces animales inférieures une forme supérieure ne peuvent au contraire être comprises que lorsque la forme supérieure est elle-même connue. Ainsi l’économie bourgeoise fournit la clef de l’économie antique » (Introduction à la critique de l’économie politique, 1857). Dans le même temps, l’hypergauche actuelle a permis de comprendre ce qu’était la logique de la gauche : faire la table rase de tout être. Nier toutes différences, faire des nouveaux codes (théorie du genre, nouvel antiracisme négateur des races et des cultures) le contraire de l’histoire, en allant plus loin que Rabaut Saint-Etienne avec sa fameuse formule (« L’histoire n’est pas notre code »). Il s’agit en fait de liquider pour l’Europe la possibilité de faire une quelconque histoire.
La vraie question est donc de comprendre qu’on ne peut dépasser le capitalisme par la gauche (surtout celle de Pierre Bergé). La vraie question est aussi de prendre conscience à la fois que les thèses du GIEC sont biaisées par l’idéologie officielle du réchauffement dû à l’homme, mais que l’homme abîme vraiment la terre, que la pollution est une réalité, la croissance une impasse pour notre environnement, qu’elle détruit et enlaidit. La question est de prendre conscience que, comme dit le pape François, « l’heure est venue d’accepter une décroissance dans quelques parties du monde et d’en finir avec le mythe moderne du progrès matériel sans limite » (encyclique Laudato si’). L’heure est venue de la postcroissance pour une vraie postmodernité qui soit autre chose que l’intensification de la modernité.
La polémique autour des propos de Michel Onfray sur Alain de Benoist a révélé qu’il existe encore une « gauche du non » (Jacques Sapir, Christophe Guilluy, Jean-Claude Michéa…). Qu’en pensez-vous ?
Le phénomène va au-delà d’une « gauche du non » (au référendum sur le traité de 2005). Jean-Claude Michéa est un historien des idées, novateur et important. Jacques Sapir est un géopolitologue, un économiste et d’une manière générale un intellectuel atypique comme il y en a peu. Christophe Guilluy est un sociologue qui apporte un éclairage neuf mais n’est pas un intellectuel généraliste. Michel Onfray est un littéraire et un philosophe touche à tout doué et attachant – quoique, cela n’aura échappé à personne, un peu dispersé. Ce qui est important s’agissant de cette « gauche du non » qui est, plus largement, une gauche rebelle aux séductions de l’hypermodernité capitaliste, c’est de comprendre qu’un certain nombre de dissidents du système (certains l’étaient depuis longtemps et d’autres le sont devenus) commencent à se parler. Leurs réponses ne sont sans doute pas les mêmes mais du moins certains comprennent-ils qu’il n’y a pas de questions tabous.
Il y a un autre élément de reclassement entre les intellectuels : la question de la pauvreté spirituelle de notre temps émerge tout comme la question de la nécessaire préservation des cultures qui consiste à ne pas les noyer dans un grand mélange informe.
Face à la postmodernité, pensez-vous qu’il faille adopter un positionnement conservateur ? Réactionnaire ?
Réactionnaire n’est pas un gros mot. On a le droit, voire le devoir de réagir face à certains processus. Mais réagir ne suffit jamais. Conservateur ? Tout dépend de ce qu’il convient de conserver. Certainement pas le système capitaliste et productiviste. Certainement pas le nouvel ordre mondial dominé par les États-Unis. Certainement pas les orientations internationales de la France depuis trente ans et le retour dans l’Otan. Certainement pas l’Union européenne telle qu’elle est. Il faut conserver le meilleur de la France. Mais existe-t-il encore ? Bien plutôt, il faut le retrouver, le réinventer. En retrouver l’esprit plus que les formes, par nature périssables. Pour conserver le meilleur, il faut révolutionner l’existant. C’est la formule du conservatisme révolutionnaire. Elle me convient bien.
Pierre Le Vigan, propos recueillis par Thomas Julien (Philitt, 7 décembre 2015)