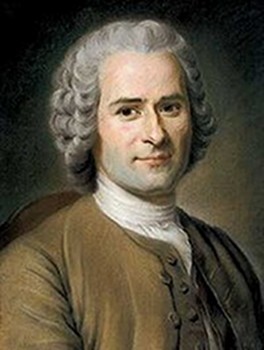Nous reproduisons ci-dessous un article cueilli sur le site Entrefilets et qui constitue une analyse passionnante du système et de ses failles. L'auteur est un ex-journaliste repenti, spécialiste du Moyen-Orient, et propose, au travers de son site, une relecture de l'actualité internationale qui fait l'économie de la narrative officielle.

Essai : de la bataille contre le système
Récemment, un ami ulcéré par une situation dont j’ignore encore aujourd’hui le détail, s’était plongé dans La Guerre de guérilla du Che avec une énergie combattante. Je lui avais alors humblement fait remarquer que l’hyper-puissance technologique et communicationnelle du Système rendait désormais impossible toute révolution par des moyens classiques, fussent-ils aussi honorablement inspirés que ceux du Che, et qu’il fallait plutôt réfléchir à la rédaction d’un nouveau manuel de guérilla qui viserait non plus à l’affrontement armé, mais à un travail de termites en quelque sorte, avec pour objectif l’effondrement du Système sur lui-même, sa dissolution. Pragmatique, il me demanda de lui donner l’ABC de ce nouveau manuel, ce dont je fus bien incapable. Mais cela devait amorcer le texte ci-dessous, où figurent quelques pistes.
La narrative
1. Les démocraties libérales représentent la forme la plus élevée et indépassable des formes possibles d’organisation sociale. Il n’y a pas d’alternative.
2. Les valeurs occidentales sont le fruit d’un héritage historique obtenu de haute lutte après des siècles de barbarie. Ces valeurs sont les plus élevées qui soient, les plus respectueuses et bénéfiques pour les collectivités et les individus.
3. L’Occident est soucieux de permettre à tous les peuples de la terre de sortir de la pauvreté et d’accéder à la liberté grâce à la promotion de son modèle démocratique.
4. L’Occident œuvre pour la paix dans le monde.
5. L’évolution de notre civilisation tend toujours vers le mieux.
6. Le capitalisme et son économie de marché ne sont pas parfait, mais ils sont perfectibles et sont de toute façon le seul modèle viable, il n’y a pas d’alternative.
Les quelques énoncés ci-dessus sont a priori indiscutables. Ils résument à peu de chose près le regard que portent sur eux-mêmes les Occidentaux. L’homos-occidentalus moyen adhère à ces « évidences » avec l’intime conviction d’être le dépositaire d’un héritage glorieux, convaincu que « sa » civilisation est lumière dans les ténèbres du monde. Il est persuadé que cette conviction est le fruit de sa raison, d’une libre pensée nourrie de sa propre observation et de son analyse.Or ces énoncés sont au mieux contestables, au pire faussaires. Car si le glorieux héritage invoqué ici n’est bien sûr pas sans fondement, l’Occident est aujourd’hui prisonnier d’un Système (américaniste, occidentaliste, anglo-saxon comme on voudra, mais que par commodité nous ne nommeront ici que par le terme générique de « Système ») qui instrumentalise désormais ses idéaux dont il ne conserve que les slogans après en avoir détruit la substance.
Passage en revue.
La narrative à l’épreuve du réel
- La démocratie-libérale, modèle indépassable Dans l’écrasante majorité des démocraties occidentales, le régime en place, idéal sur le papier, est un leurre où deux ailes d’un parti unique simulent l’affrontement des idées. Le peuple est donc l’otage d’un simulacre de démocratie. Dans les faits, chaque camp gouverne sous la dictature des marchés, se pliant aux lois d’un Système régi par les seules lois darwiniennes de l’économie.
- Les valeurs occidentales sont les plus élevées qui soient C’est faire peu de cas des ravages de la colonisation et de l’esclavagisme, ces deux sanglantes mamelles qui ont permis hier à l’Occident de financer son industrialisation et qui lui permettent, aujourd’hui encore, de financer son train de vie puisque toutes deux n’ont fait qu’évoluer sans disparaître. Grâce à la globalisation, le Système permet en effet aujourd’hui à l’Occident de faire travailler ses esclaves dans leur pays d’origine, et l’OMC, le FMI ou la BM assurent la poursuite d’une colonisation sans faille des pays en voie de développement par un mécanisme d’endettement forcé.
- L’Occident soucieux de la pauvreté et de la liberté des peuples Là encore, les faits démentent la narrative puisque l’Occident continue à piller les richesses naturelles des pays pauvres tout en leur refusant un commerce équitable, ce qui a pour effet premier de bloquer leur développement et d’accroître leur pauvreté. Les multinationales ont fait main-basse sur « l’agro-business », affamant des régions entières pour maximaliser leur profit (prise en otage des paysans grâce aux OGM, monocultures intensives, rachat de concessions d’eau qu’on laisse à l’abandon pour forcer l’achat d’eau en bouteilles etc. etc Notons encore que l’essentiel des capitaux qui tournent autour de l’agro-business sont spéculatifs.). Le Système maintient ainsi artificiellement et à dessein l’essentiel de la planète dans la pauvreté pour garantir sa richesse. De plus, puisqu’il se pense universaliste, le Système est un formidable destructeur de cultures. Il assimile, nivelle, dissous les identités et les spécificités culturelles, les dilue, les absorbe, les digère, les uniformise, les reformate.
- L’Occident œuvre pour la paix dans le monde Rien n’est plus faux. Les seules boucheries de masse perpétrées depuis 20 ans sur cette planète (Irak-Afghanistan) l’on été et le sont encore au nom de la démocratie et des droits de l’homme par les armées occidentales, du Système donc. Dans des pays d’Afrique sub-saharienne où le sous-sol est riche en hydrocarbures, le Système et ses groupes pétroliers fomentent ou entretiennent des guerres pour endetter et donc asservir les pays concernés et empêcher par tous les moyens un scénario de type bolivien. Au Proche-Orient, la tête de pont occidentale en territoire barbare, Israël donc, est soutenue dans toutes ses boucheries depuis 60 ans par le Système. Dans sa nouvelle doctrine nucléaire, Washington menace même les pays qu’il jugera « proliférateurs » de frappes nucléaires préventives, même si ces derniers ne disposent pas de l’arme atomique (1). En clair, puisque la menace nucléaire iranienne est un conte, le Système est désormais théoriquement prêt à faire usage de l’arme atomique pour imposer son modèle aux récalcitrants trop turbulents.
- L’évolution de notre civilisation tend toujours vers le mieux Certes, à l’intérieur de la civilisation occidentale, on ne torture plus physiquement, on n’emprisonne plus les gens pour leurs idées (José Bové soutiendrait toutefois le contraire). Mais le Système opère un contrôle de plus en plus inquisiteur sur les individus sous couvert de sécurité, et l’on voit les prémices d’une répression « soft » mais grandissante de toute pensée non-conformiste à mesure que les contradictions du Système apparaissent. L’illusion de la liberté, et finalement de la vie pourrait-on dire, ne provient essentiellement que de l’accès d’apparence libre mais en réalité imposé (comment y échapper ?) à toutes les formes de saturations sensorielles. Simulacre d’exaltation par une sur-stimulation des sens donc, mais qui ne s’adresse toutefois jamais qu’à « nos passions tristes ». Ce qui caractérise le mieux la civilisation occidentale aujourd’hui, est le constat de la perte complète du sens. Intuitivement, on pourrait avancer que la raison n’a finalement jamais réussi à combler le vide laissé par le meurtre de Dieu (1789 : naissance de la seconde civilisation occidentale). Dans le Système occidentaliste, l’individu lutte en permanence contre une sensation de vertige, de vide, qu’il est sensé combler par un acte d’achat répété jusqu’à l’hystérie et/ou la nausée (Ô mon Dieu, mais quand va donc enfin sortir la nouvelle version du dernier MacdoPhoooone ?). En définitive, l’homo-occidentalus ne sait plus vraiment pourquoi il vit.
- Le capitalisme n’est pas parfait, mais il est perfectible et de toute façon, il n’y a pas d’alternative Arrivé désormais à sa pleine maturité, le système capitaliste dans sa version néo-libérale se révèle une machine monstrueuse, nihiliste à l'extrême, anthropophage dans sa nature profonde. Les licenciements de masse font s’envoler les actions des entreprises; les catastrophes naturelles sont considérées comme des aubaines pour relancer l'économie; le principe de précaution est sacrifié aux exigences du profit immédiat; c’est le règne du court terme ; la privatisation et la manipulation du vivant n'est qu'une perspective de plus d'enrichissement ; on préfère laisser crever des millions d’Africains plutôt que de baisser le prix des trithérapies. Au final, le capitalisme dans sa version ultime corrompt tout ce qu'il embrasse, de l’esprit à la biosphère, se dévorant finalement lui-même à coups d’OPA agressives, imposant aux sociétés qui lui sont soumises la décadence des mœurs, le desséchement de la pensée et de l'âme, le meurtre de l’environnement. Comme l’écrit Esther Vivas « Le capitalisme a démontré son incapacité de satisfaire les besoins fondamentaux de la majorité de la population mondiale (un accès à la nourriture, un logement digne, des services publics d’éducation et de santé de bonne qualité) tout comme son incompatibilité absolue avec la préservation de l’écosystème (destruction de la biodiversité, changement climatique en cours). » En ce sens, le capitalisme est tout simplement une dynamique destructrice du vivant. Même dans sa « zone de privilège », l’Occident donc, le capitalisme ne gouverne que par la violence : docilisation des masses par la précarisation ; paupérisation ; enfermement des individus dans les dettes pour achever de verrouiller leur dépendance au Système. Mais le capitalisme s’avère aussi incapable de résoudre ses contradictions (à qui vendre mes voitures puisque je mets mes acheteurs potentiels au chômage pour délocaliser et produire à moindre coûts etc…). Là encore, la narrative se fait d’autant plus agressive qu’il faut masquer une impasse de plus en plus visible.
La manipulation des psychologies
Et pourtant, l’Occident ne se pense qu’au travers de l’image parfaite et honorable dont il s’est doté comme une entreprise se dote d’une identité visuelle, de ce masque de vertu dessiné par sa machine de communication et qui est si prompt à se sentir outragé par la barbarie de l’« autre ».
Comment est-ce possible ?
C’est là qu’entre en jeu la fantastique puissance communicationnelle du Système. Un machine non pas de propagande (le propagandiste sait qu’il trompe), mais de création d’une réalité virtuelle.
La distinction est importante. Car le Système ne peut fonctionner que sous certaines conditions, dont l’une des principales est la sujétion volontaire des masses au Système. En l’absence de cette sujétion volontaire, le Système serait en effet contraint de révéler sa nature profonde, qui est totalitaire, et s’exposerait alors à être contesté, puis combattu, ce qui serait contre-productif, donc contraire aux buts du Système.
Or, là où la propagande s’attaque à la pensée et tente d’asséner des mensonges mille fois répétés pour en faire des vérités (cf Goebbels), la machine à réalité virtuelle du Système manipule la psychologie. C'est-à-dire le point de contact le plus intime entre le Système et l’individu. L’élément subtil par lequel l’individu perçoit, ressent le Système, et par lequel le Système touche au plus profond de l’individu.
Et seule la manipulation de la psychologie peut susciter la sujétion volontaire recherchée.
C’est pourquoi nonobstant une poignée de marionnettistes, tout ce qui fait la communication du Système, c'est-à-dire l’élite politique mais aussi, bien sûr, la presse-Pravda, les plumitifs du prêt-à-penser, le tout Hollywood et ses avatars, croit généralement au caractère indiscutable des énoncés cités en préambule, croit en la pureté intrinsèque du Système (n’est pas meilleur menteur que celui qui croit dire la vérité…).
Chacun des hérauts du Système défend donc la réalité virtuelle ainsi créée avec d’autant plus de hargne qu’il lui est vital d’y croire pour son équilibre psychologique justement, au point qu’on peut même soutenir qu’il désire intensément être trompé, par paresse, conformisme et peur de l’inconnu bien sûr, par crainte de perdre ses privilèges sûrement, par angoisse du vide sans doute.
On constate d’ailleurs que ces dociles communicateurs ne combattent jamais avec autant de rage toute contestation de Leur Vérité, que lorsqu’ils en suspectent tout à coup malgré eux l’éventuelle fausseté (l’exemple nous est donné ici par la violence avec laquelle sont traités ceux qui contestent la version officielle des attentats du 11 Septembre.)
L’individu sous perfusion permanente
A l’heure de l’hyper-technologie, la puissance du flux communicationnel du Système est désormais telle qu’il est bien difficile d’y résister, et impossible d’y échapper.
La télévision est bien sûr le principal vecteur des valeurs du Système, de sa réalité virtuelle donc. Là où l’on fait globalement sans cesse l’éloge des valeurs de l’Occident, de la justesse de ses croisades, des bienfaits du libre-marché, et c’est là aussi que directement ou implicitement on désigne l’ennemi, on caricature l’autre et les valeurs de l’autre, le barbus fanatique, l’insondable et menaçant bridé, le nègre sauvage et sanguinaire.
Or un français de plus de 4 ans passe, par exemple, en moyenne 3,36 heures devant sa télévision chaque jour. C'est-à-dire qu’en un an, il reste assis à fixer une petite boîte diffusant les messages du Système durant…. 54 jours sans discontinuer, soit presque… deux mois jours et nuits par an.
Dans la presse, considérée généralement comme plus critique, les valeurs citées en préambule ne sont jamais fondamentalement remises en question (sauf éditos alibis s’entend). Ajoutons donc à cela le temps de lecture. Et puis les messages publicitaires qui jonchent les rues et célèbrent les vertus du consumérisme, de la joie de posséder, c'est-à-dire qui célèbrent la plus haute vertu proposée par le Système, l’orgasme marchand : l’achat.
Bref, l’individu moyen est quotidiennement soumis aux stimuli du Système et à sa réalité virtuelle. Il est sous perfusion quasi permanente.
L’avantage de la réalité virtuelle sur la propagande, c'est-à-dire l’avantage de manipuler les psychologies plutôt que la pensée est donc évident. Car au lieu d’avoir des individus qui ânonnent sans y croire les vertus d’un système en le honnissant (cf ex-URSS), l’homo-occidentalus fait l’apologie du Système en étant persuadé de le faire de son plein gré en fonction d’un raisonnement libre, juste et bon.
L’individu se confond avec le Système qui a pénétré sa psychologie (2).
La liberté dans les interstices des rouages
Reste que cette manipulation en profondeur, malgré son caractère apparemment « soft » puisqu’elle vise une sujétion non contrainte, reste d’une violence terrible pour les psychologies. Difficile en effet de faire croire sans conséquences sur le long terme que le noir est blanc, que le bas est en haut, que la bassesse puisse être vertu.
Instinctivement, nombreux sont donc ceux qui ressentent intuitivement un malaise au spectacle de cette réalité virtuelle : « on sent bien que quelque chose cloche, mais quoi… »
C’est que le réel, un peu comme lorsque l’image d’une télévision est secouée par des parasites, fait régulièrement irruption dans la narrative du Système, sans que celui-ci puisse l’empêcher.
Crise économique majeure qui oblige le Système à se sauver lui-même en reportant la dette des spéculateurs sur les peuples ; boucherie puis débandade militaires masquées en opération de libération et en victoire (Irak), manipulations trop grossières sur les buts de guerre (cf. la fable des armes de destructions massives irakiennes) ; le réel entre parfois trop brutalement en contradiction avec la narrative du Système et en démasque au moins brièvement la supercherie.
Nombreux sont donc ceux qui, en proie à ce malaise, y cherchent une explication et sont donc réceptifs à d’autres informations, dissidentes ou alternatives comme on voudra, que le Système, et c’est là sa principale faiblesse, ne peut pas filtrer sans se désavouer lui-même puisqu’il s’affirme comme un espace de liberté. En ce sens, on constate que la narrative du Système est en même temps sa prison.
L’on pourrait donc caricaturer en disant que la vraie liberté se situe aujourd’hui dans les interstices des rouages du Système, dans ces espaces que le Système est contraint de laisser ouverts s’il veut lui-même fonctionner.
Internet est truffé de ces espaces là. Il est bien sûr un outil formidable de communication au Service du Système, mais sa nature ubuesque a aussi ouvert une faille béante dans sa narrative car, pour la première fois, l’information échappe au contrôle du Système.
De plus en plus de sites dissidents gagnent ainsi en audience et jouent un rôle « d’éveilleur » que le Système ne peut combattre frontalement. La presse-Pravda tente bien sûr désespérément de jouer l’opposition entre le mythe d’une info vérifiée, professionnelle, sérieuse contre le tout et n’importe-quoi qu’Internet produirait essentiellement. Mais c’est un baroud d’honneur.
Vers l’esprit de résistance
Et c’est là que l’on discerne les premières clés d’un nouveau manuel de guérilla possible, qui obéit grosso modo aux règles de la guerre de 4ème génération, c'est-à-dire ce que l’on appelle la guerre du faible au fort. Une guerre de harcèlement donc où, passez-moi l’expression, une poignée de moustiques peut efficacement s’employer à piquer le cul de l’éléphant jusqu’à le pousser à la faute, ou à le rendre fou. Les principes sont anciens (retourner les armes de l’adversaire contre lui, exploiter les failles dans sa défense, susciter la discorde chez l’ennemi), mais les moyens nouveaux.
Il s’agit d’attaquer le Système dans sa narrative, de le marquer à la culotte, de le démasquer, d’en révéler au jour le jour les supercheries, les sophismes, les manipulations. L’objectif étant bien sûr de discréditer le Système et ses zélateurs par la mise en concurrence acharnée de sa réalité virtuelle et du réel.
Ce combat en est au stade embryonnaire pour l’instant, et il est prévisible que le Système cherchera la parade par des astuces technologiques ou législatives.
Mais au final, le combat est engagé. Et l’on pourrait dire que le champ de bataille se situe aujourd’hui dans cet espace infime et gigantesque à la fois que constitue le doute, la malaise que fait ressentir aux psychologies la manipulation du Système. Ce malaise est comme une faille qu’il faut élargir pour que s’y engouffre le réel. Ensuite, il appartiendra au dormeur de se réveiller en acceptant le vertige du réel, pour que puisse naître en lui l’esprit de résistance, le désir du combat.
En attendant le coup de pouce de l’Histoire
Aujourd’hui, le Système est profondément malade de ses contradictions. La supercherie est de plus en plus difficile à masquer. Les crises se multiplient et les seuls remèdes que sont capables de proposer les élites du Système sont de nature cosmétique bien sûr. Car le Système ne peut ni ne veut être réformé en profondeur, car ce serait admettre sa faiblesse, son inadéquation au réel. La seule préoccupation du Système est donc de protéger sa narrative, d’imposer à tous le déni du réel. Alors une crise succède à une autre crise, qui en abrite elle-même cent autres. Car le réel est là, comme un volcan, qui couve sous la cendre.
Nous l’avons dit, la narrative du Système est en même temps sa prison. Sa force est donc sa faiblesse. Il est contrait de sauver les apparences, et sauver les apparences, c'est-à-dire la réalité virtuelle, lui impose des limitations terribles de ses capacités. Par exemple, sa machine de guerre, capable de renvoyer n’importe quel pays à l’âge de pierre, peut être réduite à l’impuissance à cause de cette narrative justement. En Afghanistan, on observe ainsi que les bavures, dès qu’elles sont connues, ont pour premier effet de compromettre les opérations en cours en obligeant le Système à clouer son aviation au sol, au moins le temps de faire oublier les crimes, de rétablir la narrative. S’en suit une suite interminable de « surge » qui ont tous ont la prétention d’être « la grande opération finale » et qui s’achèvent systématiquement en fantastiques ratages. De par les contraintes de la narrative, l’hyper-puissance militaire devient donc souvent impuissance avec, là encore, un désordre permanent qui s’installe. La hiérarchie militaire du Système se retrouve alors à hésiter sans cesse entre le désir d’atomiser les talibans, ou celui de les intégrer au gouvernement.
C’est que le Système s’avère désormais lui aussi incapable de résoudre ses contradictions. Le Système est en crise car la structure même du Système le conduit inéluctablement vers la crise.
Toutes les conditions sont donc réunies pour l’effondrement final. Mais à notre avis, seul un événement majeur pourra permettre aux peuples d’Occident de se libérer définitivement du Système. Un événement qui ne peut être qu’une fracture, un schisme, coup d’envoi de la dernière phase de l’effondrement attendu, à l’implosion, à la dissolution.
Or il se trouve que la crise du Système rencontre aujourd’hui une autre crise, celle des Etats-Unis, matrice du Système justement. C’est là en effet que le monstre a été conçu, nourri, là où il a pris son envol, a déployé ses ailes.
Notre thèse est donc que cet événement majeur tant attendu, le schisme, la fracture, pourrait prendre la forme d’une fracture transatlantique à la faveur de l’effondrement en cours de la puissance américaine.
L’effondrement du Système américaniste et/ou occidentaliste qui enchaîne les esprits et les nations depuis la fin de la Seconde guerre mondiale pourrait donc être, pour l’Europe et l’Occident en général, le moment tant attendu de sa vraie libération, de sa renaissance.
Encore faudra-t-il que suffisamment de dormeurs se soient réveillés d’ici là pour prendre les commandes de ce nouveau départ, et éviter que l’Histoire ne bégaie.
C’est à notre sens l’enjeu du combat d’aujourd’hui.
Entrefilets (19 avril 2012)
Notes :
(1) « J’estime que le traité de non-prolifération nucléaire (TNP) contient un message très ferme tant pour l’Iran que la Corée du Nord, a déclaré le secrétaire à la Défense américain, Robert Gates en présentant la nouvelle doctrine nucléaire américaine. Ce qui signifie que si vous acceptez de jouer selon les règles nous entreprendrons la mise en œuvre de certaines obligations envers vous; si vous devenez des « proliférateurs », alors toutes les options sont sur la table.»
(2) On sait que la CIA a expérimenté (faut-il parler au passé ?) des techniques de torture psychologique qui consistent à asséner de manière répétée des chocs sensoriels aux individus pour « laver leur psychologie ». Non pas pour y inscrire des messages nouveaux (ça c’était la technique obsolète du lavage de cerveau), mais pour en faire en quelque sorte une page blanche qui puisse être dès lors ouverte et réceptive à de nouvelles perceptions (cf Naomi Klein, La Stratégie du choc).