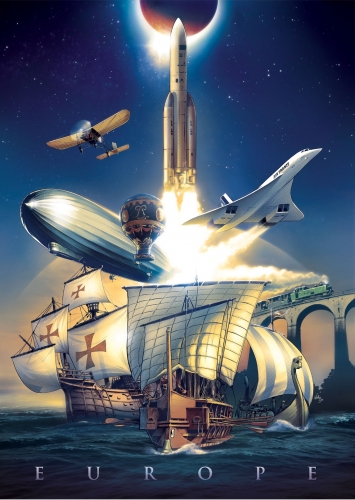Callac, laboratoire du peuplement de la France profonde par l’immigration
Le président de la République a annoncé le 15 septembre sa volonté d’organiser le peuplement des territoires ruraux par des migrants. Le village breton de Callac fait dans ce cadre figure de « laboratoire », avec le projet du maire et d’une fondation privée d’y installer prochainement des migrants en grand nombre. Un vent de révolte commence à souffler contre cette politique de peuplement de la France périphérique par des immigrés, nouvel « avenir radieux » que l’oligarchie compte imposer à des populations souvent réticentes voire opposées.
Le projet d’Emmanuel Macron pour faire face à la « transition démographique »
Le 15 septembre, le président de la République a réuni les préfets à l’Élysée pour leur présenter leur feuille de route pour les prochains mois (1). Parmi les différents sujets traités, Emmanuel Macron a dévoilé son projet pour faire face à la « transition démographique » de la France, sous la forme d’un diagnostic et d’un plan d’action, qui suscite d’ores et déjà de nombreuses interrogations et critiques.
Le diagnostic : la « transition démographique »
Le chef de l’État a fait le constat dans son discours que la procédure d’asile est actuellement longue et complexe en France, que de nombreux migrants économiques s’y engouffrent, que notre système d’aide sociale est plus généreux que celui d’autres pays européens, que l’intégration des étrangers récemment arrivés en France est souvent déficiente et que le nombre de reconduites dans leurs pays des étrangers en situation irrégulière est insuffisant.
Emmanuel Macron a également souligné que la France est confrontée à un problème de « transition démographique »: « D’ores et déjà nous sommes en train de perdre des élèves dans des écoles et des collèges, cette année environ 60 000, l’année prochaine plus de 95 000 ».
Or, selon le chef de l’État, « si nous savons offrir de l’urgence, de l’hébergement et de l’intégration dans ces régions (les territoires ruraux NDLR) à des femmes et des hommes qui arrivent sur notre sol, les conditions de leur accueil seront bien meilleures que si nous les mettons dans des zones qui sont déjà densément peuplées, qui ont une concentration de problèmes économiques et sociaux massifs, qui ont déjà trop d’élèves par classe, qui ont 10 à 15 élèves allophones, c’est ça la situation qui est la nôtre, elle est absurde, donc sur ce sujet, il faudra mobiliser, changer nos règles (…) pour que l’on puisse créer un système de répartition, bien meilleur de celles et ceux qui arrivent sur notre sol ».
Le plan d’action : le peuplement des territoires ruraux
Pour faire face tant à la baisse de la natalité dans notre pays qu’au déficit d’intégration de nombreux migrants récemment arrivés, Emmanuel Macron a annoncé avoir confié à la première ministre la tâche de travailler sur « une politique profondément différente de répartition sur le territoire des femmes et des hommes qui sont en demande de titres (de séjour NDLR) et aussi de ceux qui en ont reçus ». Le chef de l’Etat a indiqué en conclusion qu’un projet de loi relatif à l’asile et l’immigration sera déposé au parlement début 2023, adossé à une loi d’orientation et de programmation ambitieuse.
Emmanuel Macron entend donc fixer un nouveau cap à la politique d’immigration de la France. Après avoir créé les conditions d’une augmentation considérable du nombre d’arrivées d’étrangers extra-européens dans notre pays, après quasiment doublé le parc d’hébergement des demandeurs d’asile, qui dépasse désormais les 110 000 places, après avoir organisé leur répartition administrée dans les centaines de structures créées sur le territoire national, ainsi que celle des dits mineurs non accompagnés, le chef de l’Etat veut donc parachever sa politique de peuplement, en organisant la répartition de migrants dans les territoires ruraux, en vue de leur installation pérenne.
La politique de peuplement, arme de destruction de l’identité nationale
Le constat est connu : chaque année, des centaines de milliers d’extra-Européens arrivent légalement ou clandestinement en France. A l’exception de l’immigration de travail, les étrangers choisissent de s’installer en France, bien plus que la France ne les choisit. L’absence de quotas d’immigration ne permet aucune limite tant quantitative que, bien souvent, qualitative à cette immigration. Dans ces conditions, la politique de peuplement administré des territoires ruraux ne manquera pas de prendre une ampleur considérable.
La politique de peuplement menée par le gouvernement chinois au Tibet peut à ce sujet être utilement rappelée. Afin d’y éradiquer toute résistance au pouvoir central, le pouvoir communiste a par son entreprise de « sinisation » tenté de renverser de la composition ethnique des territoires où elle était appliquée. Les transferts massifs de population ont été dénoncés par une grande partie de la communauté internationale pour les graves dangers qu’ils représentent pour l’identité des peuples locaux. Pour quelle raison ce qui serait condamnable pour les Tibétains ne le serait pas pour les Français ?
Cette comparaison est-elle exagérée ? L’avis du haut-commissaire au plan est à ce titre intéressante. François Bayrou s’est vu confier la mission d’animer et de coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective conduits pour le compte de l’Etat et d’éclairer les choix des pouvoirs publics, notamment en matière démographiques. S’exprimant quelques jours après la déclaration d’Emmanuel Macron sur son projet de peuplement des campagnes par des allogènes, il déclarait : « les peuples ont droit à leur identité et à des garanties sur la pérennité de leur identité. (…) On n’a pas fait suffisamment attention à ce droit. Les peuples sont attachés (…) aux modes d’être, aux modes de vie qui font que la France est la France, la Suisse est la Suisse, l’Italie est l’Italie » (2). On ne saurait mieux dire.
Les enjeux et opportunités du projet présidentiel
L’enjeu majeur du projet de peuplement des territoires ruraux par des migrants est bien évidemment celui de la continuité historique de la France et de la préservation de son identité. Bien loin de ces considérations, Emmanuel Macron souhaite pour sa part saisir deux opportunités majeures.
En premier lieu, l’initiative d’Emmanuel Macron lui permet de reprendre la main sur le projet de loi que Gérald Darmanin devait initialement présenter en septembre visant à faciliter l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. En y ajoutant un volet « intégration », Emmanuel Macron cherche « en même temps » à remporter l’adhésion de la gauche et de certains parlementaires LR. Car l’idée de répartir des migrants dans les campagnes est loin de provoquer l’hostilité générale au sein du parti Les Républicains. Le directeur de campagne de Valérie Pécresse lors de l’élection présidentielle d’avril 2022, Patrick Stefanini, ne déclarait-il pas en novembre 2020 : « Une intégration réussie exige une répartition plus équilibrée des immigrés sur le territoire et des moyens financiers importants » (3) ? Une conseillère municipale LR de Callac estimait plus récemment au sujet du projet de peuplement du village par des migrants qu’« il nous faut accepter que Callac soit un laboratoire. Et espérer le succès de l’opération. » (4).
D’autre part, en présentant son projet comme visant une meilleure intégration des migrants extra-européens, le chef de l’Etat entend faire accepter aux Français sa politique d’immigration de plus en plus débridée, qu’il entend non seulement poursuivre, mais également amplifier. Car plus que jamais, Emmanuel Macron considère l’immigration comme un phénomène naturel et positif, un flux qui ne peut en aucun cas être ralenti ou freiné, mais qui doit être accompagné et réparti.
Callac, laboratoire du peuplement administré de la France par des migrants
C’est dans ce contexte qu’une famille de riches mécènes souhaite organiser le peuplement du village breton de Callac, dans les Côtes d’Armor, par des migrants.
Une première étape a été franchie en avril 2022 avec la signature d’une convention de partenariat entre le fonds « Merci » et le maire de la commune de Callac, visant à financer l’accueil de « réfugiés » et de non-réfugiés et la « revitalisation » du territoire.
Le rapport d’activité 2021 du fonds de dotation donne quelques informations sur la nature de l’aide qui devrait être apportée : « Horizon propose de rénover ou de construire des « lieux de vie » avec des personnes réfugiées et non-réfugiées qui, grâce à leurs savoir-faire, participeront ensemble au développement économique, urbain, social et culturel d’un territoire » (6).
Le document nous apprend également qu’« Arche de Noé des temps modernes, ce village pionnier a pour objectif de devenir un modèle duplicable » (7). Une carte de France fait apparaitre une vingtaine d’autres sites qui pourraient devenir des « villages horizon ».
Si à ce stade, aucune indication n’a filtré sur le nombre de migrants à accueillir et la date de leur arrivée, plusieurs éléments peuvent utilement être rappelés sur le contexte de ce projet de peuplement.
Callac, un échec déjà patent
Quel est ce village où les mécènes de la fondation Merci et le maire veulent installer des migrants ? Callac est l’une de ces innombrables communes frappées par l’exode rural, un exode qui n’est en rien le fruit du hasard et qu’un peuplement hasardeux ne freinera qu’artificiellement. Les abattoirs qui étaient installés sur la commune ont fermé, des exploitations agricoles ont disparu, des emplois ont été supprimés, la mécanisation a fait le reste. A Callac comme ailleurs dans la France périphérique, les commerces et les services publics ont fermé progressivement. Près de 18 % de la population active de la commune est au chômage.
Interrogé par Le Figaro, un membre du collectif « pour la défense de l’identité de Callac » affirme : « À Callac, il y a des gens qui cherchent du travail depuis longtemps : pourquoi on ne leur offre pas des formations, des logements réhabilités et le permis de conduire, à eux ? »(7).
Il y a eu un précédent dans la commune. 5 logements vides ont été attribués à des migrants et à leurs familles en 2017 (8). Le jour de la manifestation contre le projet de peuplement du village, le maire de la commune reconnaissait de façon bien involontaire que « parmi les 5 familles de réfugiés (…), les parents sont « un peu désœuvrés », une façon pudique de dire qu’ils sont une charge pour le système social français (9).
Pourquoi ce qui a échoué pour 5 personnes réussirait-il pour d’autres en plus grand nombre ? L’immigrationnisme ne semble pas s’appuyer sur des faits mais sur des convictions imperméables à la réalité. Si cette expérience n’est pas concluante, c’est parce qu’elle n’est pas suffisante. Comme elle est vouée à réussir, il faut donc l’amplifier !
A l’échelle du pays, Emmanuel Macron voudrait faire croire aux Français que l’immigration n’est pas un problème de quantité mais de répartition. Il n’a aucunement pour projet de freiner les flux migratoires et de résoudre les problèmes existants : les innombrables zones de non droit, l’islamisation qui progresse, le chômage endémique, etc. On peut parler d’une véritable obstination déraisonnable en la matière. Une politique de peuplement ne fait pas une politique d’aménagement du territoire, encore moins une politique économique.
La résistance au projet de peuplement par l’immigration
Samedi 17 septembre, le rassemblement à Callac contre le projet porté par le maire et le fonds de dotation Merci a réuni près de 300 personnes. L’émoi suscité sur les réseaux sociaux tant par ce projet que par l’annonce du chef de l’Etat de peuplement de territoires ruraux montre que le sujet suscite une forte opposition dans une grande partie de la population.
Mais les opposants au dessein du président de la République devront pour remporter des succès sortir de l’ornière dans laquelle le pouvoir en place veut les conduire, celle de la marginalisation et de l’ostracisation. Pour y parvenir, il y a tout d’abord un travail d’information à entreprendre, que certains médias ont commencé à faire. Il y a également la mobilisation sur le terrain. Les rares succès de mouvements de refus de l’implantation de centres d’accueil pour migrants ont été obtenus grâce à une mobilisation citoyenne où les partis politiques étaient en retrait. L’opposition au projet de peuplement d’Emmanuel Macron peut être soutenue par des partis politiques, mais elle doit avant tout être un mouvement local et populaire, qui ne marque pas une appartenance à un bord politique, mais un attachement viscéral à l’identité de la France et à sa continuité historique. Un droit qui est reconnu aux autres peuples mais qui pourrait être nié ici et maintenant.
Paul Tormenen (Polémia, 30 septembre 2022)
Notes :
(1) Discours du président Emmanuel Macron aux préfets. 15 septembre 2022. Site de l’Elysée
(2) « Immigration : les peuples ont droit à leur identité, affirme Bayrou ». Le Point. 18 septembre 2022
(3) « Sur l’immigration, l’intérêt du pays est incompatible avec les zigzags ». Le Point. 28 novembre 2020
(4) « A Callac, la greffe forcée des réfugiés cabre les villageois ». Le Figaro. 16 septembre 2022
(6) Rapport d’activité 2021. Fonds de dotation Merci
(7) cf. (4)
(8) « 5 logements vides et destinés à des migrants ? ». Breizh Info. 21 décembre 2017
(9) Tweet de Pauline Launay. 17 septembre 2022