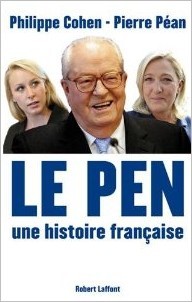Nous reproduisons un point de vue éclairant de la fondation Polémia, cueilli sur son site et consacré aux conséquences de l'immigration de masse que la France subit depuis plus de 40 ans...

Immigration de masse : la grande catastrophe
L’immigration de masse n’est pas une chance pour la France. C’est une catastrophe. Une grande catastrophe : identitaire, sécuritaire, scolaire, administrative, sanitaire, économique, sociale, budgétaire, environnementale, politique, diplomatique, démographique ; c’est aussi une catastrophe pour les libertés. Il est temps de rappeler les faits, dans toute leur réalité, c’est-à-dire dans toute leur brutalité. Sans haine, bien sûr, mais aussi sans faux semblants, ni tartufferies, ni concessions aux convenances de la bien-pensance.– Catastrophe identitaire. Beaucoup de Français de souche européenne se sentent devenir étrangers dans leur propre pays. Dans certains quartiers, ils deviennent une minorité opprimée. Des coutumes étrangères – voile islamique, boubous, djellabas – leur sont imposées dans l’espace public. Des règles alimentaires musulmanes s’implantent dans leurs abattoirs et s’imposent dans leurs assiettes. Les paysages urbains sont transformés par l’édification de mosquées monumentales, expression d’une prise de contrôle symbolique du territoire français. Les programmes scolaires et leurs mises en œuvre sont « adaptés » aux exigences de minorités venues d’ailleurs. Les principes républicains (laïcité, mérite, égalité de droit) sont bafoués. La France devient multiculturelle et donc multiconflictuelle.
– Catastrophe sécuritaire. Du strict point de vue des faits, il est incontestable que la très grande majorité des trafiquants de drogue sont noirs ou arabes. Les violences faites aux femmes, les agressions dans les écoles, les rencontres sportives entre amateurs qui tournent mal, sont concentrées dans les quartiers de l’immigration et les périphéries qu’ils impactent. Plus généralement, l’explosion de la délinquance, depuis les années 1970, est en relation directe avec la progression de l’immigration. Dans les prisons, de l’ordre des deux tiers des personnes incarcérées ne sont pas des Français de souche. Plus de la moitié des détenus sont musulmans. Près de 800 quartiers sont devenus des zones de non-droit où les pompiers et les SAMU s’exposent à être caillassés et où les médecins hésitent à s’aventurer.
– Catastrophe pour les libertés. La montée de l’insécurité liée à l’immigration limite dans les faits la liberté d’aller et venir (dans certains quartiers ou moyens de transport) des honnêtes citoyens. La lutte contre l’insécurité n’a pas porté sur ses vraies causes mais a provoqué une multiplication des lois sécuritaires potentiellement dangereuses pour les libertés : inflation du nombre des incriminations pénales, extension des délais de garde à vue, essor de la vidéo-surveillance, développement de la sécurité privée. Pour imposer, sans débat et sans consultation des Français, une politique migratoire insensée les gouvernements successifs ont fait voter des lois liberticides : lois Pleven (1972), Gayssot (1990), Toubon (1994), Taubira (2002) qui sont des atteintes successives à la liberté d’expression, en même temps qu’une véritable régression civilisationnelle.
– Catastrophe scolaire. Les réformes pédagogiques et le collège unique ont débouché sur une dégradation de l’acquisition des connaissances par les élèves. Ce phénomène est grandement amplifié par l’hétérogénéité croissante des classes en raison d’une immigration qui accentue les différences entre élèves, s’agissant des capacités cognitives, de la maîtrise de la langue française et de l’acceptation du contenu des programmes (histoire, littérature, biologie). L’affectation des enseignants débutants dans les banlieues de l’immigration rend leur recrutement de plus en plus difficile et conduit souvent au découragement de ceux qui ont choisi le métier de professeur. Cet ensemble de faits explique qu’aux tests internationaux PISA, les performances des élèves scolarisés en France déclinent davantage que dans les pays voisins. A contrario, c’est la Finlande, pays européen le plus homogène ethniquement, qui obtient les meilleurs résultats internationaux.
– Catastrophe administrative. Certains immigrés sont amenés à importer des pratiques frauduleuses souvent jugées normales dans leur pays d’origine : fausses déclarations, corruption active de fonctionnaire ou menaces. Les fonctionnaires de police, des préfectures, des services du permis de conduire, les agents des services sociaux mais aussi les enseignants sont exposés à ces comportements.
– Catastrophe pour la santé publique. Compte tenu des contraintes budgétaires qui l’encadrent et de l’allongement de la vie, le système sanitaire français est au bord de la rupture financière. L’immigration apporte des déséquilibres supplémentaires : un nombre croissant de bénéficiaires non cotisants (CMU, CMU complémentaire, Aide médicale d’Etat), du tourisme médical offrant l’accès à des lits d’hôpitaux parfois en nombre insuffisant, l’essor de maladies rares en France (tuberculose, SIDA) mais fréquentes dans les départements à forte immigration africaine (93, 95 notamment). L’organisation même des services d’urgence est perturbée par des comportements compulsifs, voire agressifs, de personnes ne suivant pas le parcours de soins habituel. Or cette augmentation de la demande médicale n’ayant été ni anticipée ni financée, les hôpitaux sont conduits à recruter des médecins étrangers sous-payés et parfois sous-qualifiés.
– Catastrophe pour l’emploi. Le chômage dépasse le seuil de 10% de la population active, 15% en prenant en compte le chômage partiel. C’est une cause majeure de malaise social et de déficit budgétaire. L’immigration n’est pas seule en cause mais amplifie le phénomène. Le taux de chômage des étrangers africains ou maghrébins est le double du taux français, selon l’INSEE. Le taux de chômage des jeunes issus de l’immigration maghrébine ou africaine est aussi le double de celui des jeunes Français d’origine européenne (1). On connaît l’antienne cent fois répétée : « Les étrangers font le travail que les Français ne veulent plus faire ». Pour être plus exact, il faudrait dire : « …ou plutôt que les étrangers déjà installés et les immigrés de la seconde génération ne veulent plus faire non plus ». Les immigrés qui entrent aujourd’hui en France maintiennent au chômage des étrangers déjà présents ; et ce sont les parents des chômeurs de demain.
– Catastrophe pour les salaires. Sous l’effet de la poursuite inconsidérée de l’immigration, les salaires baissent dans de nombreux secteurs et métiers : ouvriers du bâtiment et travaux publics, employés de la restauration ou des services d’aide à la personne, artisans mais aussi techniciens et ingénieurs, notamment dans l’informatique, sont concernés. Ce sont les jeunes actifs entrant sur le marché du travail qui sont les premières victimes de ce phénomène. L’ouverture des frontières offre un immense réservoir de main-d’œuvre aux sociétés industrielles capitalistes tandis que l’Etat-providence assure à tous un revenu minimal : d’où le développement simultané du chômage, de la baisse des salaires et de la montée des déficits. Difficile de faire pire !
– Catastrophe budgétaire. Dans un pays en sous-emploi, l’immigration est un boulet économique : toute entrée de personnes supplémentaires sur le territoire accroît les charges sociales et les frais généraux de la nation, sans recettes correspondantes. En appliquant les modes de calcul du prix Nobel Maurice Allais on peut estimer à 18 milliards d’euros, chaque année, les coûts d’investissement (logements, hôpitaux, écoles, transports, prisons) et les charges de fonctionnement (écoles, aides et prestations sociales) liés à l’entrée de plus de 200.000 étrangers supplémentaires. Ceux qui prétendent, contre tout bon sens, que l’immigration améliore les comptes français oublient deux choses : que la France est en sous-emploi et qu’il est inexact de comparer une population immigrée jeune à une population française âgée puisque celle-ci compte… de vieux immigrés naturalisés. Enfin, une partie des salaires et des aides sociales perçues repart, à hauteur de plusieurs milliards d’euros, vers les pays d’origine, ce qui creuse le déficit de la balance des paiements française.
– Catastrophe environnementale et pour l’aménagement du territoire. L’immigration de masse aboutit à déstructurer les espaces urbains ; elle provoque le white flight (2) et amplifie la crise du logement et la rurbanisation du territoire ; résultat : l’artificialisation des sols s’accélère ; tous les dix ans l’équivalent de la surface d’un département est artificialisé, ce qui détruit des paysages, fruits d’un équilibre millénaire. La gestion des déchets dans les quartiers de l’immigration et dans de nombreux campements Roms pose des problèmes environnementaux graves.
– Catastrophe dans les transports. En trente ans, la situation dans les transports publics des grandes métropoles s’est profondément dégradée : d’abord, parce que les réseaux de transport doivent déplacer davantage d’usagers sans disposer pour cela de recettes supplémentaires correspondantes ; ensuite, parce que les comportements irresponsables (blocage des fermetures de portes des trains, descente sur les voies de chemin de fer), les actes de vandalisme et les agressions, particulièrement fréquents sur les lignes desservant les banlieues de l’immigration, se répercutent sur l’ensemble des réseaux, générant des retards à répétition. Les vols de métaux, commis par des mafias souvent venues d’ailleurs, sont une cause additionnelle de perturbations.
– Catastrophe politique. Selon la Constitution, « la souveraineté appartient au peuple », et « la loi est l’expression de la volonté générale » ; or, pour qu’un groupe humain fasse peuple, il faut qu’il partage des valeurs, des coutumes et des comportements communs. Cela suppose l’assimilation. La communautarisation ethnique et religieuse s’y oppose. Les minorités monnaient leurs voix. Ce qui conduit les maires à « courtiser l’islamisme » (3) et le parti socialiste à fonder sa stratégie électorale sur le remplacement des classes populaires françaises par les minorités étrangères.
– Catastrophe pour la souveraineté française. A terme, nos options de politique étrangère risquent d’être prises au regard des réactions éventuelles de minorités arabophones ou islamisées présentes sur notre sol ; d’ores et déjà, celles-ci sont la cible de spectaculaires opérations d’influence de la part des Etats-Unis et du Qatar, sans compter le financement de mosquées par l’Arabie Saoudite, le Maroc, l’Algérie ou la Turquie.
– Catastrophe démographique. A moyen et long terme, c’est à une substitution de population que nous assistons. C’est déjà le cas en Seine-Saint-Denis où plus de la moitié de la population est noire ou maghrébine. C’est aussi le cas dans la grande majorité des 800 quartiers « sensibles ». Ce pourrait être, à terme, le cas de l’ensemble de la France menacée de « grand remplacement », selon la juste expression de l’écrivain Renaud Camus. Ce génocide lent a deux causes : l’arrivée de populations étrangères fécondes, en raison notamment de l’immigration nuptiale (entrée en France de jeunes femmes avec un taux de fécondité élevée) ; mais aussi le découragement de bien des familles de souche européenne qui se heurtent à des difficultés croissantes pour se loger, pour se déplacer et pour trouver des écoles adaptées à leurs enfants. La surnatalité ou la seule irruption étrangère est aussi une cause de la dénatalité française. Ce phénomène a été observé par le passé dans l’effondrement de nombreuses civilisations, notamment méso-américaines. La catastrophe démographique est évidemment de loin la plus grave car elle est potentiellement irréversible.
Faire face à la crise existentielle du peuple français
Certes, l’ensemble des difficultés françaises ne saurait être réduit à l’immigration. La crise existentielle du peuple français est la cause majeure de l’abaissement français. Mais il serait vain d’envisager – par aveuglement, paresse intellectuelle, lâcheté morale, opportunisme médiatique ou cynisme politique – un quelconque relèvement français (ou européen) sans que soit posée la question de l’immigration. Pour une raison simple : oser s’attaquer au problème de l’immigration, c’est la première étape du redressement, car c’est le tabou le plus fort qu’il faut briser : celui de la mauvaise conscience et de la repentance.
Polémia (30 novembre 2012)
Notes
(1) Sources INSEE : Nombre de chômeurs et taux de chômage selon la nationalité, le sexe et l'âge en 2009 : http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon03323 et ministère de l’Intérieur, Infos migrations, mai 2011.
(2) « White flight désigne la migration des personnes de race europoïde de zones urbaines qui ont vu un taux d'immigration de populations allogènes augmenter significativement. » « L’expression, née aux Etats-Unis, est utilisée pour l’exode des populations blanches des centres-villes américains après la fin de la ségrégation raciale. » (Sources : Wikipedia et Wiktionnaire.)
(3) Selon le titre d’un livre de Joachim Veliocas, de l’Observatoire de l’islamisation.