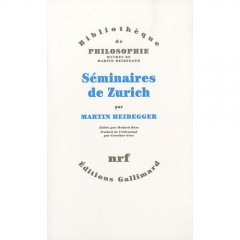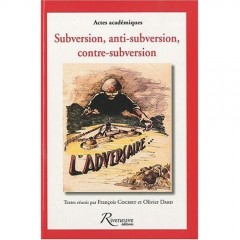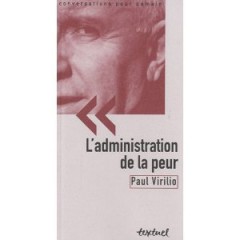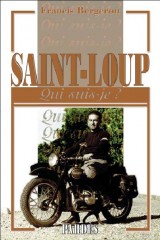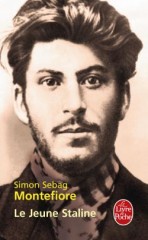Les éditions Choiseul viennent de publier Géopolitiques - Manuel pratique, de Patrice Gourdin, avec une préface d'Yves Lacoste, le directeur de la revue Hérodote. Patrice Gourdin enseigne à l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et à l'Ecole de l'Air, à Salon-de-Provence. Un livre qui est une nouvelle preuve du regain de vitalité de la pensée géopolitique en France, regain de vitalité qui touche aussi la pensée stratégique et militaire, et dont il y a lieu de se réjouir !
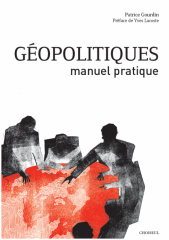
"Le XXIe siècle marque le retour brutal de la géopolitique sur le devant de la scène. À l’heure du basculement des rapports de forces entre puissances, de la multiplication des crises et des conflits, il manquait un ouvrage qui donne de véritables outils d’évaluation et de compréhension. Ce manuel pratique d’analyse géopolitique, réalisé par un expert reconnu des relations internationales, est le premier du genre. Il offre enfin à la discipline une méthodologie rigoureuse et structurée, et met à disposition du lecteur toutes les clés de l’analyse géopolitique.Quel rôle joue le territoire dans les conflits ? À quels facteurs humains s’attacher pour comprendre les lignes de tensions du monde ? Pourquoi les représentations géopolitiques peuvent-elles provoquer des guerres ? Quelles sont les motivations des acteurs extérieurs qui s’immiscent dans les crises ? L’étude de cas concrets tels que le Tibet, le Darfour, la Tchétchénie ou encore l’Afghanistan ancrent fermement le propos de l’auteur dans l’actualité.
Avec ce manuel très accessible et qui va faire référence, le lecteur peut enfin comprendre les grandes évolutions du monde."