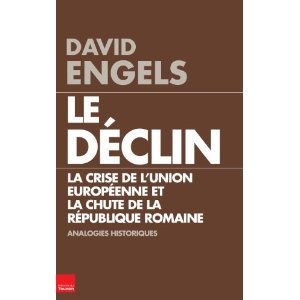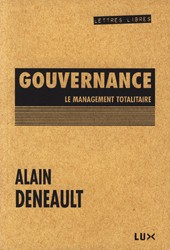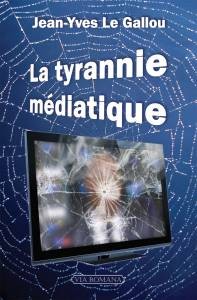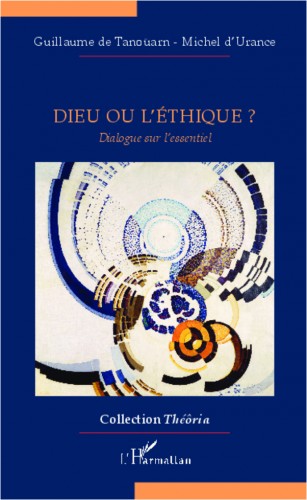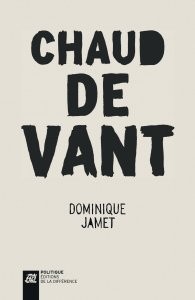Les éditions Rivages publient dans leur collection de poche Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, un recueil de textes de William Morris. Chef de file des préraphaélites et du mouvement Arts & Crafts, William Morris fut aussi le tenant d'un socialisme écologique et enraciné et le précurseur de la pensée de la décroissance.
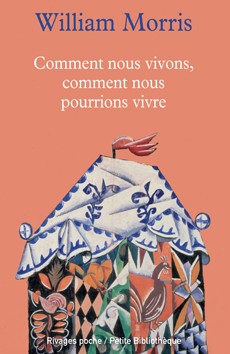
"William Morris (1834-1896) connaît plusieurs carrières successives : il est peintre, poète, tisserand, traducteur, décorateur, romancier, éditeur, imprimeur. Vers 1883, il s'engage auprès des socialistes. Dès lors, il sillonne l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande, pour donner des conférences, en général à des auditoires d'artistes ou d'ouvriers. Ce volume réunit trois de ces conférences.
Il y examine le système économique de son temps et démontre avec ferveur ce que ce système a de déshumanisant, il s'y interroge sur les arts décoratifs et sur leur importance dans la vie quotidienne.
Dans ces pages, Morris affirme ses préceptes favoris : aucun objet chez soi qui ne soit beau ou utile. Aucun travail qui ne soit une joie à accomplir. Rien de plus important que la beauté, l'amitié et la solidarité."