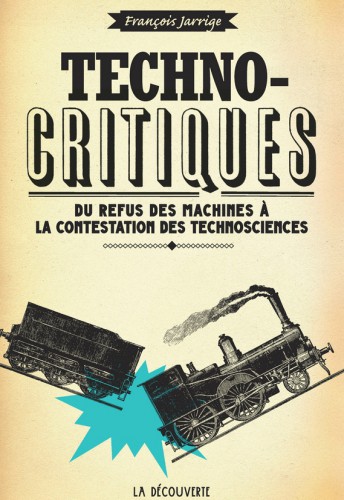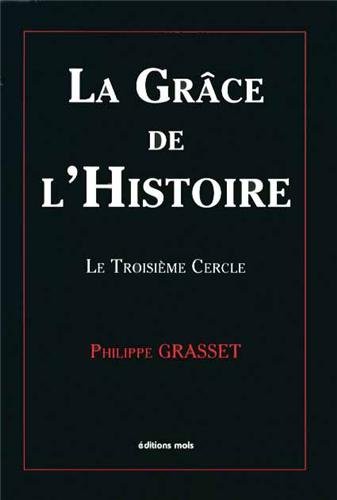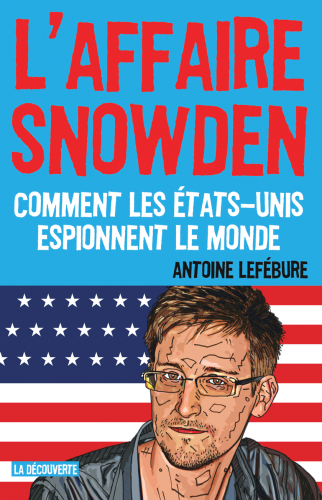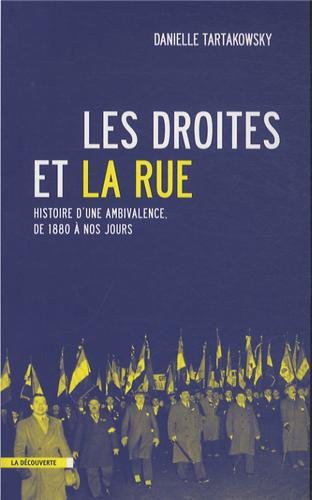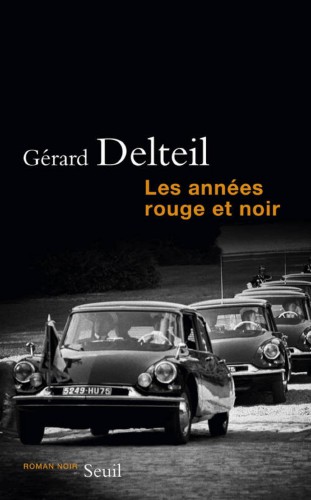Les éditions L'Harmattan ont récemment publié, sous la direction de Traian Sandu, les actes du colloque organisé par le Centre Interuniversitaire d’Etudes Hongroises de Paris III à Paris, le 2 avril 2010, sur le thème Vers un profil convergent des fascismes ? «Nouveau consensus» et religion politique en Europe centrale. Spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Europe centrale, Taian Sandu doit prochainement publier aux éditions Perrin un essai intitulé Un fascisme roumain.

" Le " nouveau consensus " dégage depuis une vingtaine d'années les grands traits d'un " fascisme générique " commun à tous les radicalismes nationalistes autour de leur quadruple dimension de syncrétisme idéologique et social droite-gauche et interclasse, d'exacerbation de la religiosité politique, de révolution globale et de promesse de régénération nationale. Ces analyses, appliquées avec succès au fascisme et au nazisme, ont trouvé un large écho parmi les jeunes historiens roumains, pionniers dans un espace centre-européen riche en mouvements de droite radicaux.
L'affichage d'une foi religieuse et d'une fidélité monarchique de la part de chefs charismatiques comme Codreanu en Roumanie, Szâlasi en Hongrie ou Pavelic en Croatie ne doit pas nous tromper : elles ressemblent souvent à des pétitions certes sincères, mais insatisfaites par l'Église et la royauté telles qu'elles interprètent l'identité nationale renouvelée par les bouleversements de la Première Guerre mondiale.
Ce faisant, les analyses des tenants du new consensus s'enrichiront tout en se nuançant, puisqu'elles devront se confronter à des situations de mise en échec du fascisme par les conservatismes autoritaires, à de très résistibles ascensions donc dans le contexte de sociétés encore retardées d'Europe centre-orientale. "