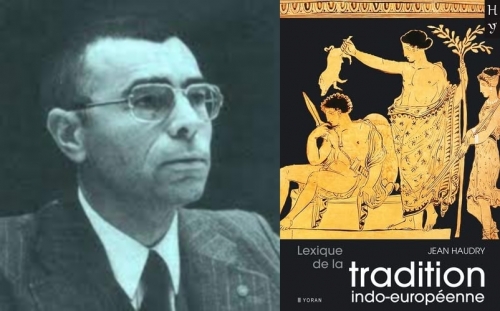Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné au site de la revue Conflits par Michel Gandilhon, expert associé au département Sécurité défense du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) qui travaille depuis de nombreuses années sur les questions liées à l’offre de drogues en France et dans le monde.

Criminalité liée aux trafics de drogues en France : une menace stratégique ? Entretien avec Michel Gandilhon
Quelles sont les grandes tendances de l’évolution du trafic de drogues dans le monde ?
Pour apprécier la situation où se trouve la France, on ne peut faire abstraction de l’environnement international. La plupart des substances illégales qui sont consommées en France et en Europe sont en effet produites à l’étranger. Depuis 1990, le marché des drogues a crû considérablement dans le monde. Selon l’Organisation des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), depuis 2010, le nombre de consommateurs aurait augmenté de 25 %, tandis que le chiffre d’affaires de ce marché était évalué dans une fourchette comprise entre 420 et 650 milliards de dollars. Le cannabis est de loin la première substance consommée, mais c’est probablement le marché de la cocaïne qui connaît aujourd’hui la dynamique la plus notable portée par une offre en Amérique latine qui a atteint en 2021 des niveaux sans précédent. En Colombie, depuis 2010, la production de cocaïne a quadruplé. En Europe, cela s’est traduit par des saisies records en 2021, autour de 240 tonnes, soit une multiplication par 5 ou 6 en une dizaine d’années. C’est le cas notamment dans les grands ports commerciaux comme Anvers, Rotterdam, Hambourg ou encore Le Havre. Le gros du trafic passe en effet par les mers et notamment par le vecteur des conteneurs. Selon l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), entre 2013 et 2020, la valeur du marché de la cocaïne en Europe aurait doublé passant de 5 à plus de 10 milliards d’euros, cette dernière évaluation n’incluant pas le Royaume-Uni du fait du Brexit. L’autre grand marché en croissance est celui des stimulants synthétiques comme l’ecstasy, les amphétamines ou encore la méthamphétamine dont les saisies ont explosé à l’échelle mondiale ces dernières années. Les Pays-Bas et la Belgique en sont de gros producteurs. La nouveauté en la matière réside dans le développement dans ces deux pays de la production de méthamphétamine, un stimulant synthétique très puissant, dans le cadre d’une coopération avec certains cartels mexicains.
L’autre grand marché dans le monde, que l’on a tendance à oublier trop souvent, est l’héroïne. Là aussi, on assiste depuis dix ans à des niveaux de production très élevés, notamment en Afghanistan où la production d’opium a été dopée par le chaos engendré par la guerre et la ruine de l’agriculture paysanne. Le pavot à opium est devenu un élément de la survie de beaucoup de familles de paysans. L’Europe est très affectée par la production d’héroïne afghane dont elle constitue le premier débouché, via la route des Balkans. Si, comme nous l’avons vu, pour la cocaïne, les routes sont essentiellement maritimes, s’agissant de l’héroïne, elles sont plutôt terrestres. De l’Afghanistan, elles traversent l’Iran, la Turquie, et débouchent sur les Balkans pour arriver notamment sur la zone de distribution très importante formée par la Belgique et les Pays-Bas. C’est le « hub criminel du nord-ouest », comme l’appelle Europol. Ce marché des drogues dynamique concourt à la prospérité d’un crime organisé qui, dans certains pays, comme le Mexique, possède un pouvoir de déstabilisation des États non négligeable. Une réalité qui ne concerne d’ailleurs plus seulement l’ex-Tiers-Monde, mais de plus en plus les États-Unis ou l’Union européenne.
Vous consacrez justement une partie aux États-Unis où la consommation très importante de drogues importées depuis le Mexique entraîne des conséquences sociales et sanitaires dramatiques.
En effet, les États-Unis sont très affectés par la situation au Mexique, puisque la plupart des drogues consommées soit y sont produites, notamment des opioïdes comme l’héroïne et le fentanyl, soit y transitent comme la cocaïne. Ce pays est en train de vivre sa pire crise de santé publique liée aux drogues de son histoire, puisqu’un million de personnes sont mortes de surdoses depuis 20 ans. Sur ce million, 700 000 sont décédées du fait de l’héroïne, mais surtout de médicaments antidouleurs très puissants prescrits ou contrefaits comme le fentanyl, fabriqués en Chine et de plus en plus au Mexique. C’est d’ailleurs ce qui fait aussi une des caractéristiques du marché des drogues aujourd’hui : l’indistinction ou le flou entre médicaments et drogues illégales. Aux États-Unis, cette épidémie d’opioïdes est partie de l’industrie pharmaceutique. Sa responsabilité a été capitale dans cette affaire. En 1995, une firme, Purdue Pharma, qui produisait un antidouleur très puissant, l’Oxycontin, réservé à des patients cancéreux en phase terminale, a décidé d’élargir le marché à des patients souffrant de simples douleurs chroniques. Ils ont sciemment ciblé certaines régions des États-Unis, notamment celles du nord-est désindustrialisé, où beaucoup de gens souffraient de douleurs chroniques liées notamment à la pénibilité du travail. Ils ont lancé une immense campagne marketing destinée à ces populations et incité les médecins généralistes à prescrire des médicaments opioïdes. Beaucoup de gens sont devenus dépendants, puis sont passés à l’héroïne et maintenant au fentanyl, cinquante fois plus puissants que cette dernière. En 2022, 75 000 Américains sont morts de surdoses liées aux opioïdes. Cette tragédie est une coproduction des cartels pharmaceutiques américains et des cartels mexicains. Le résultat : chaos sanitaire aux États-Unis et chaos criminel au Mexique, pays qui illustre de façon exemplaire le potentiel de déstabilisation géopolitique du crime organisé quand il est surpuissant. La guerre à la drogue lancée par les gouvernements mexicains depuis 2006 a fait près de 300 000 morts et 80 000 disparus. On a affaire ici à un État failli dont l’ancien ministre chargé de la lutte contre la drogue est jugé actuellement aux États-Unis pour complicité avec le cartel de Sinaloa.
L’affaire du fentanyl n’est-elle pas une illustration du passage de drogues issues de plantes à des drogues de synthèse ?
Ce sont des réalités qui coexistent. Si les drogues synthétiques telles l’ecstasy, le captagon ou encore le fentanyl montent en puissance, les substances issues de la coca et du pavot conservent une part essentielle dans le marché des drogues contemporain. Ne parlons même pas du cannabis, et de ses dérivés, qui, du fait de la légalisation médicale et non médicale dans un nombre croissant d’États, reste la première substance consommée dans le monde. Le marché de la résine de cannabis produite au Maroc reste très significatif en France, notre pays étant le premier marché en Europe. Par ailleurs, l’Union européenne est en train de devenir un énorme producteur d’herbe de cannabis. Le grand acteur en la matière est aujourd’hui l’Espagne qui a ses dernières années, semble-t-il, dépassé les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
Mais revenons à la situation française. Si le marché des drogues est prospère, c’est qu’il y a beaucoup de consommateurs…
Effectivement, la dimension de la demande est primordiale. Depuis 20 ans, elle a considérablement augmenté. Pour le cannabis, les consommations de résine et d’herbe ont crû d’environ 45 % et la France compterait 5 millions d’usagers dans l’année, dont 850 000 consommateurs quotidiens. Pour la cocaïne et l’ecstasy, les consommations ont quintuplé. En 2017, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, la France comptait plus de 600 000 usagers dans l’année de cocaïne et 400 000 d’ecstasy. C’est donc un marché en pleine croissance. Face à cette demande, une offre s’organise, avec des milliers de points de deal qui maillent le territoire. Un point de deal, selon le ministère de l’Intérieur, est un lieu de revente implanté dans l’espace public, structuré, avec notamment toute une division du travail (gérants, vendeurs, guetteurs, « nourrices », collecteurs d’argent, etc.). Leur multiplication constitue un défi majeur pour l’État, car ces enclaves criminelles tendent à lui contester le monopole de la violence et peut exercer, comme on l’a vu dans certains cas, une influence sur les pouvoirs politiques locaux par la corruption. Il faut savoir que les points de deal constituent la pointe émergée de l’iceberg et que les milliards d’euros engendrés par cette économie parallèle nourrissent aussi une criminalité en col blanc spécialisée dans le blanchiment. Le seul marché de la cocaïne est estimé à un peu moins de 2 milliards d’euros. Il aurait quasiment doublé entre 2010 et 2017.
Qu’en est-il de l’articulation entre les réseaux de trafic implantés en France et le marché mondial ? Comment cela se coordonne-t-il ?
L’économie des drogues, comme n’importe quelle économie, se caractérise par une division du travail impliquant, du producteur au consommateur, un nombre d’intervenants considérable. On peut même affirmer qu’à mesure de son déploiement planétaire, elle se sophistique de plus en plus. Pour un groupe criminel français, importer de grosses quantités de résine de cannabis ou de cocaïne implique la maîtrise d’un certain nombre de savoir-faire conséquents. Il faut de bons contacts avec les grossistes locaux, une maîtrise de la logistique et de l’ingénierie financière. Il en va de même d’ailleurs pour les détaillants. Il est notable que l’on assiste à une parcellisation des tâches. Certains groupes sont spécialisés par exemple dans l’acheminement et le convoyage des produits. Aujourd’hui le paysage criminel est très éclaté. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n’existe pas en France d’organisations tentaculaires qui exerceraient une hégémonie sur le marché, mais une multitude d’organisations indépendantes, pilotées depuis le Maroc, l’Algérie, Dubaï, par ce que j’appelle « la bourgeoisie du trafic », qui peuvent coopérer ou se livrer, c’est selon, une concurrence féroce. On le voit par exemple à Marseille en ce moment au sein des filières franco-maghrébines ou aux Pays-Bas et en Belgique avec la prétendue « mocro-maffia », qui n’est rien d’autre qu’une nébuleuse de bandes issues de l’immigration marocaine dont certaines ont fini par acquérir une puissance critique du fait de leur rôle croissant, d’Anvers à Rotterdam, dans le marché de la cocaïne en Europe.
En France, vous évoquiez Le Havre qui devient une véritable porte d’entrée de la cocaïne. Les ports sont donc les cibles, tout comme les aéroports ?
On estimait en 2022 que les trois-quarts des saisies de cocaïne réalisées en France le sont sur le vecteur maritime et notamment les porte-conteneurs. Il est frappant de constater à quel point ce trafic a épousé les grandes routes commerciales de la globalisation. Certains évoquent une « maritimisation » du crime. Compte tenu de l’hypertrophie du vecteur maritime dans la configuration de l’économie mondiale, les ports sont devenus des endroits névralgiques pour les échanges, qu’ils soient licites ou illicites. Chaque année, la seule Union européenne reçoit dans ses ports près de 90 millions de conteneurs. Au Havre, il y a depuis 10 ans une explosion des saisies de cocaïne qui font penser que ce port est aujourd’hui la première porte d’entrée de la cocaïne destinée au marché français. Une réalité qui va de pair avec des phénomènes très inquiétants. Le crime organisé s’implante dans les ports par la corruption et la violence. Ce sont les mêmes phénomènes qu’à Anvers. Il y a eu une étude intéressante, menée par une équipe de chercheurs sur les rémunérations offertes à des dockers de ce port pour récupérer des chargements de cocaïne. Cela peut aller de 1 000 euros par kg de cocaïne récupéré à plusieurs dizaines de milliers d’euros pour des grutiers déplaçant des containers. Le personnel administratif est visé également. Par exemple pour favoriser l’embauche de membres des organisations criminelles sur le port. Il semble que les émoluments soient les mêmes au Havre. Cette corruption s’accompagne de pressions sur le personnel, en particulier : menaces sur les familles, séquestrations accompagnées de tortures et, plus rarement, assassinats. Ce qui se passe à Anvers et Rotterdam se déroule aussi en France.
Et dans les aéroports ?
Une partie minoritaire, mais significative de la cocaïne destinée au marché français, arrive notamment via les réseaux surinamo-guyanais par le biais du transport aérien. Ce sont des quantités plus restreintes, mais qui, mises bout à bout, deviennent au fil du temps considérables. Une « mule » peut transporter, in corpore, jusqu’à 1 kg de cocaïne et plusieurs kilos dans ses bagages. Chaque année, grâce aux milliers de passeurs qui déjouent les contrôles douaniers, 15 à 20 % de la cocaïne consommée en France proviendrait de la Guyane. C’est donc une réalité très importante qui n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis dix ans.
Vous avez évoqué la corruption au Havre, est-ce que c’est un phénomène répandu dans le reste du pays ?
J’y consacre tout un chapitre de mon livre. C’est difficile à dire. Au vu des affaires qui scandent l’actualité, on peut affirmer qu’à défaut d’être répandue, la corruption se répand. Notamment dans les municipalités qui sont confrontées à l’existence d’enclaves et qui transigent avec certains criminels en pratiquant notamment la politique dite des « grands frères ». Pour avoir la « paix » dans ces quartiers, certains édiles distribuent de l’argent public à des associations plus ou moins fictives contrôlées par des « caïds » qui, en échange, leur apportent des voix. Les villes de Corbeil-Essonnes et de Marseille, dans les années 2000, ont été marquées par des scandales impliquant des élus. Depuis, il y en a eu beaucoup d’autres, notamment dans des communes de Seine-Saint-Denis, comme Bagnolet, Saint-Denis, Aubervilliers ou encore Bobigny. J’invite vos lecteurs à lire le petit opuscule édifiant de Didier Daeninckx, Banlieue naufragée, aux éditions Gallimard, sur la situation dans l’ancienne banlieue rouge. Le dernier scandale en date, qui illustre le développement des trafics dans les petites villes, est celui de Canteleu, une commune de 15 000 habitants située au nord de Rouen. Soupçonnée de liens avec une bande particulièrement active, la maire a dû démissionner. Il y avait de telles pressions des dealers qu’elle cédait à presque toutes leurs revendications. L’enquête en cours n’a pas permis d’établir s’il y avait corruption. On peut penser que cette femme avait peur. Tout simplement.
Vous évoquiez certains quartiers tenus par les criminels. On voit notamment les conséquences dans les violences à Marseille où l’on dénombre 23 morts par balle depuis le 1er janvier. Il y a donc un accroissement des violences entre les gangs ?
En termes quantitatifs, cette vague de règlements de compte est probablement sans précédent depuis 40 ans, même si, en 1985-86, les guerres de succession dans le milieu marseillais, après la mort de Gaëtan Zampa, l’une des grandes figures du milieu marseillais, avaient fait des dizaines de morts dans les Bouches-du-Rhône à cette époque. Les années 1970 avaient été marquées aussi par des massacres mémorables comme les tueries du Tanagra ou du bar du Téléphone. Néanmoins, la différence entre hier et aujourd’hui est moins quantitative que qualitative. C’est la différence entre l’ancien milieu corso-marseillais et la configuration de la criminalité aujourd’hui. On a l’impression que celle-ci est beaucoup moins structurée, notamment autour de figures de figures charismatiques capables de pacifier et de réguler la concurrence consubstantielle aux activités du crime organisé. La situation paraît aujourd’hui beaucoup plus anarchique et surtout affecte directement la population qui vit dans les quartiers occupés par les bandes criminelles. L’ancien milieu marseillais, spécialisé dans la production et les trafics d’héroïne, ne contrôlait pas militairement des quartiers entiers de Marseille. Dans les années 1960 et 1970, l’héroïne était alors produite dans l’arrière-pays marseillais dans des maisons individuelles où des chimistes fabriquaient l’héroïne, laquelle était directement exportée vers les États-Unis. Selon les services antidrogues, 75 % de l’héroïne qui était importée aux États-Unis provenaient de France. Il n’y avait donc pas les nuisances qu’on voit aujourd’hui avec la dissémination des points de vente, plus d’une centaine, ancrés territorialement, qui happent une partie de la jeunesse dans des carrières criminelles et y pourrissent la vie des habitants.
Est-ce que la police et la justice sont assez efficaces dans la lutte contre les trafiquants ?
Visiblement non si l’on considère le développement du marché des drogues depuis 20 ans. Il y a aujourd’hui des milliers de points de deal, qui innervent les métropoles comme les villes moyennes. À cette réalité s’est ajoutée depuis une dizaine d’années, l’implantation de réseaux albanais, singulièrement dans la région Rhône-Alpes, sur le marché de l’héroïne ou Géorgiens spécialisés dans les trafics de médicaments opioïdes. Pourtant, des saisies historiques de cannabis, de cocaïne, et même d’héroïne ont été réalisées en France en 2022. Mais ce qui est très inquiétant est que cela semble n’avoir qu’impact très relatif sur le marché. Si on saisit tendanciellement de plus en plus de drogues, c’est aussi parce que la masse de substances en circulation ne cesse de croître. Si le marché était réellement affecté par ces saisies, il y aurait des situations de pénurie, les prix devraient alors augmenter et les teneurs diminuer. Or ce n’est pas le cas. Les prix de détail des principales substances illégales sont stables ou diminuent, tandis que leur pureté est en très forte augmentation. La lutte anti-drogue en France n’est pas assez efficace. Pourtant, sur le plan opérationnel, depuis 2020, l’État a considérablement augmenté les effectifs de l’Office antistupéfiants (OFAST), structure en charge de la lutte contre les trafics qui a remplacé l’OCRTIS, mais à l’évidence cela n’est pas suffisant.
D’après vous, quelles seraient les solutions pour que cette lutte soit efficace ?
Il y a un début de prise de conscience du danger que constituent la montée en puissance du crime organisé et la prolifération des enclaves où sévit en outre le « fréro-salafisme ». En décembre 2022, la Délégation parlementaire au renseignement du Sénat a produit un rapport qui s’inquiète de l’impact de la montée de la criminalité organisée liée aux drogues. Il évoque, je cite, « une menace en pleine expansion », et un possible devenir « narco-État » de la France. À Marseille, des policiers évoquent, devant la montée des règlements de comptes, sur fond d’actes de barbarie, de fusillades à l’arme de guerre, un processus de « mexicanisation ». Il s’agit donc de faire de la lutte contre la criminalité organisée une priorité nationale. Jusqu’à maintenant, beaucoup d’observateurs ont le sentiment que la réponse des gouvernements qui se succèdent est d’ordre réactive. Il faudrait, au-delà des « rustines » consistant à envoyer des renforts ici ou là, élaborer un plan pluriannuel accompagné d’une stratégie consistant notamment à renforcer la réponse pénale tant sur le plan des moyens matériels et humains que des peines prononcées. Cette question est déterminante comme l’a montrée par le passé l’éradication des filières françaises de l’héroïne. La loi du 31 décembre 1970, dans son volet réprimant la production et le trafic de stupéfiants en bande organisée, a en effet permis en durcissant considérablement les peines prononcées de dissuader certains acteurs de persister dans la production et le trafic d’héroïne. Les criminels sont aussi des êtres rationnels. Or, un rapport européen publié il y a quelques années a montré que cette réponse pénale en France en matière de trafics de stupéfiants est une des moins sévères d’Europe. Tout cela dans un contexte où, faute d’effectifs suffisants, les magistrats sont débordés.
À Marseille, une poignée de magistrats gèrent chacun des dizaines de dossiers particulièrement complexes. Il faudrait, dans l’esprit qui a présidé à la mise en place des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) en 2004, créer un parquet national antistupéfiant, systématiser les cours d’assises spéciales au lieu de recourir à l’expédient de la correctionnalisation comme on l’a vu récemment pour un réseau implanté à Saint-Ouen dans la cité des Boute-en-Train. Il n’est pas acceptable par exemple que des membres de la mafia albanaise interpellés en France pour trafic d’héroïne ne soient condamnés qu’à des peines de deux à trois ans de prison avec des obligations de quitter le territoire français (OQTF) qui ne sont pas ou peu exécutés. Il en va de même pour les ressortissants des filières sénégalaises du crack qui perdurent depuis une trentaine d’années dans la région parisienne ou plus récemment des filières sino-vietnamiennes impliquées dans la production de masse du cannabis. La loi punit la production illicite de stupéfiants en bande organisée d’une peine maximale de 30 ans de prison. Une simple application de celle-ci dissuaderait nombre d’acteurs potentiels de se risquer à la violer. L’adage, en vogue dans les années 1970 en Italie, dans les milieux brigadistes « En frapper un, pour en éduquer cent » s’applique ici parfaitement.
Dans les politiques publiques, la question de la légalisation est de plus en plus posée. Avec le recul des différents modèles de légalisation, quel bilan peut-on dresser ?
De plus en plus de pays légalisent le cannabis à des fins récréatives à travers le monde. Récemment, dans l’Union européenne, Malte, l’Allemagne et le Luxembourg, viennent de le décider. En 2013, l’Uruguay a été le premier État souverain à le faire, suivi par le Canada, tandis qu’aux États-Unis une vingtaine d’États à ce jour ont mis en place un système de régulation malgré la loi fédérale qui continue de prohiber le cannabis. Indépendamment du terme « légalisation », qui agit chez ses partisans comme une formule magique qui résoudra tous les problèmes, il faut regarder, les dispositifs concrets mis en place. Dans mon livre, j’explique que le modèle adopté par la plupart des États américains n’est pas le bon. C’est un modèle très libéral sur le plan économique, qui confie la production du cannabis à des entreprises privées. Or la logique du privé est de faire un maximum de profit en élargissant le marché. Le Colorado, l’un des premiers États à partir de 2012-2014 à avoir légalisé le cannabis, a connu une explosion des consommations chez les adultes. Et pour faire plus de profits, les entreprises mettent sur le marché des concentrates, c’est-à-dire des formes de résine et d’huile de cannabis à des taux de THC de 60 à 80 %, plus chères, aux effets potentiellement néfastes en termes de santé publique. Ce type de légalisation n’est donc pas assez régulée. En outre, l’impact sur les réseaux criminels est relatif puisque malgré la forte croissance de l’offre légale, la part du marché noir, 30 %, reste considérable. Les groupes criminels ont profité du fait que le cannabis légal est par définition taxé, ce qui leur permet de proposer le produit à des prix compétitifs. Il y a aussi ce que les policiers appellent « l’effet ballon », c’est-à-dire des reports sur d’autres drogues. Si le trafic de cannabis a diminué aux États-Unis, ceux de méthamphétamine, de cocaïne et surtout de fentanyl ne cessent de prospérer. Compte tenu de ce bilan très mitigé, s’il décidait de légaliser, l’État serait donc avisé de mettre en place en France un monopole fixant les prix et limitant les taux de THC et interdisant la vente aux mineurs. Ce processus devra être en outre accompagné d’une stricte application de la loi pour ceux qui continueront à produire illégalement du cannabis ou d’en vendre aux mineurs. Sinon, le chaos s’installera rapidement au risque de favoriser les activités du crime organisé et de remettre en cause une des rares tendances positives du marché des drogues illégales en France : la forte baisse des consommations chez les adolescents. On le voit si incontestablement la prohibition pose un certain nombre de problèmes, la légalisation en crée aussi de nouveaux et ne saurait faire figure de remède miracle nous épargnant la confrontation avec un crime organisé posant au pays des défis d’ordre existentiels.
Michel Gandilhon (Conflits, 2 juin 2023)