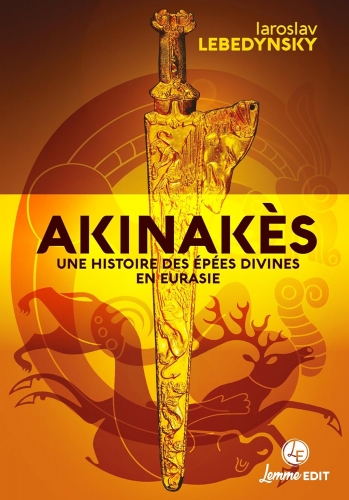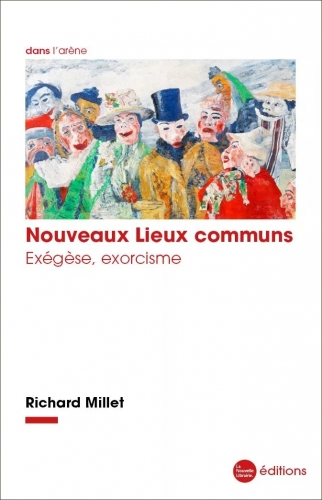JAVIER PORTELLA. Il y a cinquante ans, tu lançais avec une poignée de camarades et d’amis ce que l’on appellera plus tard la Nouvelle Droite. Quelle tâche ! Car il ne s’agissait pas seulement de défendre ou de s’opposer à telles ou telles idées, revendications, conflits… Il s’agissait – et il s’agit toujours – de transformer l’ensemble de notre vision du monde, c’est-à-dire la configuration d’idées, sentiments, aspirations… dans laquelle nous, hommes d’une époque donnée, vivons et mourons. Puisque ce qui est cherché, c’est quelque chose de nouveau, de différent, il est clair qu’il faut le trouver en dehors des deux grands piliers (à moitié démolis, d’ailleurs) que nous appelons « droite » et « gauche ». Or, ne penses-tu pas que les nouveaux piliers voués à soutenir le Vrai, le Beau et le Bien sont plus proches de l’esprit de la droite – pour autant qu’elle ne soit ni libérale, ni théocratique, ni ploutocratique – que de celui d’une gauche qui, dans le meilleur des cas, restera toujours individualiste, égalitariste et matérialiste ?
ALAIN DE BENOIST : Je me méfie des singuliers à majuscule. Je connais des choses belles et des choses laides, des choses bonnes et des choses mauvaises, mais le Beau et le Bien en soi je ne les ai encore jamais rencontrés. Il en va même de la gauche et de la droite. « La droite » et « la gauche » n’ont jamais existé. Il y a eu toujours des droites et des gauches (au pluriel), et la question de savoir si l’on peut trouver un dénominateur commun à l’ensemble de ces droites et à l’ensemble de ces gauches reste discutée. Tu le reconnais toi-même quand tu parles d’une droite qui ne serait « ni libérale, ni théocratique, ni ploutocratique » : c’est bien la preuve qu’à côté de la droite que tu apprécies il y en a d’autres. Mais pour parler de la gauche, tu repasses immédiatement au singulier ! C’est une erreur. De grands penseurs socialistes comme Georges Sorel et Pierre-Joseph Proudhon n’étaient ni individualistes, ni égalitaristes, ni matérialistes. Même chose pour George Orwell, Christopher Lasch ou Jean-Claude Michéa. Il ne faut pas non plus confondre la gauche socialiste, qui a défendu les travailleurs, et la gauche progressiste, qui défend les droits de l’homme (ce n’est pas la même chose). Tout ce qu’on peut dire, c’est que l’égalitarisme, pour ne prendre que cet exemple, se rencontre historiquement plus souvent « à gauche » qu’« à droite ». Mais quand on a dit cela, on n’a pas dit grand-chose, ne serait-ce que parce qu’il y a aussi « à droite », dans la droite libérale notamment, des formes d’inégalitarisme que je trouve tout à fait inacceptables. C’est la raison pour laquelle je crois qu’il faut juger au cas par cas plutôt qu’à partir d’étiquettes qui sont toujours équivoques. Comme je l’ai dit souvent, les étiquettes c’est pour les bocaux de confiture ! Il ne faut pas céder au fétichisme des mots.
Je pense que l’un et l’autre nous apprécions des types humains qui sont porteurs des valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons. Ces types humains sont plus fréquents « à droite » qu’« à gauche », ce que je reconnais volontiers. En ce sens, je me sens tout à fait « de droite », mais sans en faire un absolu. Les valeurs sont une chose, les idées en sont une autre. C’est pourquoi je n’ai aucun mal à me sentir « de droite » d’un point de vue psychologique et anthropologique tout en reconnaissant la justesse de certaines idées qui sont généralement, à tort ou à raison, attribuées à « la gauche ».
JAVIER PORTELLA. Quel est ton sentiment, au terme de ces cinquante années riches en réflexions, combats, victoires… et, bien sûr, l’une ou l’autre défaite ? Je suppose que tu te réjouis de constater que l’esprit que la Nouvelle Droite incarne au sens le plus large, s’il n’est pas encore devenu « l’horizon spirituel de notre temps » (comme Sartre le disait du marxisme), il a quand même fini par marquer l’air intellectuel en France ; sans oublier sa présence, quoique moins vigoureuse, dans des pays comme l’Italie, l’Allemagne, la Hongrie, l’Espagne même…
ALAIN DE BENOIST : C’est l’éternelle histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Oui, en cinquante ans, il y a eu beaucoup de succès. Non seulement la ND n’a pas disparu (un demi-siècle d’existence pour une école de pensée, c’est déjà extraordinaire), mais les thèmes qu’elle a introduit dans le débat d’idées ont largement diffusé dans la plupart des pays européens. En témoignent les milliers d’articles, de livres, de conférences, de colloques, de traductions, de rencontres, qui ont marqué ces cinquante dernières années. Cela dit, il faut aussi être réaliste : ces points que nous avons marqués n’ont pas empêché les forces du chaos de progresser. L’« horizon spirituel de notre temps » n’a rien de spirituel : c’est un horizon de déclin, et ce déclin s’accélère tous les jours. Déclarer, comme il est souhaitable, que « le nihilisme ne passera pas par moi » n’y change rien. Comme disait Jean Mabire, nous n’avons pas changé le monde, mais au moins le monde ne nous a pas changés. Ajoutons que la « lutte finale » n’est pas encore survenue.
JAVIER PORTELLA. Parmi les différents phénomènes qui peuplent le monde d’aujourd’hui, quels sont ceux qui te semblent les plus porteurs d’espérance et ceux qui te paraissent les plus désespérants ? Tout est évidemment imbriqué dans le grand entremêlement de phénomènes sociaux, culturels et politiques qui font un monde, mais lequel de ces phénomènes te semble-t-il être notre principal ennemi et lequel notre plus grand ami ?
ALAIN DE BENOIST : Il est évidemment plus facile de répondre à la seconde question qu’à la première, car la réponse s’étale sous nos yeux. Les trois plus grands dangers qui nous menacent aujourd’hui sont à mon sens les suivants. Il y a d’abord les ravages de la technique et les conditionnements qu’elle implique à l’époque de l’intelligence artificielle et de l’omniprésence des écrans, ce qui laisse prévoir à terme le Grand Remplacement de l’homme par la machine. Sur ce plan, nous n’en sommes encore qu’au début : le transhumanisme prône déjà la fusion de la machine et du vivant. Il y a ensuite la marchandisation du monde, qui est l’un des piliers de l’idéologie dominante, avec le ralliement des esprits à la logique du profit et à l’axiomatique de l’intérêt, c’est-à-dire la colonisation de l’imaginaire symbolique par l’utilitarisme et la croyance que « l’économie c’est le destin », conformément à une anthropologie libérale fondée sur l’économisme et l’individualisme, qui ne conçoit l’homme que comme un être égoïste visant en permanence à maximiser son meilleur intérêt privé. Son moteur principal est évidemment le système capitaliste, qui cherche à supprimer tout ce qui peut faire obstacle à l’expansion du marché (souveraineté nationale et souveraineté populaire, objections morales, identités collectives et particularités culturelles) et à discréditer toutes les valeurs autres que les valeurs marchandes. Le troisième danger, enfin, c’est le règne quasi planétaire d’une idéologie dominante fondée sur l’idéologie du progrès et l’idéologie des droits de l’homme qui généralise le chaos dans un monde de plus en plus voué au nihilisme : réduction de la politique à la gestion technocratique, vogue de la « cancel culture », délires de la théorie du genre propagés par le lobby LGBT, néoféminisme prônant la guerre des sexes, effondrement de la culture générale, pathologies sociales engendrées par une immigration aussi massive qu’incontrôlée, déclin de l’école, disparition programmée de la diversité des peuples, des langues et des cultures – et tant d’autres choses encore.
L’ennemi principal, pour moi, reste plus que jamais l’universalisme sur le plan philosophique, le libéralisme sur le plan politique, le capitalisme sur le plan économique et le monde anglo-saxon sur le plan géopolitique.
Les phénomènes « porteurs d’espérance » ? On ne peut aborder ce sujet qu’avec prudence. Outre que l’histoire reste toujours ouverte (elle est par excellence le domaine de l’imprévu, disait souvent Dominique Venner), il est évident que nous vivons aujourd’hui une période de transition et de crise généralisée. L’idéologie dominante est bel et bien dominante (d’autant qu’elle est toujours l’idéologie de la classe dominante), mais elle s’effrite partout. La démocratie libérale, parlementaire et représentative, est de plus en plus discréditée. La montée des populismes, l’apparition des démocraties illibérales et des « Etats civilisationnels », les tentatives de démocratie participative et de renouveau civique à la base, vont de pair avec le fossé qui ne cesse de se creuser entre le peuple et les élites. La classe politique traditionnelle est discréditée. Toutes les catégories professionnelles se mobilisent et la colère gronde partout, ce qui laisse envisager des révoltes sociales de grande ampleur (le moment classique où « en haut on ne peut plus, tandis qu’en bas on ne veut plus »). Dans le même temps, à l’échelle internationale, les choses bougent. On rebat les cartes entre les puissances. Les Etats-Unis d’Amérique sont eux-mêmes la proie d’une crise profonde, et l’on semble s’acheminer vers la fin d’un monde unipolaire ou bipolaire pour aller vers un monde multipolaire, ce qui me paraît une très bonne chose. Un nouveau clivage oppose les BRICS (les puissances émergentes) à l’« Occident collectif ». Dans une telle situation, les fenêtres d’opportunité sont nombreuses. Encore faut-il, pour les exploiter, renoncer aux outils d’analyse périmés et être attentifs à ce qui s’annonce.
JAVIER PORTELLA. Que penses-tu de cette bombe à retardement dans laquelle deux hécatombes sont en train de se télescoper ? D’une part, le fait que les Européens semblent décidés à ne plus procréer ; d’autre part, une immigration si massive qu’elle ressemble plutôt à une invasion… encouragée, certes, par les « élites » elles-mêmes des pays envahis. Vois-tu quelque chose qui pourrait ressembler, sinon à une solution, du moins à un moyen d’amortir l’explosion d’une telle bombe ? Tu as parfois déclaré que la remigration forcée que certains proposent ne te semble pas faisable. Tu as probablement raison, étant donné le sentimentalisme bien-pensant qui imprègne tout. Mais si la remigration n’est pas possible, quelle serait alors l’alternative ? Ne nous resterait-il qu’à baisser les bras et crever ?
ALAIN DE BENOIST : L’immigration est en effet une catastrophe puisque, passé un certain seuil, elle entraîne un changement de l’identité et de la composition des peuples. On n’y remédiera pas en se lançant dans une sorte de course à la natalité, qui est perdue d’avance. Je ne crois pas non plus à la remigration (pas plus qu’à l’assimilation ou à la « laïcité »), parce qu’elle n’est tout simplement pas possible dans les conditions présentes. Tout comme la « Reconquista », c’est un mythe-refuge. La politique, c’est d’abord l’art du possible. Mais il n’est évidemment pas question de baisser les bras. Quand la volonté politique est présente (ce qui n’est guère le cas aujourd’hui), on peut, sinon stopper l’immigration, sinon la ralentir de façon drastique, ne serait-ce qu’en supprimant les dispositions sociales et sociétales qui la favorisent en jouant un rôle de « pompes aspirantes ». Les moyens ont été indiqués de longue date. Mais si la volonté politique est un facteur décisif, ce n’est pas le seul. Il faut aussi la possibilité de l’exercer. Or, toutes les mesures sérieuses visant à stopper l’immigration sont aujourd’hui bloquées par un gouvernement des juges, sans légitimité démocratique, mais qui prétend s’imposer à la fois aux gouvernements des États et à ce que veulent les peuples. Pour dire les choses clairement, aucun gouvernement ne mettra fin à l’immigration s’il ne décide pas de tenir pour nulles et non avenues les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. Et s’il continue à obéir à l’idéologie libérale.
L’immigration correspond en effet à la mise en œuvre du principe libéral du « laissez faire, laissez passer », qui s’applique aussi bien aux hommes qu’aux capitaux, aux services et aux biens. Le libéralisme est une idéologie qui analyse la société à partir du seul individu et ne reconnaît pas que les cultures ont une personnalité propre. Voyant dans l’immigration l’arrivée d’un nombre supplémentaire d’individus dans des sociétés déjà composées d’individus, il tient les hommes pour interchangeables. Le capitalisme, quant à lui, milite depuis longtemps pour l’abolition des frontières. Le recours à l’immigration est pour lui un phénomène économique naturel. Partout, c’est le grand patronat qui demande toujours plus d’immigrés, notamment pour pouvoir exercer une pression à la baisse sur les salaires des travailleurs autochtones. C’est en ce sens que Karl Marx a pu dire très justement que les immigrés, c’est « l’armée de réserve du capital ». Ceux qui critiquent l’immigration tout en adorant le capitalisme feraient donc mieux de se taire. Il ne sert à rien de condamner les conséquences quand on se garde bien de toucher aux causes.
JAVIER PORTELLA. Comme tu l’as toi-même parfois souligné, la situation actuelle de nos sociétés est caractérisée par la tension découlant d’une dualité typiquement prérévolutionnaire : l’ancien monde s’effondre, tandis que le nouveau n’est pas encore là, même si tout un malaise, exprimé dans plein de mouvements et de combats (l’actuelle jacquerie paysanne, par exemple), devient de plus en plus puissant. La question est alors : pourquoi un tel malaise – tu t’en plaignais à demi-mots dans un éditorial récent d’Éléments – ne parvient-il pas à déboucher sur des victoires concluantes et conduisant à un véritable renversement de la situation ? L’une des raisons ne pourrait-elle pas être qu’un tel malaise est le fait surtout des couches populaires, alors qu’il ne concerne guère les foules des grandes métropoles et encore moins nos « élites » ? Pour ce qui est de ces dernières, penses-tu qu’il soit envisageable de changer le monde sans qu’une partie significative de ces « élites », tout à fait indignes pour l’instant, ne se joigne au grand chambardement qu’il faut espérer ? Toutes les grandes révolutions que l’histoire a connues, se seraient-elles jamais produites si un tel changement de bord n’avait pas vu le jour ?
ALAIN DE BENOIST : Rappelons d’abord que, comme Pareto l’a montré, le mot « élite » est un mot neutre : il y a aussi une élite des trafiquants et des escrocs. Les « élites » de nos sociétés, qu’elles soient politiques, économiques ou médiatiques, sont faites d’hommes (et de femmes) généralement bien instruits et intelligents (mais pas toujours), qui n’en ont pas moins accumulé les échecs dans tous les domaines. Ce sont des gens coupés du peuple qui vivent hors-sol, dans un univers mental transnational et nomade. Ils sont tout autant coupés du réel. Je ne vois pas l’utilité de les voir se joindre au « grand chambardement » dont tu parles, et encore moins la nécessité d’accepter des compromis pour tenter de les séduire. En revanche, il est clair que les classes populaires, qui se dressent aujourd’hui contre ces « élites », ont besoin d’alliés. Elles les trouveront de plus en plus en raison du déclassement des classes moyennes. C’est de cette alliance des classes populaires et des déclassés des classes moyennes que peut sortir le bloc historique qui finira par s’imposer. Si cela finit par arriver, on verra de toute façon des opportunistes d’en haut se solidariser des révoltés d’en bas ; on a déjà vu cela aussi dans toutes les grandes révolutions de l’histoire. Et comme d’habitude, c’est du peuple que sortiront les nouvelles élites, authentiques celles-là, dont nous avons besoin.
JAVIER PORTELLA. Vu ta mise en question, bien connue, du capitalisme, certains ont parfois prétendu que la Nouvelle Droite serait devenue plutôt une espèce de Nouvelle Gauche… Blagues à part, la véritable question est : que faire avec le capitalisme ? En finir avec lui, me diras-tu. Certes, mais pour mettre quoi à sa place ? S’agirait-il, d’aventure, de remplacer le capitalisme par la propriété étatique des moyens de production ? Faudrait-il abolir, comme les communistes l’ont fait partout, le marché et la propriété ? Non, ajouteras-tu sans doute. Mais alors, s’il s’agit d’abolir les injustices criantes du capitalisme tout en sauvegardant le marché, l’argent et la propriété – mais placés hors de la clé de voûte où ils se tiennent aujourd’hui –, n’est-ce pas là, sur le plan strictement économique, d’une sorte de réformisme qu’il s’agit ?
ALAIN DE BENOIST : « Il est plus facile pour nos contemporains d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme », disait en 2009 le théoricien britannique Mark Fisher. Quand on est dans cet état d’esprit, on se demande, ainsi que tu le fais toi-même, comment on pourrait sortir du capitalisme et par quoi on pourrait le remplacer. Ce faisant, et sans s’en rendre compte, on naturalise abusivement un phénomène historique parfaitement localisé. L’humanité a vécu sans capitalisme pendant des milliers d’années, pourquoi ne serait-elle pas capable de le faire à nouveau demain ? Le capitalisme, ce n’est pas toute l’économie, ni même toutes les formes d’échange. Le capitalisme, c’est le règne du capital. Il apparaît lorsque l’argent devient capable de se transformer en un capital qui s’augmente perpétuellement de lui-même. C’est aussi la transformation des rapports sociaux selon les exigences du marché, le primat de la valeur d’échange sur la valeur d’usage, la transformation du travail vivant en travail mort, la disparition du métier au profit de l’emploi, etc. Un tel système ne peut fonctionner que s’il progresse constamment (il s’effondre s’il s’arrête, c’est comme la bicyclette), ce qui signifie que son principe est l’illimitation. Sa loi est celle de l’hubris, de la démesure, de la fuite en avant dans le « toujours plus » : toujours plus de marché, de profits, de libre-échange, de croissance, toujours moins de limites et de frontières. La mise en œuvre de ce mot d’ordre a abouti à l’obsession du progrès technique, à la financiarisation grandissante d’un système qui a depuis longtemps perdu tous ses ancrages nationaux, et subsidiairement à la dévastation de la Terre.
L’opposition de principe entre le public et le privé est elle-même une idée libérale. Sortir du capitalisme, ce n’est donc nullement remplacer l’initiative privée par la propriété étatique des moyens de production, qui ne résout rien (l’ancienne URSS était un capitalisme d’Etat). Ce n’est pas non plus faire disparaître toute forme de marché, mais plutôt favoriser le local par rapport au global, le circuit court sur le commerce à grande distance. Et ce n’est évidemment pas non plus supprimer la propriété privée, sans toutefois en faire un absolu comme le font les libéraux. Le tiers secteur est déjà une réalité, les coopératives et les entreprises mutualistes aussi. Au-delà de l’opposition factice entre le privé et l’étatique, il y a les communs tels qu’on les entendait jusqu’à la naissance de l’idéologie libérale. C’est dans cette redéfinition de ces communs qu’il faut s’engager, afin de mettre en place une économie de type communautaire, concernant en priorité les membres de telle ou telle communauté. Il n’y a là rien de réformiste si l’on considère qu’une telle évolution exige une transformation radicale des mentalités.
Le capitalisme est aujourd’hui lui-même en crise. Les marchés financiers raisonnent au jour le jour, les déficits publics atteignent des niveaux records, l’« argent fictif » circule à pleins tuyaux, et tout le monde s’inquiète d’une possibilité d’effondrement du système financier mondial. Ce n’est pas forcément une perspective agréable quand on sait qu’en général, c’est sur une guerre que débouche ce genre de crise.
JAVIER PORTELLA. Pour en revenir à ma question précédente. Si le réformisme est l’alternative au capitalisme en tant que système économique, n’en va-t-il pas autrement pour tout le reste ? J’entends par là l’état d’esprit, la vision du monde pour laquelle la soif d’argent constitue le centre de tout, tandis que la vie – la vie publique, mais cela marque aussi la vie privée – se trouve régie par l’esprit de la démocratie libérale et partitocratique, individualiste et égalitariste (elle nivelle tout par le bas) que nous connaissons. Un tel état des choses, s’agirait-il de le réformer, de l’amender – et donc, finalement, d’en sauvegarder les rouages essentiels ? Ou s’agirait-il de tout le contraire ? En un mot comme en cent, pourquoi nous battons-nous : pour des réformes ou pour la révolution ?
ALAIN DE BENOIST : Nous ne nous battons certainement pas pour des réformes. Ce à quoi nous aspirons, c’est à ce que Heidegger appelait un « nouveau commencement ». Non pas refaire ce que d’autres ont fait avant nous, mais s’inspirer de leur exemple pour innover à notre tour. Remplacer la démesure capitaliste par le sens des limites, lutter contre l’universalisme au nom des identités collectives, substituer l’éthique de l’honneur à la morale du péché, réorganiser le monde sous une forme multipolaire (le « pluriversalisme » contre l’universalisme), privilégier les valeurs de communauté sur les valeurs de société, lutter contre le remplacement de l’authentique par l’ersatz et du réel par le virtuel, redéfinir le droit comme l’équité dans la relation (et non comme un attribut dont tout un chacun serait propriétaire à sa naissance), rétablir le primat du politique (le gouvernement des hommes) sur l’économie (la gestion des choses), redonner un sens concret à la beauté et à la dignité, réhabiliter l’autorité et la verticalité, ce serait bel et bien une révolution. Et même, osons le dire, une révolution telle qu’on n’en a jamais connu.
Alain de Benoist, propos recueillis par Javier Portella (Site de la revue Éléments, 25 mars 2024)