- Page 10
-
-
Quand la désindustrialisation tue...
Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Nicolas Goetzmann à Figaro Vox et consacré au recul de l'espérance de vie des Américains. Nicolas Goetzmann est économiste.

Aux États-Unis, la désindustrialisation tue
FIGAROVOX.- Une étude publiée par le Journal of the American Medical Association a révélé l’augmentation des taux de mortalité des 25-64 ans dans toutes les catégories de la population américaine, pour la première fois dans l’histoire du pays. Pourtant, les États-Unis ont le niveau de dépenses de santé par habitant le plus élevé du monde: n’est-ce pas paradoxal?
Nicolas GOETZMANN.- Entre 1959 et 2014, l’espérance de vie aux États-Unis est passée de 69.9 à 78.9 ans. Mais depuis lors, on assiste à un recul - pour trois années consécutives - pour en arriver à une espérance de vie de 78.6 ans en 2017. La nouvelle «donne» révélée par cette étude est que la classe d’âge qui est la plus frappée par cette hausse de la mortalité sont les 25-34 soit de +29 % entre 2010 et 2017. Les causes de ces décès ont d’ores et déjà été analysées en 2015 et ont été regroupées sous l’intitulé de «morts par désespoir» par le Prix Nobel d’économie Angus Deaton et l’économiste Anne Case (qui publieront un ouvrage en mars 2020 sur ce sujet): crise des opioïdes, maladies liées à alcool, suicides.
On peut effectivement se poser la question du système de santé américain, qui représente près de 18 % du PIB du pays, contre 11.5 % pour un pays comme la France. Ce système américain est le plus inégalitaire au monde, c’est un élément qui permet de comprendre ce paradoxe. On peut donc y voir une cause, mais d’autres facteurs sont en jeu.
Le fait principal est que l’on observe cette hausse de la mortalité dans des zones assez précises des États-Unis, la vallée de l’Ohio notamment. Un tiers des décès qui sont ici analysés ont eu lieu dans seulement quelques États qui sont également connus pour avoir été les principales victimes de la désindustrialisation ces dernières années, notamment suite au phénomène du «China Shock» mis en avant par les économistes David Autor, David Dorn et Gordon Hanson.
Entre la fin des années 60 et la fin de l’année 2000, le nombre d’emplois manufacturiers est resté stable aux États-Unis, soit environ 17 millions d’emplois. Mais entre 2000 et 2009, la chute a été vertigineuse, pour atteindre 11.5 millions d’emplois, soit une chute de plus de 30 % en moins de 10 ans: c’est le «choc chinois», c’est-à-dire les conséquences sur les emplois manufacturiers de l’entrée de la Chine dans l’OMC en décembre 2001. Ici encore, ce phénomène s’est concentré sur quelques États bien particuliers, dont l’Ohio.
On peut donc voir une cause liée au système de santé, mais aussi une cause plus profonde liée au désespoir engendré par la désindustrialisation. On doit tout de même ajouter les scandales liés aux opioïdes, qui ont notamment abouti à la mise en faillite du groupe pharmaceutique Purdue pharma (Oxycontin), et la mise en cause de la Chine par Donald Trump sur la question du fentanyl (fabriqué dans des laboratoires en Chine et envoyé aux consommateurs américains). C’est un phénomène qui a épargné les pays européens pour le moment, mais dont les proportions sont importantes. Comme l’indiquait le site Vox.com, sur la seule année 2016, le nombre de décès par overdose a été supérieur à celui engendré par les 10 années de guerre du Vietnam.
Cette évolution souligne donc l’importance grandissante des décès liés à la consommation de drogue ou d’alcool, voire le suicide. Signe d’un malaise profond dans la société américaine?
L’économiste Anne Case le résumait très bien lors d’une interview donnée au Financial Times: «Il y a quelque chose de pourri qui se passait avant même l’introduction de l’Oxycontin (…) les gens veulent nourrir la bête du désespoir. Ils peuvent le faire avec des médicaments, avec de l’alcool, avec de la nourriture»
Il y a évidemment un malaise profond, et l’élection de Trump est un symptôme de ce même phénomène. Ici encore, plusieurs études ont montré les liens entre les zones affectées par les morts par désespoir, le «china shock», et le vote en faveur de Donald Trump. Mais il serait juste d’indiquer que ces zones étaient déjà fragilisées par le passage des années 80 et 90, qui ont été le point de départ de politiques économiques moins favorables aux salariés en comparaison de celles des 30 glorieuses. Ces zones étaient déjà fragilisées au moment du choc, et celui-ci a achevé le mouvement de façon brutale. Et les effets sociaux ne s’arrêtent pas là. Parce qu’il faut également prendre en compte d’autres paramètres ; la baisse du taux de mariage des jeunes adultes dans les zones qui ont été les plus affectées par la désindustrialisation, le niveau d’éducation, ou encore la baisse de la mobilité. L’ensemble de ces phénomènes ont été montrés au public par la littérature américaine depuis de nombreuses années, et l’image de cette Amérique pauvre n’est aujourd’hui plus une nouveauté. Lors d’une interview, Angus Deaton avait indiqué qu’il pouvait être «pire d’être pauvre dans le delta du Mississipi qu’au Bengladesh», pour souligner l’absurdité de la situation, et l’importance de la déstructuration à laquelle la société américaine fait face aujourd’hui.
Peut-on mesurer les risques de voir une telle situation se produire en Europe?
On peut observer un grand paradoxe entre une Europe privée de croissance depuis 10 ans, et dont le taux de chômage est encore de 7.5 %, et les États-Unis qui ont un taux de chômage au plus bas depuis 1969 (3.6 %), et une croissance qui continue de progresser à un rythme soutenu. Et pourtant, le malaise décrit n’a pas touché l’Europe de la même manière. À une exception, qui est le Royaume Uni - qui subit également une hausse de son taux de mortalité chez certaines populations - alors que le taux de chômage est également à un plus bas historique.
Nous avons d’un côté des pays qui parviennent à connaître une croissance forte, et à se placer dans une dynamique favorable, mais dont le niveau d’inégalités engendre une désespérance très forte d’une partie de la population, pour en arriver à une hausse de la mortalité. De l’autre, nous avons des pays européens qui continuent de s’affaisser d’un point de vue économique général mais dont la population résiste, relativement à ce qui est vécu aux États-Unis. Cette différence peut s’expliquer par la différence des modèles économiques.
Les pays anglo-saxons ont connu une période de «libéralisme économique classique» dont la conséquence a été un affaiblissement de l’État providence, mais qui ont su, au moins en partie, préserver une politique macroéconomique dynamique, notamment grâce à l’action des banques centrales. Le résultat est que le pays, dans son ensemble, continue d’avancer et conserve son rang au niveau mondial. Mais une partie importante de la population est laissée de côté. En Europe, si nous avons encore des structures d’État-providence suffisamment puissantes, notamment en France, la politique macroéconomique a été catastrophique depuis 10 ans. Les pays perdent leur rang de façon rapide (l’Union européenne représentait 30 % du PIB mondial en 2008, contre 21 % aujourd’hui), la population en souffre également, mais est encore protégée par des transferts sociaux, en comparaison des cas anglo-saxons.
Or, c’est tout le débat actuel sur le renouvellement du capitalisme qui est ici questionné. La période post-1945 s’était déjà caractérisée par la naissance d’un capitalisme nouveau, fondé sur les deux piliers que sont la recherche du plein-emploi (par le biais des Banques centrales) et l’État-providence. Il s’agissait alors d’une réaction au libéralisme des années 20 qui se combinait avec une protection accrue des populations en période de guerre froide. Lors du virage des années 80, les pays anglo-saxons ont remis en cause l’État-providence alors que les Européens ont abandonné la recherche du plein-emploi. Ce phénomène s’est accentué lors de la chute de l’URSS en 1991.
Mais aucun des deux systèmes n’est viable, c’est ce que nous voyons aujourd’hui. Les deux piliers sont nécessaires, la macroéconomie et l’État-providence. L’Europe doit faire un effort certain pour le premier, les pays anglo-saxons pour le second. Si les pays occidentaux veulent pouvoir connaître une période de croissance, de retour de leur puissance, tout en entraînant l’ensemble de la population dans cette dynamique, il s’agit encore de la solution la plus aboutie.
Nicolas Goetzmann, propos recueillis par Paul Sugy (Figaro Vox, 27 novembre 2019)
-
De Wagner au cinéma...
Les éditions Mimésis viennent de publier un essai de Laurent Guido intitulé De Wagner au cinéma - Histoire d'une fantasmagorie. Laurent Guido est professeur au département Arts à l’Université de Lille après avoir dirigé la section de cinéma de l'Université de Lausanne.
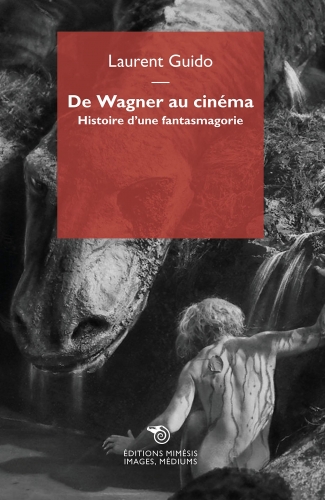
" Cet essai historique s'intéresse aux discours ayant pointé l'existence d'un rapport privilégié entre Wagner et le cinéma. Il s'agit de mettre en lumière les généalogies en vertu desquelles les milieux cinématographiques ont pu s'approprier une certaine esthétique propre au wagnérisme. Le lieu commun d'un Wagner proto-hollywoodien, tourmenté par l' "immersion" technologique, fait notamment débat. Une première partie aborde les réflexions ayant cherché à définir le cinéma en tant que synthèse des formes d'expression artistique, en revenant sur les propos de divers théoriciens cinématographiques comme sur les idées du scénographe Adolphe Appia ou du cinéaste S. M. Eisenstein. Une seconde partie envisage la référence à Wagner dans le domaine de la musique pour le film, plus particulièrement au travers du leitmotiv. Ancrée d'abord dans le grand spectacle "muet" , cette tradition s'est vue récemment revitalisée au travers de blockbusters comme Starwars ou The Lord of the Rings. ''
-
Le retour de la censure...
Vous pouvez découvrir ci-dessous Bercoff en liberté, une émission de Sud Radio, diffusée le 28 novembre 2019, au cours de laquelle André Bercoff recevait François-Bernard Huyghe à l'occasion de la parution de son essai L'art de la guerre idéologique (Cerf, 2019). Spécialiste de la stratégie et de la guerre de l'information, François-Bernard Huyghe enseigne à la Sorbonne et est l'auteur de nombreux essais sur le sujet, dont, récemment, La désinformation - Les armes du faux (Armand Colin, 2015), Fake news - La grande peur (VA Press, 2018) et, avec Xavier Desmaison et Damien Liccia, Dans la tête des Gilets jaunes (VA Press, 2019).
-
Une fin du monde toujours sans importance...
Les éditions de La Nouvelle Librairie viennent de publier le deuxième tome d'Une fin du monde sans importance, le recueil des chroniques de Xavier Eman, avec une préface d'Olivier Maulin. Animateur du site d'information Paris Vox , rédacteur en chef de la revue Livr'arbitres et collaborateur de la revue Éléments, Xavier Eman a déjà à son actif un premier tome de ses chroniques, Une fin du monde sans importance (Krisis, 2016), et un polar, Terminus pour le Hussard (Auda Isarn, 2019).

" Le vieux monde, celui des « boomers » et des soixante-huitards, des zombies libéraux-libertaires et des bobos à roulettes, n’était pas complètement enterré. Sur le cercueil, il manquait encore quelques clous que Xavier Eman vient poser dans ce second volume de ses chroniques, prolongées ici par une nouvelle inédite.
Xavier Eman est un tireur d’élite. Camouflé dans la ville, il observe attentivement, le doigt sur la gâchette. Tiens, un crétin qui poursuit un Pokémon Go, pan. Oh, un végan qui s’attaque à une boucherie familiale, pan. N’est-ce pas là un salaud d’animateur qui corrompt les esprits ? Pan, pan.
Le jeu de massacre est toujours aussi réjouissant. Accablant même, tant notre époque semble la reine tragique de la dépression médicamenteuse, du matérialisme névrosé, de la haine de soi, de la laideur institutionnalisée.
Parce qu’il vaut mieux en rire qu’en pleurer, ces pages nous aident à traverser cet âge des ténèbres, en attendant un nouveau cycle, plus lumineux. "
-
Le libéralisme comme règne du non-commun...
Nous reproduisons ci-dessous entretien avec Alain de Benoist, cueilli sur le site Critique de la raison européenne, dans lequel il évoque la question du libéralisme. Philosophe et essayiste, directeur des revues Nouvelle École et Krisis, Alain de Benoist a récemment publié Le moment populiste (Pierre-Guillaume de Roux, 2017), Ce que penser veut dire (Rocher, 2017) et Contre le libéralisme (Rocher, 2019).

Alain de Benoist : «Le libéralisme consacre le règne du non-commun»
Le terme « libéral » apparaît totalement galvaudé dans le débat public actuel. Pourriez-vous définir ce qu’est le projet libéral ?
Alain de Benoist : Comme pour tous les mots qui ont beaucoup servi (démocratie, progrès, etc.), il est difficile de donner une définition du libéralisme qui fasse l’unanimité. La difficulté se renforce du fait que, contrairement au marxisme, le libéralisme a eu de nombreux « pères fondateurs », et du fait aussi que ce qui relie le libéralisme économique au libéralisme politique, au libéralisme philosophique et au libéralisme « sociétal », n’est pas évident pour tout le monde. Le projet libéral, pour reprendre votre expression, est à mon sens un projet qui privilégie l’individu par rapport à tout ce qui l’excède en s’appuyant sur une anthropologie faisant de l’homme un être essentiellement mû par le désir de maximiser son intérêt personnel et son profit privé.
En quoi le libéralisme empêche-t-il de constituer une société qui ne serait pas qu’une somme d’intérêts particuliers ?
Il l’empêche pour la simple raison que toute société n’est à ses yeux qu’une somme d’intérêts particuliers. Du point de vue de l’idéologie libérale, ce n’est plus la société, mais l’individu qui vient en premier. Les sociétés, les peuples, les nations, les cultures, etc. n’ont pas d’existence en tant que tels : ils ne sont que des agrégats d’individus. Ces individus sont appréhendés comme fondamentalement autosuffisants, propriétaires d’eux-mêmes, capables à ce titre de se construire eux-mêmes à partir de rien – hors de tout déjà-là – sans que leurs choix puissent devoir quoi que ce soit à des appartenances qui leur préexistent. C’est en ce sens que Margaret Thatcher pouvait prétendre que « la société n’existe pas » (there is no society). Cette conception des choses, qui contredit à angle droit l’idée, remontant pour le moins à Aristote, selon laquelle l’homme est un animal politique social, est évidemment antagoniste de toute idée de bien commun. Du point de vue libéral, l’intérêt général se définit comme une somme d’intérêts particuliers dont on postule arbitrairement qu’ils peuvent s’harmoniser spontanément ou sous le seul effet des rapports juridiques et des mécanismes du marché. Le libéralisme consacre le règne du non-commun.
Selon le discours dominant aujourd’hui, la liberté libérale est la seule forme possible de la liberté. Or il existe dans l’histoire des idées d’autres façons de concevoir la liberté. Pourriez-vous en citer des exemples?
L’idéologie libérale ne veut pas connaître d’autre liberté que la liberté individuelle. Tout ce qui excède la liberté individuelle est posé comme une menace potentielle contre les droits des individus, le premier de ces droits étant en quelque sorte le droit d’avoir des droits. Cela transparaît clairement dans la façon dont le libéralisme s’oppose au politique, dont il veut toujours limiter l’autorité, en particulier vis-à-vis de l’économie. Historiquement parlant, le règne de l’idéologie libérale est indissociable de la montée de la classe et des valeurs bourgeoises, qui prétendaient lever tous les obstacles susceptibles de freiner les échanges commerciaux et la production de marchandises. Cette conception de la liberté est propre au libéralisme. Il en est heureusement (bien) d’autres. J’en donnerai deux exemples. Le premier est l’opposition bien connue, développée en son temps par le très libéral Benjamin Constant, entre la « liberté des Anciens » et la « liberté des Modernes ». La première se définissait comme ce qui permettait à tous les citoyens de participer aux affaires publiques, tandis que la seconde est au contraire ce qui permet aux individus de ne pas y participer et de se soustraire aux obligations civiques pour rechercher leur épanouissement dans le domaine du privé. Le second exemple est celui de la « liberté républicaine » telle qu’elle a été conçue par un courant de pensée allant de Tite-Live à Harrington en passant par Machiavel. Sa caractéristique principale est de lier liberté individuelle et liberté collective : je ne peux me considérer comme libre si le pays auquel j’appartiens ne l’est pas. La liberté est donc appelée à s’articuler avec le commun, ce que le libéralisme ignore entièrement.
Dans La Grande Transformation, Karl Polanyi explique que l’émergence de l’État-nation a permis le triomphe de la logique du marché et la destruction des structures et des solidarités organiques. Pourtant, l’État-nation semble aujourd’hui être la seule échelle à laquelle quelque chose du politique subsiste et l’un des derniers cadres de résistance au capitalisme financier. Nous pensons à « Critique de la raison européenne » qu’il doit donc être défendu. Comment vous situez-vous sur ce débat ?
Vous n’avez pas tort de penser que, dans les circonstances présentes, l’Etat-nation doit être défendu, mais j’ajouterai qu’il doit l’être comme un pis-aller. Il ne faut en effet pas se faire d’illusions. La souveraineté des Etats nationaux ne tient plus aujourd’hui que par la peinture ! Des pans entiers de souveraineté leur ont été enlevés dans le cadre de la construction européenne, sans que ces parts de souveraineté se trouvent reportés à un plus haut niveau (l’Europe ne s’est pas construite comme une puissance, mais comme un marché). D’autre part, l’évolution récente des Etats-nations atteste que ceux qui les dirigent – ou plutôt qui les administrent ou qui les gèrent – sont eux-mêmes largement gagnés à l’idéologie libérale. C’est ce qui explique que les libéraux, après avoir férocement combattus l’influence de l’Etat, en viennent aujourd’hui bien souvent à en attendre qu’il contribue lui-même à créer les circonstances les plus favorables au libre développement des marchés, à la mise en œuvre de l’idéologie des droits, etc. L’autorité publique se ramène alors à la « bonne gouvernance », qui calque le gouvernement des hommes sur l’administration des choses, en prétendant que les problèmes politiques ne sont en dernière instance que des problèmes « techniques », pour lesquels il n’y a qu’une seule solution rationnelle optimale (« there is no alternative »).
Existe-t-il un lien entre le libéralisme et « l’idéologie du même » que vous pourfendez ? Le libéralisme contribue-t-il à la disparition de l’altérité et à l’avènement de ce que le philosophe tchèque Jan Patočka nomme « l’âme fermée » ?
Je pense que le libéralisme contribue en effet à la disparition de l’altérité, d’abord parce qu’il ne reconnaît que les différences individuelles, et non les différences collectives, ensuite parce ses fondements individualistes vont inévitablement de pair avec un universalisme de fait, au regard duquel les hommes sont fondamentalement les mêmes. Le seul fait de dessaisir l’homme de ses appartenances au profit d’un homme abstrait, de partout et de nulle part, montre qu’aux yeux des théoriciens libéraux les différences collectives, entre les peuples, les nations ou les cultures, ne peuvent qu’être secondaires, superficielles ou transitoires. Nous apparaissons certes différents, mais au fond nous sommes les mêmes ! C’est pour cela que le libéralisme estime qu’une bonne Constitution est bonne pour tous les peuples, comme le disait Condorcet, que le monde entier peut être transformé en un vaste marché planétaire régi par les seules lois du marché, que les droits de l’homme sont valables en tous temps et en tous lieux, etc.
Les démocraties libérales traversent aujourd’hui une crise profonde. L’émergence et l’arrivée au pouvoir de mouvements dits populistes, mais également la mobilisation des gilets jaunes ou l’apparition de voix dissonantes dans les médias, le milieu associatif et l’université, le montrent bien. Êtes-vous d’accord pour dire que le libéralisme est une idéologie en déclin ?
Je ne dirais pas encore que le libéralisme est en déclin, mais qu’il est en crise, et que cette crise a de bonnes chances d’annoncer son déclin. La crise en question touche à la fois les institutions politiques et le système économique capitaliste. La démocratie libérale, fondée sur l’« Etat de droit », que beaucoup considéraient comme indépassable, est en train de s’effondrer du fait de la défiance généralisée des sociétaires. Elle était à la fois représentative et parlementaire. Or, les gens constatent que les représentants ne représentent plus grand-chose et que la souveraineté parlementaire s’est substituée à la souveraineté populaire. Du même coup, les mots de « démocratie » et de « libéralisme » ne sont plus synonymes ; on redécouvre au contraire qu’ils correspondent à des choses complètement différentes. La démocratie place la légitimité dans la souveraineté populaire, alors que le libéralisme place l’exercice du jeu démocratique sous conditions en plaçant les « droits » au-dessus du peuple. Les gens ne font plus confiance aux partis, et il est significatif que le mouvement des gilets jaunes soit apparu en marge des partis comme des syndicats. La crise de la démocratie libérale a d’abord nourri l’abstention, après quoi elle a favorisé la montée des mouvements dits « populistes », montée qui se fait au détriment des anciens partis traditionnels, dits « de gouvernement », qui s’effondrent aujourd’hui comme des châteaux de cartes. Ces partis ayant été les vecteurs essentiels du clivage horizontal gauche-droite, un nouveau clivage apparaît, de nature verticale, qui oppose les classes populaires et les classes moyennes en voie de déclassement au bloc bourgeois des élites transnationales mondialisées (voir les travaux de Christophe Guilluy et Jérôme Sainte-Marie, pour ne citer qu’eux).
Mais le système capitaliste est lui-même menacé par ses contradictions internes. La recherche de gains de productivité exigée par la concurrence aboutit à ce que l’on produit toujours plus de biens et de services avec toujours moins d’hommes. L’omnipotence de l’argent, qui a d’abord favorisé le système du crédit, a abouti à un endettement généralisé qui atteint désormais des sommets jamais vus. Le capitalisme a perdu ses anciens ancrages nationaux pour devenir purement spéculatif et totalement déterritorialisé. S’ajoutent encore à cela les problèmes écologiques (il n’est plus possible de croire que les réserves naturelles sont inépuisables et gratuites). Nombreux sont les observateurs qui s’attendent aujourd’hui à une nouvelle crise financière mondiale beaucoup plus grave que celle de 2008. Je ne peux ici qu’effleurer le sujet, mais la concordance de ces deux crises majeures, l’une politique, l’autre économique, laisse évidemment prévoir des basculements décisifs dans les années qui viennent.
Nous estimons dans notre association que le pouvoir se gagne par les idées. Sur quelles grandes figures intellectuelles recommanderiez-vous de s’appuyer afin de mener la bataille culturelle contre le libéralisme ?
J’aimerais bien que le pouvoir se gagne par les idées ! Le problème est que la façon dont les idées exercent une influence et finissent par s’imposer est tout sauf simple. Les hommes politiques n’aiment pas beaucoup les idées, car ils veulent rassembler alors que les idées divisent. C’est la raison pour laquelle ils ne s’intéressent aux idées que lorsqu’ils peuvent les instrumentaliser à leur profit. Et c’est aussi la raison pour laquelle, après avoir parfois tenté d’avoir la stratégie de leurs idées, ils finissent si souvent par n’avoir plus que les idées de leurs stratégies. Cela dit, je n’en pense pas moins, comme vous, que rien ne remplace le combat des idées. Quant à vous recommander telle ou telle grande figure intellectuelle, je préfère y renoncer : il y en a trop ! Reportez-vous éventuellement aux auteurs dont je présente les œuvres dans mon livre Ce que penser veut dire, paru récemment aux éditions du Rocher. Il y a de toute façon bien des valeurs sûres, que vous connaissez déjà sûrement : Jean-Claude Michéa, Christopher Lasch, Jean Baudrillard, Louis Dumont, Julien Freund, Carl Schmitt, Heidegger et tant d’autres.
Pour l’instant, aucune alternative n’émerge au-delà de l’échelle locale. La décroissance que vous appelez de vos vœux n’est-elle pas invendable (auprès de populations qui restent globalement attachées à la société de consommation) et utopique au regard des forces économiques en présence ?
Vous n’avez pas tort : la décroissance est tout à fait « invendable » auprès de beaucoup de gens, et plus encore auprès des hommes politiques qui font tous assaut de prétentions pour « ranimer la croissance » ! Cela peut paraître désespérant, mais la justesse d’une idée ne dépend pas de l’accueil qu’elle est susceptible de recevoir à tel ou tel moment. Si la théorie de la décroissance est juste, si elle est fondée, elle finira par s’imposer au moment où il deviendra impossible de ne pas envisager cette option. Il est vraisemblable qu’on déplorera alors de ne pas l’avoir envisagée plus tôt, ce qui aurait évité des tournants catastrophiques. La théorie de la décroissance dit que le système actuel n’est plus réformable, qu’il va dans le mur. Si le mur est bien là, il n’est pas du tout utopique de dire qu’il existe effectivement !
Selon Régis Debray, ceux qui ont appuyé le projet de construction européenne depuis la Seconde Guerre mondiale considèrent que « le propre de l’Europe est de ne pas avoir de propre ». Alors que l’Europe s’abandonne au nihilisme et à l’oubli de soi, pourriez-vous revenir sur ce qui fonde le sentiment européen et l’identité de l’Europe ?
L’opinion de Régis Debray est, je crois, partagée par beaucoup d’autres. Le fait est que tout se passe comme si l’Europe voulait en quelque sorte se délester d’elle-même. Les polémiques suscitées récemment par la nomination, à la Commission européenne, d’un commissaire chargé de la « protection du mode de vie européen » sont révélatrices. Un mode de vie européen, qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ! Tout aussi significativement, les polémiques ne se sont apaisées que lorsqu’on a laborieusement expliqué que le « mode de vie européen » consiste en fait à accepter tous les autres modes de vie (il suffisait d’y penser) ! L’Europe ne veut rien avoir en propre qui puisse servir de modèle parce qu’elle se veut porteuse de « valeurs universelles » qui, comme par hasard, sont aussi des valeurs libérales. Etant « universelles », elles sont elles aussi de partout et de nulle part. En se présentant comme « ouverte à l’ouverture », c’est-à-dire ouverte à tout, l’Union européenne fait l’aveu de son impuissance et de sa soumission à l’idéologie dominante. Il n’en est que plus nécessaire, en effet, de réaffirmer un sentiment européen susceptible de s’inscrire dans une continuité historique reliant le passé à l’avenir. L’Europe est une histoire associée à un espace territorial. Son identité trouve son fondement dans la communauté d’appartenance et d’origine de la plupart des pays qui la composent. Mais cette identité ne doit pas être essentialisée : c’est une substance, pas une identité. L’identité n’est pas ce qui ne change jamais, mais ce qui nous permet de changer tout le temps tout en restant nous-mêmes. Nietzsche disait qu’on « ne ramène pas les Grecs » ; on peut en revanche prendre exemple sur eux pour être aussi novateurs qu’ils le furent en leur temps. L’identité en fin de compte, n’est pas tant ce que l’on est que ce que l’on fait de ce que l’on est.
Pour finir sur une note d’actualité, la marche contre l’islamophobie d’il y a deux semaines a mis en lumière une fois de plus l’ampleur des fractures françaises et la sécession culturelle croissante d’une partie des Français de confession musulmane. Sur quoi pouvons-nous encore nous appuyer pour résister à la montée de l’islamisme, au-delà des incantations creuses sur les « valeurs de la République » ?
La force de l’islamisme n’est que le reflet de nos faiblesses. Il ne sert à rien de déplorer l’évidente « sécession culturelle croissante d’une partie des français de confession musulmane » si nous sommes nous-mêmes incapables de réanimer un lien social porteur de valeurs partagées. C’est précisément là que l’on retrouve le libéralisme, qui est l’un des principaux responsables de la destruction des anciennes structures organiques. La société des individus est une société fracturée, effritée, atomisée, où les gens vivent à la fois dans une solitude croissante et dans une « guerre de tous contre tous ». C’est une société de manque, une société où le principe de plaisir a pris le pas sur le principe de réalité. Faire face aux dangers qui menacent implique d’en finir avec cette société et de nous reconstruire nous-mêmes.
Alain de Benoist (Critique de la raison européenne, 26 novembre 2019)
