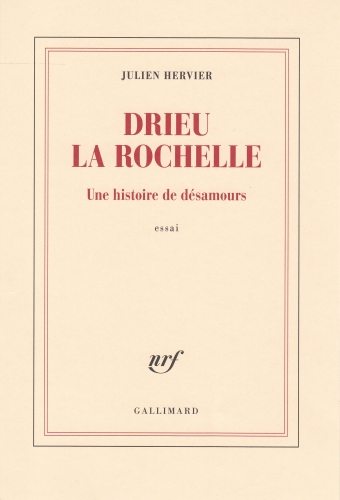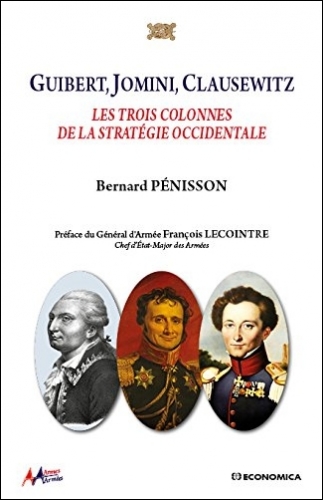Alain de Benoist : « Contrairement à ce que l’on croit, l’avortement n’est pas la cause essentielle de la baisse de la natalité… »
En France, le taux de fécondité serait passé sous le seuil des deux enfants, soit celui du renouvellement des générations. Certains s’en alarment, alors que d’autres font de même de la surpopulation mondiale. Ces deux attitudes sont-elles légitimes et, en même temps, ne seraient-elles pas contradictoires ?
On a enregistré en France 767.000 naissances en 2017, avec un taux de fécondité de 1,88 enfant par femme, ce qui n’a pas empêché la population globale de continuer à croître en raison du solde naturel (l’excédent de naissances par rapport aux décès). Cela dit, les données démographiques ne veulent rien dire en elles-mêmes. Elles n’ont pas le même sens selon qu’on est en situation de sous-population ou de surpopulation. Trois problèmes, en particulier, sont à prendre en compte. Le premier est celui de la pyramide des âges (à volume de population égal, cette pyramide peut être équilibrée ou détériorée). Le second est la composition de la population (l’apport de l’immigration, quelles sont les catégories les plus prolifiques ?). Le troisième est le différentiel de natalité par rapport aux zones voisines, à commencer par le continent africain (6-7 enfants par femme aujourd’hui, plus de 40 % de moins de 16 ans, une population de 1,2 milliard d’habitants appelée à doubler d’ici à 2050).
Contrairement à ce que l’on s’imagine souvent, la cause essentielle de la baisse de la natalité n’est pas à rechercher dans les avortements, ce qui a maintes fois été démontré (la grande majorité des avortements est compensée par des naissances futures qui ne seraient pas survenues si ces avortements n’avaient pas eu lieu), mais dans des évolutions propres à la société moderne, à commencer par le travail des femmes. L’âge moyen, à la naissance du premier enfant, n’a cessé de reculer ces dernières décennies, car de plus en plus de femmes préfèrent donner la priorité à leur carrière professionnelle. Quand elles envisagent d’avoir un enfant, il est souvent trop tard. S’y ajoutent d’autres facteurs : l’hédonisme (avoir des enfants est perçu comme une diminution de liberté), le mode de vie urbain, peu favorable aux familles nombreuses, etc.
« Croissez et multipliez » : cette injonction n’est pas que le fait du christianisme, mais concerne aussi les deux autres religions révélées, le judaïsme et l’islam. Mais faire toujours des enfants en plus grand nombre est-il véritablement une valeur en soi ?
L’Église catholique s’est, en fait, montrée moins conséquente que les deux religions que vous citez (moins conséquente, aussi, que l’Église orthodoxe), puisqu’elle a interdit la procréation à ses élites ecclésiastiques, ce qui a exercé un sévère effet dysgénique sur la société globale. Cependant, le simple désir de quantité ne peut jamais être une « valeur en soi ». « Croissez et multipliez » n’est, à l’origine, qu’un impératif de survie pour tout groupe désireux de se perpétuer. Cet impératif biologique a ensuite reçu un habillage religieux, pour le rendre plus contraignant, à une époque où il s’agissait avant tout de maximiser le nombre des fidèles. Il ne peut pas avoir le même sens dans un monde peuplé de quelques dizaines ou centaines de millions d’habitants (en 1700, on n’en comptait même pas encore un milliard) ou dans un monde qui en compte, aujourd’hui, 7,5 milliards et en comptera probablement 12 milliards à la fin du siècle. Il ne faut pas oublier, non plus, que les familles nombreuses, dans le passé, étaient très souvent décimées par la mortinatalité et la périnatalité : faire beaucoup d’enfants était le seul moyen d’être assuré d’en voir survivre quelques-uns.
Croire, sous prétexte « d’accueillir la vie », qu’il faut faire toujours plus d’enfants, ou encore qu’on pourrait se livrer à une sorte de concurrence nataliste avec des populations ou des pays à la fécondité plus exubérante, c’est se leurrer d’illusions. Je suis surpris, à cet égard, de voir que, même parmi ceux qui se prononcent pour le maintien des limites et des frontières, et qui déclarent détester la démesure et l’illimitation, la question des limites démographiques ne soit presque jamais posée. On peut, certes, spéculer à l’infini sur les possibilités qu’il y aura de nourrir demain encore plus d’hommes qu’il n’en existe. Mais quelle que soit la réponse donnée, l’évidence est qu’il existe nécessairement une limite. Passé un certain seuil, la croissance démographique aggrave la destruction des écosystèmes et l’appauvrissement des ressources naturelles. Aboutissant à des mégapoles monstrueuses de plus de vingt ou trente millions d’habitants (Tokyo, Mexico, Séoul), elle est, en outre, profondément polémogène et génératrice d’incessants troubles politiques et sociaux. Pas plus qu’une croissance matérielle infinie on ne peut avoir une croissance démographique infinie dans un espace fini.
Pour Emmanuel Todd, la démographie permet d’expliquer nombre d’événements. À l’en croire, la chute de l’URSS était inscrite dans la baisse de sa natalité, tandis que le chaos des révolutions arabes l’était dans sa hausse, amenant trop de jeunes diplômés sur un marché du travail déjà saturé. Quelle est donc la part du facteur démographique dans les grands bouleversements historiques ?
Le facteur démographique est un facteur de première importance, ce que l’on peut démontrer par bien d’autres exemples que ceux donnés par Emmanuel Todd. Mais ce facteur n’intervient pas de manière mécanique ou automatique. Il est sensible à la décision politique (la Russie a déjà redressé sa natalité). Et le nombre n’est pas tout : le peuple juif a traversé les millénaires alors qu’il représente à peine 15 millions d’individus dispersés dans le monde, soit, numériquement, guère plus que la population de l’Île-de-France.
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 12 février 2018)